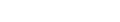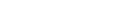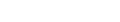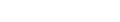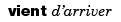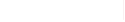Les Chats perdus, chapitre 23
Résumé des chapitres précédents
Dans le quartier des Pas perdus (qu’on appelle familièrement « quartier des Chats perdus »), des fleurs sont déposées mystérieusement chez les uns ou chez les autres : d’abord chez Furio Rosso, vieil italien retraité qui habite au dernier étage du 11, rue des Clartés ; puis chez Adélie Brancart, la concierge. Enfin, à la crèche tenue par Sacha Prizzi.
Cette dernière fleur a d’abord constitué un mystère. Car si Furio et Adélie n’ont deviné que peu à peu la provenance de « leurs » fleurs, le lecteur sait depuis le chapitre 8 qu’en fait, c’est le groupe un peu gauchiste, un peu anar sur les bords, formé par les compagnons de Sacha, qui agit : outre Sacha, Verlaine, Juliette et Mona travaillent à la crèche ; Hager y est souvent, car elle est son médecin attitré ; Manu, Vincent et Bruno sont les copains respectivement de Sacha, Hager et Mona ; Charly est un vieil ami de Sacha (c’est lui qui fournit les fleurs). La petite bande a décidé de remercier de la sorte des personnes choisies pour la manière qu’ils ont eue de « prendre parti » dans leur vie. Furio Rosso a reçu un lupin « pour avoir participé au collectif Arseno Lupino qui avait notamment écrit un livre sur l’éducation des plus jeunes », livre qui a inspiré le projet de crèche à Sacha et ses copines. Et Adélie Brancart, la concierge, une gueule de loup pour rendre hommage au premier squat qu’elle a créé avant de devenir concierge, et qui portait ce nom-là.
Mais pourquoi, dès lors, une orchidée à la crèche ?
Dès le dépôt des lupins, Furio est allé porter plainte. L’inspecteur Malik Fall, mis sur la touche par son supérieur hiérarchique en raison de sa lenteur à mener les affaires, s’est lancé dans l’enquête avec tant de rigueur spéculative qu’il a fait naître chez le précédent l’hypothèse qu’il s’agit là d’un dangereux groupe de terroristes. Le commissaire a mis d’autres policiers sur l’enquête – et Malik a prévenu le groupe de Sacha en déposant lui aussi une fleur – et un Playmobil – faisant une sorte de rébus. Une entrevue entre lui et certains du groupe de Sacha a fini de les éclairer sur les dangers qu’ils courent.
Malik n’est pas seul à mener l’enquête, et le groupe de Sacha, pas seul à s’inquiéter. Lydia Brancart, la fille de la concierge, et son amie Rosalie, fille d’une peste de l’immeuble, Huguette Charis, professeur Agrégée de grammaire et présidente de l'Association culturelle des Pas Perdus. Lydia et Rosalie ont eu vent de ces fleurs, et décident d’enquêter sur le mystère. Elles sont par ailleurs amies d’Aglaé, fille d’Anselme Frey, un vulcanologue-volcanologue qui se trouve aussi l’ami d’un autre habitant de l’immeuble, Éric Dupont : les fillettes ont accès aux mails échangés entre les deux hommes et interprètent à tort et à travers les « indices » dont ces mails sont remplis.
Le premier lieu où chacun cherche des informations est le magasin de Sarah Madamet, l’ancienne éditrice récemment reconvertie dans les fleurs, fleurs rêvées et fleurs vendues qui lui font souvent vivre une sorte de cauchemar éveillé : il se trouve que Bruno, le copain de Mona, est aussi son associé.
Le chapitre 17 était consacré à la rencontre entre Malik Fall d’un côté, et Sacha, Mona et Vincent de l’autre. Au chapitre 18 a été annoncé qu’une fête allait se dérouler au 11, rue des Clartés, parallèle à la fête de la Musique et organisée par Huguette Charis – et que cette dernière a notamment demandé aux membres de la crèche de prévoir un spectacle pour occuper les enfants.
Le monde entier est un cactus
Barbara Kadabra
OU
Carlo Brio
François Cornilliat
Florence Dumora
David Kajman
Hélène Merlin-Kajman
Brice Tabeling
02/03/2019
« AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏEEE !!! »
Il y avait des silhouettes qui s’agitaient comme des pantins désarticulés, il y avait des corps plus immobiles que la pierre, il y avait des trajectoires de chats effrayés, il y avait des yeux fous, ou stupéfaits, ou sans vie. Et puis les cris, suivis de jurons et de gestes de colère, des « Je ne suis pas payé pour ça ! », nouveau cri, un rire hystérique, un « Ta gueule, fils de pute ! » et, au fond du hall, légèrement en hauteur, l’ombre silencieuse du commissaire qui, depuis le grand escalier en marbre menant à son bureau, évaluait le carnage ou, plus probablement, se demandait qui, mais qui avait bien pu appeler la presse ?
Il aurait fallu fermer la grande porte du commissariat et dissimuler ce spectacle déplorable à l’œil des caméras et aux badauds hilares mais, alors, par où évacuer les cactus ?
Je restais sagement en retrait parmi les commentaires. Un vieux monsieur dans le public indiqua à son voisin deux gros flics (c’étaient Mounier et Meunier) qui, le regard terrifié, sortaient un grand cactus vert. « Ça, c’est un figuier de Barbarie », dit-il, « Opuntia ficus-indica ». « Le truc avec les raquettes là ? » demanda l’autre. « Oui, ce sont ses tiges, on appelle ça des cladodes ». Les deux flics jetèrent sans ménagement la plante dans un camion benne. Quelques applaudissements se firent entendre dans la foule. « C’est idiot », dit le vieil homme, « un Opuntia ficus-indica de cette taille, ça vaut une fortune ».
Je me demandais comment Sacha, Adélie et les autres s’étaient débrouillés pour provoquer un tel foutoir. Quelqu’un leur avait-il donné accès au commissariat ? On m’avait laissé entendre qu’un autre flic était dans le coup (ce qui, avec Kévin Junior et moi, faisait trois flics qui auraient rejoint la cause du « groupe des fleurs » ; j’avais beau savoir que ce groupe était à peine un groupe et qu’il n’avait, quoi qu’en pense le commissaire, rien à voir avec une entreprise de subversion gauchiste de l’Etat, face un tel noyautage de la police du quartier, j’avais parfois des sueurs froides). Aux dernières nouvelles, ils souhaitaient passer par la Poste mais je voyais mal le facteur livrer plusieurs dizaines de cactus au commissariat sans éveiller les soupçons de mes collègues, aussi stupides soient-ils.
« Oh, des bonnet d’évêques ! », dit le vieil homme, « Astrophytum myriostigma, et fleuris avec ça !». C’étaient des petits trucs gris qui ressemblaient en effet à une barrette de prêtre, ce chapeau de forme quadrangulaire que les curés mettaient autrefois pour célébrer la messe. Seules les trois pseudo-pâquerettes qui trônaient à leur sommet interrompaient l’analogie, et la taille, l’astrophytum myriostigma tenant facilement dans le creux de la main. Jérôme, du service comptable, en portait deux à bout de bras, ce qui irrita Mounier et Meunier : « Ça va ? C’est pas trop lourd ? Tu veux qu’on t’aide peut-être ? ». Jérôme les ignora mais comme Mounier insistait, lui faisant remarquer qu’à ce rythme-là, ils en auraient pour la journée, il rétorqua « Dis ça à Fall » en me désignant dans la foule (le traître).
Il est vrai que j’avais un peu renoncé à mes engagements collectifs. Le « groupe des fleurs » organisait très bien sa réplique sans moi. On pouvait dire que les jeunes de la crèche avaient réussi leur coup. Certes, tout cela n’avait pas tout à fait pris le chemin initialement prévu mais, au final, les fleurs avaient permis qu’Adélie, Furio, les enfants, la crèche, la fleuriste constituent un collectif noué par une forme de souci du commun, ce qui était en gros ce à quoi les fleurs avaient initialement voulu rendre hommage. Même Kévin Junior s’était rapproché de l’immeuble de la rue des Clartés. Il rejoignait régulièrement Furio au Thermomètre après le travail, y passant de longues heures mystérieuses. Car je me demandais bien ce qu’ils avaient à se dire ces deux-là et même s’ils se disaient quoi que ce soit, ni l’un ni l’autre n’étant particulièrement bavards. Peut-être se contentaient-ils de rester côte-à-côte en silence. Autre étrangeté : il s’était inscrit à l’association culturelle des Pas perdus, pour « s’agrandir la tête » comme il disait de manière bizarre. En fait, je crois qu’il était un peu amoureux d’Adélie. Mais « amoureux » n’est peut-être pas le bon mot. Je ne sais pas si les Kévin Junior du monde entier éprouvent ce genre de sentiment et s’ils le nomment comme cela. Disons simplement qu’il était intarissable sur Adélie, sur son « courage », son « énergie », le « destin incroyable de sa vie » et la « liberté » avec laquelle elle l’avait menée. Moi, je suppute que cela avait à voir avec sa mère ou avec le Nord, ou les deux. Adélie avait dans sa jeunesse participé à un squat à Roubaix pour revitaliser les corons. C’est Kévin Junior qui me l’avait dit.
La fête de l’immeuble avait été le point culminant de ma vie sociale avec tous ces gens et, en même temps, le début de mon désengagement. Oh, ce n’était pas par misanthropie ou par ennui. Je les aimais bien, c’étaient des personnes sympathiques. Et la fête n’avait pas été une catastrophe, loin de là. Je m’étais même plutôt amusé. L’ensemble de mes rencontres des derniers mois y était rassemblé, même le vieil amnésique aux présupposés affligeants était là, errant près du buffet et régulièrement rejoint par Furio qui semblait l’avoir pris en amitié. J’étais déguisé en habitant du Tyrol, ceux qui font « youyouyouyou » dans les montagnes, mais un certain nombre d’accessoires me manquaient (la salopette, les chaussures et les chaussettes blanches notamment). Au final, j’avais un beau chapeau vert (et un imperméable, car la météo était plutôt changeante).
Kévin Junior, mon chapeau triangulaire et moi étions donc là, en train de regarder avec perplexité la pièce de théâtre des jeunes de la crèche quand j’entendis quelqu’un me demander si j’y comprenais quelque chose. C’était le petit bonhomme rondouillard et un peu chauve qui avait fait une crise aiguë de sécateur contre les bromélias requins du commissaire.
— Ah, pardon, je ne vous avais pas reconnu avec votre chapeau, me dit-il.
— Anselme Frey, c’est ça ?
— Oui, oui, Anselme Frey. Vulcanologue et volcanologue, l’ananas centripète, le kairos, commissariat et sécateur. Anselme Frey, quoi.
— Anselme Frey.
— Voilà. Vous… Vous avez des connaissances amicales dans l’immeuble ou vous êtes ici pour des raisons, euh, professionnelles ?
— …
— Vous êtes peut-être venu par goût pour le théâtre ?
— Oh non ! J’ai beaucoup de difficultés avec le théâtre, comme avec la littérature d’ailleurs ou l’art en général. Trop d’interprétations possibles, ça ne s’arrête jamais, ça n’a pas de fin. Non, non, pas le théâtre. Je connais des gens, par contre. Adélie, Furio…
— Ah oui, Furio.
— Et vous. Et même le vieil Africain près du buffet, là.
— Vous connaissez Cornélius ?
— Il s’appelle Cornélius ? Cornélius comment ?
— Cornélius, c’est son nom de famille. Son prénom, c’est Amandé. Ou Jean. Jean-Amandé peut-être. Je ne sais plus mais je peux le retrouver. Il a participé à un colloque que j’ai organisé à Yale en 2012.
— C’est un vulcanologue ?
— Absolument pas !
— Un volcanologue ?
— Non plus ! C’est un spécialiste de Derrida. Le colloque était une tentative de rapprochement interdisciplinaire un peu compliquée entre l’étude des polymères et les sciences humaines. Pour des raisons de financement, nous avons dû inviter des littéraires, des philosophes, ce genre de choses. Mais, au final, les points d’intersection ont été plutôt rares, voire tout à fait inexistants. Cornélius devait faire une communication sur la plasticité du concept de différance si je me souviens bien mais, d’après ce que j’ai cru comprendre, il a changé au dernier moment pour évoquer un problème d’exploitation forestière dans la forêt du Nord-Kivu.
— Le Nord-Kivu ?
— C’est au Congo, son pays d’origine peut-être. Apparemment, il a tenu un discours très politique, très concret. Lors du dîner de fin de colloque, les autres Derridiens en parlaient comme d’une honteuse régression référentielle.
— Vous n’avez pas assisté à sa communication ?
— Oh non ! Les littéraires étaient dans une salle et les scientifiques dans une autre. Comme je vous l’ai dit, les points d’intersection étaient plutôt rares. A part au dîner bien sûr. Vous permettez que je vous laisse, inspecteur ? Il y a ma fille qui m’appelle.
Meunier m’escorta jusqu’au bureau du commissaire et m’ordonna d’attendre un moment. Il voulut m’annoncer mais à peine avait-il pénétré à l’intérieur de la pièce que j’entendis le commissaire hurler : « FERMEZ-MOI CETTE FOUTUE PORTE ! ». Meunier ressortit vivement et me dit en ricanant : « Ça chauffe pour Sophie ! ». Sophie était l’hôtesse d’accueil. Elle sortit quelques minutes plus tard et me dit en sanglotant : « Le commissaire vous attend ».
Effectivement, il m’attendait. De ma vie, je n’avais jamais vu quelqu’un me regarder avec autant d’intensité. Dès que j’étais entré dans le bureau, le monde du commissaire semblait s’être contracté autour de mon unique personne. J’étais comme une apparition.
— Fall, c’est vous qui avez manigancé tout cela, n’est-ce pas ?
— Tout cela ? C’est-à-dire ? Vous parlez des cactus en bas ?
— Les cactus, les journalistes devant le commissariat, cette tribune dans Libé, les fleurs. TOUT ! C’est vous, n’est-ce pas ? Et vous avez embarqué la pauvre Sophie dans vos projets.
— Commissaire, je suis désolé, je n’ai aucune idée de ce dont vous parlez.
Il saisit avec empressement un journal qui reposait sur son bureau et le feuilleta à toute vitesse.
— Attendez, attendez ! Voilà ! Je lis : « Les présupposés affligeants du pouvoir policier néolibéral ont réussi à effacer la poésie des fleurs ». Et plus loin : « Cela fait bien longtemps que les fleurs ont disparu de nos paysages : ce que nous cueillons dans les champs, ce que nous offrons à nos amant, point e point s », jamais compris comment on devait lire l’écriture inclusive, « ce que nous offrons à nos amant point e point s, ce sont à peine leurs fantômes, leurs spectres, le reste sentimental d’un monde disparu ». Le reste sentimental, Malik ! Et c’est intitulé : « Pourquoi nous continuerons à vous envoyer des fleurs », deux pages de conneries poético-libertaires dans le Libé d’aujourd’hui. Les présupposés affligeants, le sentiment ! Ne me dites que vous n’avez pas trempé dans cette affaire !
— Ce n’est pas signé ?
— Si c’est signé ! Adélie Brancart ! Furio Rosso ! Sarah Madamet ! Sacha Prizzi, etc. etc. ! Toutes les personnes sur lesquelles vous enquêtiez ! Et ils décrivent par le menu nos procédures de surveillance, les écoutes téléphoniques, les moyens mis en place, les soupçons de terrorisme, tout ! A part vous, qui aurait pu leur transmettre toutes ces informations ?
— Je vous avais dit que Meunier et Mounier n’étaient pas très discrets.
— NE VOUS FOUTEZ PAS DE MA GUEULE, MALIK !
— Commissaire, je vous assure que je n’y suis pour rien.
— JE NE VOUS CROIS PAS !
-- Commissaire, je vous jure…
— JE NE VOUS CROIS PAS ! JE NE VOUS CROIS PAS ! JE NE VOUS CROIS PAS !
C’était un hurlement continu. La rage avait tout emporté : il n’y avait plus de parole mais de la pulsion meurtrière à l’état pur. L’explosion fut si violente que le corps fatigué du commissaire n’y résista pas : sa voix dérapa, il eut le souffle coupé, le sang quitta son visage. Il y eut un court moment de silence au cours duquel le commissaire, épuisé, tenta de se reprendre. Enfin, d’une voix basse, il me dit :
— Je n’ai aucun doute, Malik, c’est vous. Dans tous les cas, vous êtes mouillé. Donc vous êtes mort. Il n’est plus question de suspension : pour vous, c’est la procédure disciplinaire et le licenciement. Pour les autres, par contre, il y encore une incertitude mais, je m’en fous, je trouverai n’importe quoi, dégradation de biens publics, insultes à magistrats, violation du secret de l’instruction, parricide, n’importe quoi, mais je les écrabouillerai.
— Non commissaire, vous ne ferez rien.
— Pardon ?
— Vous ne ferez rien, commissaire. Vous allez laisser ces gens tranquilles et enterrer cette affaire absurde.
— Sortez tout de suite de mon bureau, Fall.
— Non commissaire, il faut que je vous explique. C’est un peu compliqué.
Ce n’était donc pas par misanthropie, ni par ennui. C’était même l’inverse : si j’avais pris un peu de distance avec le groupe des fleurs, c’était par passion et par goût d’autrui (ou, pour le moins, par goût des mystères de la vie d’autrui). Anselme Frey m’avait relancé sur le cas du vieil Africain, qui n’était d’ailleurs pas Africain mais Suisse et qui s’appelait, non pas Jean-Amédée mais Pierre-André Cornélius. Il était docteur en littérature comparée de l’Université de Lausanne, spécialiste de Paul de Man et de Blanchot (et non pas de Derrida). J’avais retrouvé le colloque organisé par Frey, Polymers And Polysemy : Polydisciplinary Implications Of Plasticity Today et, de là, le nom correct de mon mystérieux amnésique.
J’avais surtout pu reconstituer des éléments importants de sa vie. Pierre-André Cornélius était un chercheur itinérant et intermittent. Il donnait des cours aux quatre coins du monde (à Tokyo, à Leeds, à Prague, à Berkeley, à Paris) sans jamais rester plus de 6 mois à un endroit. Etait-ce par choix ou parce qu’il ne trouvait aucun poste de titulaire ? Je n’en sais rien. Il ne semblait pas avoir mauvaise réputation. Au contraire : les quelques collègues que j’avais pu interroger à son sujet m’en ont parlé comme d’un chercheur rigoureux, parfois jusqu’à l’intransigeance.
En dépit des approximations de sa mémoire (ou d’une légèreté coupable à l’égard des littéraires), Anselme Frey ne s’était pas trompé sur les origines congolaises de Pierre-André Cornélius (il était né à Goma), ni sur sa communication à Yale ; celle-ci portait bien sur les forêts du Nord-Kivu. Il n’y avait aucune trace écrite de son intervention mais il l’avait plusieurs fois répétée cette année-là à l’occasion de divers colloques (La Narration voyageuse chez les éditeurs lyonnais du XVIIIe siècle (1715-1738) à la Sorbonne, La théorie des champs à l’épreuve de la classe : Pierre Bourdieu de la maternelle à la Terminale à l’EHESS notamment). A chaque fois, c’était le même procédé : il annonçait, comme l’attestaient les programmes que j’avais pu consulter, une communication en rapport avec l’intitulé du colloque (« Plasticity of the concept of différance » à Yale, « Un oubli chez Paul de Man ? les éditeurs lyonnais du XVIIIe siècle (1715-1738) » à la Sorbonne) mais, au final, il parlait des forêts du Nord-Kivu. De très nombreuses personnes avaient ainsi pu me renseigner sur sa communication et quoique nul n’y ait vraiment porté attention (ce qui était regrettable mais assez compréhensible puisque Pierre-André Cornélius ne respectait absolument pas le thème du débat proposé), j’avais fini par établir un résumé correct de son propos.
C’était un acte d’accusation très sévère de l’exploitation industrielle des forêts du Nord-Kivu. Plus précisément, Pierre-André Cornélius soutenait que la déforestation par un petit groupe de multinationales des zones qui entouraient le volcan du Nyiragongo, à l’est du Nord-Kivu, transgressait toutes les règles environnementales et sociales en vigueur et que seule une corruption massive des dirigeants locaux et des organismes de contrôle occidentaux avait permis d’étouffer le scandale. Le rôle joué par l’Agence Française du Développement était présenté comme particulièrement trouble. Pierre-André Cornélius s’en prenait notamment à un rapport sur les écosystèmes volcaniques commandité par l’AFD qui argumentait que les retombées des éruptions et les phénomènes géothermiques à proximité des volcans en activité assuraient une fertilisation particulièrement efficace des sols dans ces zones, fertilisation qui, comme le recommandait le rapport, devait conduire à un assouplissement local des normes environnementales qui y limitaient l’exploitation industrielle. L’économie forestière autour du volcan du Nyiragongo et son potentiel de développement étaient plusieurs fois évoqués en appui de cette thèse. Le premier signataire de ce rapport était Robert Well-Bébert.
J’avais retrouvé sans difficulté le rapport de l’AFD mais, de toutes manières, tous ceux qui avaient assisté à la conférence de Pierre-André Cornélius se souvenaient de sa colère contre Robert Well-Bébert. On pouvait se demander pourquoi un spécialiste de Paul de Man et de Maurice Blanchot s’intéressait à l’exploitation forestière du Nord-Kivu. Mais la réponse me semblait évidente. De Goma, la ville de naissance de Cornélius, quelle que soit la rue où l’on se trouve, il est impossible de ne pas voir le Nyiragongo. Le volcan se dresse au nord de la ville, grande ombre immobile, à la fois menaçante et familière, d’une région régulièrement bouleversée par les conflits interrégionaux et abandonnée aux mouvements les plus brutaux de l’économie libérale mondialisée. Pour un déraciné comme Pierre-André Cornélius, le Nyiragongo devait constituer un élément fondamental, au croisement des rêves et de la mémoire, de ce qui lui restait d’identité. La large silhouette tranquille du volcan aura été la dernière image que l’enfance aura offerte aux yeux du jeune garçon le jour de son départ pour l’Europe ou pour la capitale ; c’était lui l’ami qui reste fidèlement au bout du quai, dans la zone d’attente ou au bord de la route jusqu’à ce que notre avion, train ou bus disparaisse à l’horizon.
Le colloque à l’EHESS autour de la théorie des champs fut la dernière fois que Pierre-André Cornélius prononça sa philippique. Ce fut également sa dernière apparition universitaire. Personne n’a été en mesure de me dire avec précision ce qui s’y était passé. Un historien aujourd’hui à la retraite s’est souvenu d’une ambiance électrique : c’était quelques mois après l’élection de Sarkozy et les universitaires étaient sur les dents. De plus, le thème du colloque (La théorie des champs à l’épreuve de la classe : Pierre Bourdieu de la maternelle à la Terminale) avait prêté à confusion. Pour les organisateurs, il s’agissait de faire le bilan de la pensée bourdieusienne dans les pratiques enseignantes françaises mais la plupart des participants avaient interprété le titre du colloque comme une invitation à réfléchir sur l’utilité ou non d’un enseignement de l’œuvre de Pierre Bourdieu de la maternelle à la Terminale. L’apparente radicalité de l’intitulé avait attiré un public important (que ce soit pour protester contre l’absurdité d’un tel projet ou pour en célébrer le caractère révolutionnaire) dont les interventions n’avaient pas aidé à assurer la sérénité des débats. C’est dans cette atmosphère houleuse que Pierre-André Cornélius avait de nouveau résolument ignoré sa proposition initiale (« Un oubli chez Paul de Man ? La théorie des champs de la maternelle à la Terminale ») et prononcé son discours sur l’exploitation forestière dans le Nord-Kivu.
Robert Well-Bébert était-il présent ? Mon historien n’en savait rien, il n’avait pas écouté l’intervention de Cornélius. Et puis, me dit-il, parmi le public, il y avait de très nombreuses personnalités politiques et culturelles qui s’étaient senties obligées de prendre rapidement position sur le sujet et de le faire savoir. Il n’avait pas retenu tous les noms.
Je veux croire qu’il était là. Et même, qui sait ?, qu’il avait eu vent des accusations que Cornélius lançait contre lui aux quatre coins du monde et qu’il était spécialement venu pour pouvoir lui répondre. Il avait dirigé l’EHESS pendant trois ans, c’était donc un lieu qu’il connaissait bien ; il aurait l’avantage du terrain. Je l’imagine parmi l’assistance jouant la désinvolture et un ennui amusé ; un peu coquin, un peu rebelle, il bavarde bruyamment avec ses fidèles, venus exprès pour accompagner l’homme de génie dans sa vengeance. On dit « chut, chut » : il sourit comme un garnement, jette un regard désolé quoiqu’un peu canaille et reprend à peine plus discrètement sa conversation. Mais son inattention n’est que comédie : il suit avec passion le propos de l’orateur, repère ses approximations, note mentalement ses arguments les plus fragiles et affine silencieusement des formules assassines. Quand Cornélius termine, il est le premier à se lever pour applaudir à tout rompre. Ses fidèles restent assis, se contentent d’applaudissements narquois. Tout le monde dans la salle a compris le manège et, depuis plusieurs minutes déjà, on perçoit très distinctement l’odeur du sang.
Personne n’ose prendre la parole. Alors le président de séance se lance, c’est son rôle après tout, mais il n’a rien compris à cette intervention qui n’évoque ni la théorie des champs, ni l’enseignement en France. Il remercie médiocrement l’orateur et, comme rien d’autre ne lui vient à l’esprit, lui demande un peu embarrassé : où exactement se trouve le Nord-Kivu ? On entend quelques rires dans la salle. Le président sourit piteusement, que voulez-vous que je dise ?, mettez-vous à ma place. C’est alors qu’il remarque que Robert Well-Bébert a levé la main. Il n’attend pas la réponse de Cornélius et donne immédiatement la parole au grand homme : « Robert Well-Bébert, qui nous fait l’honneur de sa présence et que Monsieur Pierre Cornélius n’a guère épargné dans sa communication, aimerait dire quelque chose. Quelqu’un peut-il donner un micro à Robert Well-Bébert ? ». Mais celui-ci avec humilité le prie de ne pas se déranger : « Mon cher ami, vous savez bien que la technologie moderne, pour un vieux dinosaure comme moi… » dit-il de sa voix de stentor.
A quel moment Cornélius a-t-il compris qu’un meurtre se préparait et qu’il en était la victime ? Dès l’arrivée de Robert Well-Bébert dans la salle ? Au moment où il se leva pour lui répondre, le regard brillant, un léger sourire aux lèvres, parmi les murmures anxieux du public ? Où était-ce dès cette étrange hésitation, délicieusement feinte, aux tout premiers mots de sa réponse : « je vous remercie pour votre… contribution », trois petits points de suspension qui chargeaient l’expression qui suivait d’une très légère valeur interrogative et provoqua un frisson de bonheur chez les spectateurs. Je pense quant à moi qu’il a commencé à pressentir la catastrophe en entendant Robert Well-Bébert accumuler les éloges les plus délirants sur sa communication : chaque terme était hyperbolique et tous étaient équivoques. « Une argumentation d’une rigueur rarement vue », « une connaissance de la réalité congolaise proche de la merveille », « un souci de l’actualité exemplaire, intemporel, éternel, et qui fera date ». Quand la voix divine annonça, avec un air de profond regret, qu’on ne pouvait néanmoins s’empêcher de relever quelques légères inexactitudes, Cornélius ne pouvait plus douter : c’était à sa propre mise à mort qu’il assistait.
Je pense qu’il essaya de protester mais que l’hostilité des regards dans la salle lui imposa le silence. Alors ce fut une avalanche de chiffres, de statistiques, de citations latines, grecques, tchèques, berbères ou ouzbèkes, de grands noms prestigieux, de termes techniques intimidants, de raisonnements fulgurants – ou plutôt de fulgurances raisonnantes car, bien sûr, rien de tout cela n’avait le moindre sens : les chiffres étaient faux, les statistiques lacunaires, les citations amputées, tronquées ou fantaisistes, les grands noms s’étonnaient d’être là, les termes techniques n’étaient d’aucune langue, d’aucun dictionnaire. Ce qui importait, c’était l’autorité de la voix, la confiance du regard, l’assurance gracieuse des gestes et la clarté expressive des airs que prenait le visage. Surtout, c’était une cadence. Il y avait d’abord le rappel rapide, comme impatient, d’un passage de la communication de Cornélius puis une longue phrase, parfois interminable et toujours incompréhensible, qui en présentait la correction ; c’était alors une succession envoutante de périodes régulières, un rythme presque hypnotique qui menait doucement l’auditeur jusqu’au choc des derniers mots, conclusion brutale, syllabes terribles -- « mensonge », « erreur », « tromperie », « mystification », « hypocrisie » -- auxquelles la voix, soudain plus claire, plus tranchante, plus orageuse, donnait l’éclat tonitruant qui sied à l’apparition de la Vérité. Une courte pause, et cela recommençait. On aurait dit des roulements de tambour qu’aurait interrompu, à intervalles constants, le claquement d’une guillotine en surchauffe.
Un silence plus long marqua la fin de cette incroyable réfutation. Cornélius était exsangue. Cela faisait déjà une heure que Robert Well-Bébert parlait mais, pour les spectateurs captifs, toute idée de temps avait disparu. Cette interruption prolongée les sortit néanmoins de leur torpeur. Ils s’inquiétèrent : Quoi ? Cela s’arrête déjà ? Robert Well-Bébert reprit alors la parole : « Pour conclure, je souhaiterais, si monsieur le président de séance me le permet, revenir sur un point plus inquiétant de la communication de monsieur Jean-Pierre Cornélius. D’une certaine manière, les erreurs, les approximations, les accusations calomnieuses, les contre-vérités de son propos pèsent peu face à ce qu’il faut bien nommer… son racisme. Oui, monsieur Cornélius, je n’ai pas peur de le dire, votre communication est tout simplement raciste. Le terme est-il outré ? Est-ce une blague ? Ne craignez rien, ma vue baisse mais je ne suis pas aveugle. J’ai bien vu que vous étiez noir. Et pourtant… Et pourtant, comment qualifier autrement une intervention dont toute l’énergie vicieuse se consacre à réduire l’Afrique à la beauté de ses richesses naturelles ? Par quel autre terme nommer votre refus entêté d’accorder aux hommes et aux femmes de ce magnifique continent le droit au progrès économique, le droit au développement social, le droit, en somme, de prendre leur destin en main ? Vous parlez, monsieur Cornélius, des arbres, de la faune, des paysages, vous trouvez des accents lyriques pour évoquer l’hibiscus. Mais où est l’homme, monsieur Cornélius, où est l’homme ? Je ne le vois nulle part. Comme Diogène, je cherche, je cherche mais sur votre terre rétrograde, pas la moindre silhouette humaine, nulle activité de l’esprit, nul rire des enfants. Où faut-il que je regarde ? Y a-t-il un réduit obscur où vous l’auriez caché ? Une caverne peut-être ? Levons les yeux. Oui ! Le voilà ! Il est là ! Je l’aperçois parmi les feuillages. Dans les arbres, monsieur Cornélius, dans les arbres, c’est là que vous avez dissimulé l’homme africain ou plutôt, c’est là que vous l’avez condamné. Régression raciste ou racisme régressif ? Peu importe. Ce que j’entends derrière chacune de vos assertions, c’est le slogan de l’oncle réactionnaire de l’ouvrage bien connu de Roy Lewis évoquant les premiers pas de l’homo sapiens vers la culture : « Back to the trees ! » dit l’oncle réactionnaire. « Back to the trees ! » murmure sourdement chaque ligne de votre honteuse communication. Back to the trees, monsieur Cornélius.
— Vos présupposés sont affligeants.
— Mes présupposés ? Mais mon unique présupposé, c’est le réel ! Le réel, monsieur Cornélius, et non pas un fantasme colonial de virginité édénique ! Je connais les hommes et les femmes du Congo, je les ai rencontrés, j’ai partagé le maté avec eux. Ils ont des aspirations, ils ont des rêves et, cela vous surprendra peut-être, ils ont des projets qui ne se limitent pas à grimper aux arbres et à cueillir des hibiscus. Oh, ils n’ont certes pas eu l’opportunité, comme vous, de partir étudier en Suisse, abandonnant femmes et enfants pour rallier, toute honte bue, ceux que mon ami Pierre Bourdieu appelait fort justement les dominants. Mais devons-nous, pour cela, leur refuser le droit à l’existence ? N’ont-ils pas des yeux ? N’ont-ils pas des mains, des organes, des proportions, des sens, des émotions, des passions ? Si vous les piquez, ne saignent-ils pas ? Si vous les chatouillez, ne rient-ils pas ? Et si vous leur faites tort, ne se vengeront-ils pas ? Monsieur Cornélius, je vous le dis : vos frères trahis du Nyiragongo se vengeront de vos propos scandaleux. Et par ma voix fragile, ils se vengent déjà.»
Il y eut un moment de flottement puis un tonnerre d’applaudissements retentit dans la salle. Les fidèles de Robert Well-Bébert se levèrent comme d’un seul homme, entraînant avec eux le reste des spectateurs. Par cruauté, on cherchait à apercevoir le visage du pauvre Cornélius mais il n’était déjà plus à la tribune. Cela ne surprit personne : après une telle humiliation publique, la fuite était sans conteste la meilleure solution. Ce n’est qu’alors que la salle se vidait et qu’on en était à débattre de la pertinence ou non de l’usage de la tirade de Shylock, que le président découvrit sous le large drap de la table des conférenciers le corps inanimé de Pierre-André Cornélius.
— Mais tout cela, c’est de la fiction, dit le commissaire.
— Oui et non. Bien sûr, je n’ai aucune idée des propos exacts de Robert Well-Bébert, et j’ignore même s’il était présent. C’est tout juste un sentiment. Ce que je sais par contre, c’est qu’à la suite de cette conférence, Cornélius fut victime d’une cabale qui lui bloqua tout accès à l’université. Comme je vous l’ai dit, à partir de 2012, il cessa d’enseigner, ne participa plus à aucun colloque, n’écrivit plus aucun article : il disparut du monde académique. Or plusieurs personnes en France et aux Etats-Unis m’ont confié qu’elles avaient renoncé à l’inviter par crainte de représailles de la part de Robert Well-Bébert. Des menaces très claires avaient été formulées. Je pense que ce sont les conséquences de cette excommunication qui l’ont rendu fou. Alors, oui, cette conférence n’a peut-être jamais eu lieu ; pas d’assassinat public et donc pas de traumatisme. Mais le chômage, la misère, la clochardisation, la folie, rien de tout cela n’est le produit de mon imagination, et c’est Robert Well-Bébert qui en est directement responsable.
— Bon. Et qu’est-ce que j’ai à voir avec cette histoire, moi ?
— J’y viens. Votre amitié avec Robert Well-Bébert est bien connue, en tout cas dans les milieux qui comptent. Or je me suis toujours demandé pourquoi vous vous étiez empressé de me retirer l’affaire de Cornélius. Je sais : le respect des statistiques, ma lenteur etc. Mais vous auriez pu simplement m’ordonner de refermer le dossier au plus vite. Le confier à Meunier n’avait aucun sens. Quoi qu’il arrive, j’aurais été mis sur une nouvelle affaire, pour laquelle je n’aurais été ni plus rapide, ni plus lent. Et puis, n’était-ce pas à vos yeux l’affaire idéale pour moi ? Une histoire qui n’intéresse personne et sur laquelle je vais m’épuiser pendant quelques semaines en vous laissant parfaitement tranquille ? Bref : ce retrait m’a paru tout à fait illogique. Mais ce qui m’a vraiment intrigué, c’est qu’alors que Cornélius aurait dû, selon les voies habituelles, être transféré aux Services psychiatriques, on le croise dès le lendemain dans la rue.
— Une erreur de Meunier, probablement.
— Peut-être. Vous m’accorderez néanmoins que, si l’on considère tous les faits déjà à notre disposition, cette histoire commence à composer un tableau troublant. Primo, Cornélius est victime d’une cabale fomentée par Robert Well-Bébert ; secundo, vous êtes très proche de Robert Well-Bébert ; tertio, à peine Cornélius est-il récupéré par votre commissariat que vous dessaisissez le flic en charge de son cas –moi – pour le confier à un de vos hommes de confiance -- Meunier – lequel homme de confiance, et c’est mon quarto, à la suite d’une malencontreuse « erreur », le sort illico des circuits administratifs normaux pour le remettre à la rue.
— Cela reste très conjectural.
— Je suis bien d’accord. Et c’est pour cela que j’ai été rendre visite à Robert Well-Bébert.
— VOUS AVEZ QUOI ?
— Rendu visite à Robert Well-Bébert. Oh, ne vous inquiétez pas, cela s’est très bien passé. Grâce à vous d’ailleurs. Il a suffi que je prononce votre nom à l’interphone pour qu’il me fasse aussitôt monter dans son appartement. Et là, après qu’il m’a chaleureusement demandé de vos nouvelles, je lui ai simplement dit : « c’est au sujet du vieil Africain. Il est revenu ». Vous ne devinerez jamais ce qu’il m’a répondu.
— …
— Il m’a dit : « Et alors, vous ne pouvez pas à nouveau l’égarer ? »
« L’égarer ». L’expression employée par Robert Well-Bébert me fascinait. L’égarer : comme on perd ses clefs, son agenda, son chemin ; l’égarer : rendre fou, rendre délirant de douleur. Au croisement de l’anodin et de l’extraordinaire, on congédie un être de lui-même et puis on passe à autre chose (prendre un café, appeler son éditeur pour annuler un rendez-vous, se gratter le nez). Il y avait encore ceci : Cornélius était déjà égaré, corps à la dérive contracté dans une unique phrase. Pouvait-on en toute logique égarer un égaré ? Non, mais de cette impossibilité, je comprenais la nature très spéciale de l’acharnement de Robert Well-Bébert. Aucune limite ne serait jamais considérée : il n’y aurait pas de terme, pas de pardon, pas d’oubli, il n’y aurait même pas la satisfaction d’être parvenu à ses fins. La haine de Robert Well-Bébert s’exercerait à jamais ; ce qui importait, c’était son déchaînement, l’éclair continu de sa réalisation.
Et, de là, je prenais conscience que Cornélius ne s’était pas trompé : Robert Well-Bébert avait été acheté par des multinationales (ou des potentats locaux) pour écrire le rapport de l’AFD. Car comment expliquer la ténacité de sa haine à l’égard d’un obscur spécialiste de Blanchot et de Paul de Man si celui-ci n’avait pas, de quelque manière, dit la vérité ? Pourquoi cette interminable envie d’annihiler Cornélius s’il n’y avait pas, à l’origine d’un tel déploiement de moyens et d’efforts, un peu d’effroi ? Seule la peur, dans la mesure où nous croyons y engager ce que nous avons de plus vulnérable, a le pouvoir de nous rendre aussi vitaux les êtres et le monde.
Je ne doutais pas que Cornélius avait lui aussi compris cela en entendant (par hypothèse) Robert Well-Bébert l’exécuter publiquement, puis en découvrant l’oukase dont il était victime : tous ces outrages, toutes ces insultes, cette persévérance dans la persécution prouvaient que ses soupçons à l’égard du grand polygraphe multidisciplinaire étaient fondés. (Par ailleurs, j’ignore si je dois le préciser pour ceux qui sont un peu perdus entre mes hypothèses fictionnelles et les mensonges du discours de Robert Well-Bébert mais aucun des témoignages que j’ai pu recueillir n’a décrit la communication de Cornélius comme outrée ou injurieuse ; il avait certes dénoncé les différents financements locaux et internationaux du rapport de l’AFD (les premiers étant issus de gouvernements connus pour leur corruption endémique et les seconds ayant été plusieurs fois condamnés pour avoir été la puissance corruptrice des premiers) mais, en ce qui concernait Robert Well-Bébert, il s’était contenté de lui reprocher, assez sévèrement il est vrai, d’avoir fait preuve d’une désinvolture coupable en ayant accepté d’en être le premier signataire ; de plus, il ne semble pas que Cornélius ait jamais parlé d’hibiscus). Je crois que c’est le jour où il a compris qu’il serait à jamais la seule personne à connaître la vérité sans jamais pouvoir la partager et qu’il devrait assister impuissant à la dévastation illégale du Nord-Kivu que Cornélius a basculé dans la folie, qu’il s’est définitivement « égaré ».
L’expression qui retint l’attention du commissaire fut plutôt « à nouveau ». Je me permis de lui indiquer qu’une telle expression tendait à montrer, restons prudents, que Robert Well-Bébert et lui étaient de mèche, qu’il avait confondu l’exercice de sa fonction publique avec des intérêts privés et que ce genre d’affaire révélant une police profitant de ses privilèges pour servir, hors de tout cadre légal, des relations particulières n’avait pas bonne presse actuellement. Enfin, je lui demandai s’il comprenait à présent pourquoi il allait enterrer l’affaire des fleurs et avant qu’il ait pu répondre, j’ajoutai en toute hâte que, de toute manière, franchement, cette histoire était absurde, qu’il savait très bien que ces gens n’étaient coupables de rien, qu’il n’allait tout de même pas mettre en danger sa carrière pour une vengeance aussi injuste que futile et que, s’il se préoccupait pour mon avenir, qu’il ne s’inquiète plus car je souhaitais profiter de cet entretien pour lui remettre séance tenante ma lettre de démission (ce que je fis). Il réfléchit quelques instants, jeta un coup d’œil à ma lettre sur son bureau, me regarda en silence, puis me dit : « Sortez de mon bureau, Fall » (ce que je fis aussi, mais le cœur gros, en me disant que, peut-être, la rue des Clarté saurait me consoler).