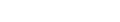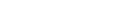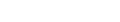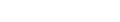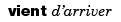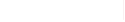Selon Didier Fassin et Richard Rechtman, le traumatisme « dit le lien douloureux qui relie le présent au passé. Il établit la justesse des plaintes et la justice des causes. Finalement, il délimite la manière empirique dont les sociétés contemporaines problématisent le sens de leur responsabilité morale à l’égard des malheurs du monde. » Telles sont les dernières lignes de L’Empire du traumatisme paru en 2007. Les auteurs y retracent la double généalogie, psychiatrique et psychanalytique d’un côté, sociale et juridique de l’autre, qui a progressivement transformé le concept de traumatisme en « notion de sens commun ».
Le traumatisme occupe dans nos discours, dans notre regard sur le monde, une évidence qu’il n’avait pas il y a encore une vingtaine d’années, suscitant désormais notre immédiate sympathie pour celui qui l’a subi. Car le traumatisme ne désigne plus tant la blessure laissée dans l’inconscient par une excitation dont l’appareil psychique ne parvient pas à réduire l’excès en la liant en représentations [1], phénomène forcément variable selon les psychismes individuels, qu’un événement objectivement insoutenable vécu soit par un seul (accident, viol, torture, etc.) soit collectivement (tsunami, bombardement, massacre, etc.). Reconnu dans sa réalité événementielle presque indépendamment de l’histoire du sujet, le traumatisme transforme l’individu qui l’a subi en victime disposant de droits à la réparation, qu’elle soit thérapeutique, symbolique, économique, judiciaire, politique, ou tout cela à la fois.
La littérature (prise dans sa plus grande extension possible) connaît depuis toujours ce type d’événement : elle le représente, l’exprime, l’évoque, le dénonce, etc. ; et l’on peut même se demander si elle n’a pas organisé certains de ses styles, de ses genres – la tragédie – ou de ses figures – l’hypotypose – autour du scandale et de la menace dont l’existence du traumatisme défiait la culture.
Sans exclure les débats que ce premier constat peut faire naître, on se propose toutefois d’élargir la question en revenant, aussi précisément que possible, à la (ou aux) définition(s) psychanalytiques du trauma, c’est-à-dire en envisageant les rapports entre trauma et littérature sous deux aspects qu’on pourrait dire paradoxalement plus ordinaires et plus partagés que celui qu’entraîne la définition événementielle du traumatisme.
Le premier, non sans lien avec ce qui s’est débattu depuis Aristote sous le nom de catharsis, serait la fonction de guérison ou de réparation à l’égard des traumatismes subis individuellement ou collectivement, qu’on envisage la question du côté de l’individu (auteur comme lecteur) ou du collectif (public).
Le second mettrait en avant la fonction symbolique de la littérature en tant que pratique culturelle susceptible de nourrir le psychisme de ceux qui la partagent, de façon à développer leurs défenses à la fois affectives et critiques face à toute espèce d’agression traumatique : on peut penser par exemple à la menace que la mort, et les morts, font peser sur le lien social, dans quelque société que ce soit, comme nous l’enseigne l’anthropologie. Mais on pourrait aussi penser au cas de l’adolescence, étape de la vie marquée par l’agression pubertaire, proprement traumatique : et toutes les sociétés ont inventé des solutions culturelles pour encadrer ce passage. L’enseignement de la littérature n’a-t-il pas ici un rôle à jouer ?
Hélène Merlin-Kajman
Ce texte constitue l'argument d'une table ronde de Transitions, « Littérature et trauma », qui a lieu le 17 juin 2017 et dont le programme complet est disponible ici.
[1] Freud, Au-delà du principe de plaisir