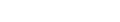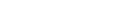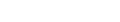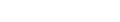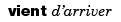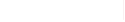Présents : Marie-Hélène Boblet, Stéphanie Burette, Mathias Ecoeur, Linda Farès, Mathilde Faugère, Catherine Gobert, Julia Gros de Gasquet, Virginie Huguenin, Tania Leite, Sarah Mouline, Hélène Merlin-Kajman, Sarah Nancy, Nancy Oddo, Antoine Pignot, Clémence Rey-Sourdey, Brice Tabeling, Sandra Travers de Fautrier, Anne Régent, Manon Worms, Antonia Zagamé.
Bettina Ghio, doctorante en littérature française, présente son travail :
Mes recherches doctorales portent sur un « phénomène culturel » peu étudié dans les domaines des lettres : le rap français. C’est surtout la sociologie qui s’est intéressée à lui et a prêté une attention particulière au moment des émeutes des banlieues en 2005 : les textes de rap ont alors été perçus comme la preuve précieuse des tensions existantes dans la société française.
C’est justement à ce moment-là que j’ai commencé à m’intéresser au cas du rap, à ces textes qui circulent dans l’espace francophone, écoutés et produits par et pour la jeunesse française, principalement celle qui habite dans les banlieues défavorisées. Mais j’ai eu un premier tort : la tentation sociologique d’approcher ces textes exclusivement comme des « témoignages » de l’état d’âme de ces jeunes, témoignage de leurs conditions de vie ainsi que de leur ressenti des tensions qui traversent la société contemporaine. Erreur qui m’a fait au début passer à côté d’une approche autre que le rapport de ces textes au strictement réel.
C’est alors qu’une phrase m’a particulièrement interpellée. Il y a quelques années, le linguiste Alain Bentolila manifestait lors d’un entretien sa principale inquiétude au sujet de la langue parlée par les jeunes dans les banlieues défavorisées françaises, et mettait en garde enseignants, sociologues et linguistes, par une exhortation particulièrement intéressante : « Arrêtons de nous ébahir devant ces groupes de rap et d’en faire de nouveaux Baudelaire ! ». C’est qui est particulièrement intéressant, à mon avis, dans ces propos, c’est qu’en opposant rap et poésie, Alain Bentolila met finalement tous les deux sur un même plan de comparaison : le rap serait pour lui le « résultat littéraire » de la « langue appauvrie » parlée par un secteur de la jeunesse française.
A partir de cet aspect, qui me paraît « troublant », une première question m’est venue : comment se fait-il que ces jeunes, « si loin de la richesse de la langue », privilégient, avec le rap, une expression et une pratique par la langue, ou, pour le dire autrement, la langue comme pratique ? Il m’a semblé alors que la seule approche sociologique ne suffisait pas pour rendre compte de la complexité de ces textes où la question de la littérature et du « littéraire » me semble fortement présente.
Sans tenter d’évoquer ou de démontrer la qualité littéraire du rap, je voudrais alors tout simplement vous présenter quelques-unes de mes réflexions sur la question de la littérature dans le rap français.
Le rap est un genre musical qui est apparu dans le Bronx à New York au milieu des années 1970 à partir des pratiques culturelles – surtout de tradition orale – de la communauté afro-américaine. Sa diffusion en France dans les années 1980 par les radios associatives a permis que les jeunes des quartiers populaires s’approprient le rap dans un processus qui semble, a priori, de stricte identification avec la situation sociale des Noirs-américains et/ou aussi d’un phénomène de mode.
Je me suis intéressée alors aux premiers textes de rap qui apparaissent dans l’espace culturel français ; c’est-à-dire les premiers produits en langue française à être vendus chez les disquaires et écoutés par les jeunes. Je suis tombée ainsi sur deux disques, parus en 1990, considérés comme les « disques fondateurs » du rap français : la compilation Rappatitude !, et Y a pas de problème du rappeur Lionel D. Plusieurs textes de ces disques expriment une sensibilité particulière aux événements réunis sous la thématique « immigration » qui ont marqué la décennie 1980, comme le laissent voir notamment les titres « Les années 80 », « Pour toi le Beur » ou la lettre adressée à François Mitterrand « Monsieur le président » du disque de Lionel D ou « Enfants du ghetto » dans Rappatitude !.
De toute évidence, ces titres appellent l’approche socio-historique : ils renvoient aux préoccupations spécifiques de leur période de production. Comme le texte « Les années 80 » qui évoque, par exemple, le risque de racisme qui a caractérisé la décennie :
Car humains de ce monde, permettez si j’ose
Demander la raison d’une certaine chose
Est-ce que les couleurs ont une raison d'être ?
Pour certains c'est sûr, mais pour d'autres peut-être
[...] Parce qu'il y en a racistes au cœur bien trop froid
Bouffés par l'orgueil, de se croire les rois
Prétentieux bidons à la mauvaise couronne
Les années 80 m'étonnent.
Ou « Pour toi le Beur » qui pénètre au cœur des tensions liées à l’immigration et particulièrement à la situation des immigrés maghrébins en France :
Il faut toujours que ton nom rime avec galère
Qu’on le confonde avec le mauvais sur cette drôle de terre
Ceci n’est pas pessimiste, mais juste réaliste
Un méfait commis quelque part, il y a ton nom sur la liste.
Et aussi « Enfants du ghetto » qui évoque le sentiment de « ghettoïsation » des jeunes qui habitent les quartiers populaires :
Je rap mes angoisses et mes désirs
De mes amis qui n’ont pas leur place
Pourtant nous sommes l’avenir,
Les enfants du ghetto.
Le réel fournit le corpus sémantique de ces textes, cela est indiscutable, pourtant ce n’est pas leur seul et unique intérêt. Si nous observons les deux premiers textes, nous remarquons, d’abord, la rime des vers dont le modèle de départ est l’alexandrin et dont la structure dialogique rappelle, en plus, celle d’une pièce de théâtre classique. Par exemple, dans le deuxième texte, le « je » énonciateur se retourne à un moment vers un public «
» et l’interpelle par le « messieurs-dames », ce qui évoque le cadre d’une scène de théâtre : « Une réflexion s'impose, messieurs-dames je vous dis / Ces êtres sont humains, il doit en être ainsi ».
Ensuite, nous retrouvons une série d’éléments qui insistent sur le choix exclusif de la rime pour la construction du texte. Ainsi, dans « Les années 80 », le rappeur assume non pas le rôle d’écrire ou de parler sur son temps, mais celui de (le) « rimer » et de (le) « rapper », délimitant de cette manière la frontière entre un usage « général » ou « ordinaire » de la langue et un usage « poétique ». Ce qui rappelle, en un sens, la conviction de Paul Valéry, exprimant en tant que poète la différence entre un usage « inconscient » et « conscient » de la langue. Pour lui, « l'usage poétique est dominé par des conditions personnelles, par un sentiment musical conscient, suivi, maintenu... ».
Nous retrouvons dans le disque Rapattitude !, des références au paradigme poétique encore plus intéressantes. Deux textes « La formule secrète » du groupe Assassin et « Je rap » de Suprême NTM tournent autour des attributs poétiques que les rappeurs associent à leurs textes. Le premier insiste sur le caractère « magique » en même temps que « meurtrier » des rimes, comparant la poésie du rap à une sorte de « potion magique » qui pénètre les esprits :
Meurtrier à souhait au cœur d'assassin
C'est encore lui et pour vous il revient
Oui je suis le mec que l'on appelle Rockin'Squat
Ma poésie fuse et mes rimes matraquent
Le métaphysicien de l'écriture est en action
De Paris 18ème je t'envoie cette nouvelle potion
Donc rentre dans cette rythmique des plus poétiques.
Le deuxième, par contre, sur leur aspect ludique semblable au jeu d’enfant :
Je reprends
Adaptant l’élément
Contrôlant, dominant la prose,
Elle brille débridant son degré
Arrachant chaque effet
Le dégustant tel un mets
Ma bouche gronde
Virtuose
Oui, j’ose, puis pose
Je joue, roule, danse, phase
Avec les phrases
Je rap.
Dans son dictionnaire de poétique, Michèle Aquien (1993) insiste précisément sur les liens étroits qui rattachent la poésie à l’inconscient, et qui relient justement poésie et enfance, d’une part, et poésie et rêve, d’autre part. Le travail sur les mots qui se fait par la poésie rappelle ainsi le premier contact avec le langage dans l’enfance, c’est-à dire, « ce premier plaisir qu’il a procuré (pêle-mêle : plaisir de prononcer, d’énoncer, de maîtriser) ». En même temps, la poésie ressemble à un état de rêve, car elle permet un certain « écart » entre monde réel et monde « magique » ou imaginaire, et établit un contact entre la vie et les « choses cachées ». En bref, le langage poétique est d’une certaine façon analogue à ce que la psychanalyse observe dans le mot d’esprit, le rêve, la parole échappée ou le discours des analysants sur le divan, qui permettent de faire surgir des mots par paronomase, anagramme, etc...
Nous pouvons alors observer ces attributs du langage poétique dans ces deux textes. La métaphore enfantine sert précisément à qualifier la démarche poétique du rap dans « Je rap », comme nous pouvons l’observer dans les trois derniers vers. Ils évoquent de toute évidence le plaisir chez l’enfant qui commence à maîtriser le langage, ce moment où il est en train d’acquérir ses conventions et où, en même temps, il trébuche, il utilise des mots à côté, inventés dans un moment de babillage. L’aspect « magique », ou d’instant de rêve, apparait dans « La formule secrète » par le lexique du texte, par le fait de percevoir le rap comme une « potion » et par des formules du type : « je rentre dans ton esprit, puis j’en ressors, puis j’y reviens ».
Je voudrais signaler également un autre élément qui m’a particulièrement interpellée dans les textes cités dans cet exposé. Outre la forme qui renvoie au paradigme poétique, l’attitude des rappeurs renvoie également à une sorte de « conscience littéraire » ou « poétique ». Je m’explique : les textes insistent sur « la grandeur poétique » du rap et le rappeur exalte sa propre maîtrise de la rime, tout comme son rôle de rimeur. Cet aspect prend deux formes bien distinctes :
D'un côté, comme par exemple dans « Pour toi le Beur », le rappeur envisage sa démarche comme une sorte de « vocation littéraire », voire d’« appel à caractère divin », où sa parole recouvrerait une « obligation morale » :
Et le métis rappeur que je suis connaît bien son devoir
Celui de dénoncer, de crier sur cette injustice
Portraitiste d'une société d'égoïstes.
Idée que Lionel D. développe encore dans « Rappeur » :
Je passe mon temps à rêver, plein d'espoir et d'illusion
Je fais de mon mieux, je suis sincère un peu comme une mission
Pour le reste : la discrétion est de mise.
Je te donne mes rimes, et toi aussi elles te rentabilisent
C'est pour cela que j'y crois et tu vois
Je ne m'arrêt'rai pas, c'est comme ça
Longue est la route pour aller vers toi
Mais j'ai les mots qu'il faut pour ça
Car je suis un... tu sais quoi ? Rappeur.
Ou dans « Les mots », où il insiste sur son « devoir » de rappeur au service de son auditeur et de la rime : « Maître de cérémonie, rappeur pour te servir / Pour te servir des mots si forts que tu vas réfléchir ».
Cette question rejoint celle de « la virtuosité verbale », comme en rendent compte les textes de Rappattitude !, par des énoncés du type : « Le métaphysicien de l’écriture est en action » ; « Le moment où la musique, les mots / S’entrechoquent, se croisent/ Là où quand j’écris ces phrases/ Je puise l’extase », « ma poésie t’instruit », parmi d’autres dans « La formule secrète ». Dans « Je rap » nous retrouvons les vers suivants : « Je rap, phase, façonne la phrase / Caressant, domptant, sculptant les mots / Je maîtrise, que dis-je, j’excelle ! » qui rappellent sans doute la virtuosité verbale du personnage d’Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac : « Je fais, en traversant les groupes et les ronds / sonner les vérités comme les éperons », une sorte de « pédantisme verbal » de la part du « je » énonciateur qui concerne son art de bien maîtriser les mots.
Mais surtout, il me semble que le texte « Je rap » rend compte essentiellement de cette « vocation littéraire » du rap :
Relancé par le flot
J'instaure la prose
Prose, symphonie des rimes
Rehaussant avec prestance
La qualité des mots
Oui des mots qui orchestrent ma musique.
Le jeu du lexique musical et poétique paraît évoquer, d’une certaine façon, un besoin littéraire latent qui serait désormais satisfait grâce au rap. En « instaurant la prose », le rappeur indique qu’il établit la pratique du rap dont le texte constituerait la base fondamentale. Ce n’est donc pas le « côté musical » qui est mis en avant dans le rap, mais la parole : les mots « orchestrent cette musique » et l’éloquence devient son outil indispensable. La maîtrise des mots apparait comme l’atout premier pour que les mots arrivent, braves, aux oreilles des auditeurs pour leur faire sonner « les vérités » : « Par ma voix, mon rap devient puissant / Il est présent / Il te prend / Il t'enlace ». Le texte insiste également sur « l’effet » produit sur l’auditeur, car il cherche à le toucher dans son émotivité, voulant se substituer, d’une certaine façon, aux discours sociologiques et/ou politiques : « Évitant toute erreur / J'attaque avec saveur / Fouettant l'auditeur /Le touchant en plein cœur ».
Comme je l’avais signalé, il n’a pas été question ici d’insister sur les qualités littéraires de ces textes, ni d’ouvrir le débat sur la place du rap dans la littérature. Je n’ai pas essayé non plus de considérer ces rappeurs comme de nouveaux Baudelaire. Le but de ma démarche a été tout simplement de montrer la présence des aspects de la littérature dans ces textes, et, de plus, le fait que cette présence apparait comme « consciente ».
Parmi les premiers chercheurs à s'intéresser au phénomène du rap français, Georges Lapassade et Philippe Rousselot avaient déjà signalé la question littéraire. Pour eux, le rap français serait lié à son « passé » littéraire, à la différence du rap américain qui renouvelle des pratiques langagières de la jeunesse afro-américaine. Ils reconnaissent ainsi le rap « dans une tradition littéraire où avant les rappeurs, il y avait, par exemple, la poésie glaciale et désabusée de Villon ou la poésie folle de colère d'Agrippa d'Aubigné ».
Si j'ai parlé ici des premiers textes, c’est parce, d’un côté, ils présentent des caractéristiques qui resteront dans le rap, se reproduisant et se recréant sous des formes diverses et variées jusqu'aux raps de nos jours. Mais c’est surtout parce, en tant que précurseurs, ils rendent compte de l’univers qu’ils installent : un univers qui « appelle », si l’on peut dire, « la littérature ». Nous avons vu que la tournure et la forme de ces textes puisent en partie dans la tradition poétique française, et en ce sens le verbe du rap ne serait pas solitaire. Il s’inscrit dans cette continuité que Roland Barthes (1956) signale pour toute écriture qui se consomme dans « une familiarité rassurante », car elle est un compromis entre une liberté et un souvenir et remue tout un système : puisque même si elle est personnelle, elle n'est pas solitaire.
Souvenir de la langue et entrée dans une langue littéraire, deux aspects qui jaillissent de l’étude de ces textes. D’une certaine manière, le rappeur met les mains dans la « pâte littéraire », qu’il « façonne », « caresse », « sculpte ». L’écriture lui était jusqu’à présent un « domaine » hostile, comme en rend compte encore une fois « Je rap », qui mobilise d’ailleurs la métaphore du fauve et le langage du dompteur, pour vanter finalement la capacité du rappeur à « dompter », à « contrôler », bref à « maîtriser » la forme poétique qui serait désormais sa proie.
Discussion :
Sarah Nancy : Ce qui est passionnant dans cette approche, et qui enrichit notre réflexion sur la littérature, c’est qu’elle permet de s’interroger sur le « surplus » qui fait qu’un texte est littéraire, sur la littérarité, et cela de manière dynamique. Car, de toute évidence, ces textes témoignent d’une recherche, d’un désir de faire quelque chose de beau avec le langage, que nous sentons même si cela ne rejoint pas notre goût. Cette approche invite à réfléchir sur le geste littéraire.
Bettina Ghio : Je suis en effet sensible au geste d’écriture. Je rapporte cela à ce qui m’a d’abord marquée dans l’écoute du rap et aussi lorsque j’ai découvert ces pratiques, notamment lors d’un stage dans un centre culturel : le moment de l’écriture était très fort, et très physique. Il avait quelque chose d’un plaisir enfantin. Cela invite à s’interroger sur ce qui pousse à vouloir entrer dans la langue, à jouer avec.
Hélène Merlin-Kajman : Je reviens sur ce que vous avez appelé votre « erreur » initiale : l’erreur d’adopter une perspective sociologique sur ces textes. Je voulais vous demander si l’approche littéraire que vous avez finalement choisie vous a aussi reconduite à une approche sociologique, mais pour la modifier. Car, après tout, ces textes ne posent pas seulement la question de l’écriture, mais aussi celle de leur diffusion sociale. Or il me paraît difficile de ne penser cela qu’en termes de « plaisir d’enfance » – ou alors il faut parler de « jeunesse », d’« ardeur de la jeunesse » car il y a quelque chose de violent dans ces textes, et qui plaît aux jeunes en tant que tel.
Bettina Ghio : Ce que je voulais mettre en valeur avec cette idée de plaisir « enfantin » c’est surtout son sens métaphorique d’entrée dans la maîtrise de la langue (notamment poétique). Il me semble que ces premiers textes parlent du plaisir (mais aussi d’une certaine fierté) de réussir à maîtriser la langue française dans une forme littéraire. Et cela est d’autant plus intéressant que cela a lieu dans un contexte de forte tension avec la langue et la culture françaises, qui se manifeste notamment par l’échec scolaire. En même temps, je reconnais que, dans ces textes, il y a des affects violents, comme la colère, la rage, et qu’alors l’image enfantine est moins pertinente que la référence à la jeunesse en lutte, l’adolescence.
Quant à la question sur ma perspective sociologique, l’approche littéraire m’a fait revenir sur elle mais avec une observation différente. Par exemple, je m’intéresse tout particulièrement à la représentation du milieu urbain dans le rap et j’ai pu constater qu’elle est investie d’images et de figures qui ne correspondent pas exactement à celles montrées par les mass-médias ou les études socio-urbanistiques, mais qui sont les mêmes qui apparaissent dans ce que l’on appelle le roman urbain contemporain. En même temps, les effets de réel qu’acquiert cette représentation ont, selon moi, des accents de Jules Vallès. Les aspects sociopolitiques sont donc articulés dans mon travail avec la question littéraire.
Stéphanie Burette : T’a-t-il été possible, justement, de repérer quels étaient les textes littéraires repris par les rappeurs ?
Bettina Ghio : Il s’agit, dans une grande majorité, de textes scolaires, comme « Le Dormeur du val », des références à Molière ou aux fables de La Fontaine ou au personnage Cyrano de Bergerac qui revient plusieurs fois. Après, il y a un secteur du rap où l’on peut constater l’influence des auteurs piliers des textes francophones. On repère surtout la tradition de la chanson française, comme dans les « lettres au président » qui renouent avec « Le Déserteur » de Boris Vian ou « Déserteur » de Renaud, par exemple. Ces influences montrent un aspect souvent ignoré du rap : son inscription dans une continuité.
Stéphanie Burette : Le principe de cette intertextualité serait ainsi de permettre à chacun de reconnaître des choses qu’il connaît.
Bettina Ghio : Je crois que cette intertextualité conteste surtout l’idée de « ghettoïsation » que l’on attribue souvent au rap quant aux références culturelles qu’il véhicule et son positionnement face à la langue française. Plusieurs rappeurs ont confirmé, d’ailleurs, dans des entretiens que la pratique du rap a éveillé chez eux le plaisir de la lecture et de la connaissance de la langue, par exemple, ils revendiquent souvent l’emploi du dictionnaire. En même temps, il y a une autre forme d’influence : on repère dans certains textes des accents de Céline, sans que l’on puisse reconnaître la lecture de Voyage au bout de la nuit. Plus qu’une référence consciente, on ressent une sorte de « communauté de pensée » ou « d’affect » : il y aurait comme des allers et retours entre la violence de la situation et la violence des textes.
Brice Tabeling : J’ai particulièrement apprécié la manière dont tu as réussi à défaire l’approche socio-historique, en dépit même du fait que ces textes l’appellent, la réclament. En même temps, je me demande si le réel historique et social ne fait pas retour d’une autre manière. Car au-delà du référentiel – sans doute les rappeurs ne se « bagarrent » pas – ils ne sont pas toujours comme ils le prétendent –, il y a bien un effet de plaisir de la violence réelle que perçoit l’auditeur. Le « ludisme » dont tu parles n’opère pas de n’importe quelle manière. On peut jouer pour faire violence. J’ai bien compris, en somme, que le but de ton travail n’était pas de se limiter à l’opposition témoignage / texte de plaisir, mais je demande si tu as pensé à cet effet d’un plaisir qui fait revenir le réel social.
Bettina Ghio: En fait, pour cet exposé, je n’ai pris que les premiers textes où ce côté ludique m’a beaucoup frappée. Et aussi, avant tout, j’avais à cœur de ne pas tomber dans le lieu commun de la violence verbale du rap : c’est la raison pour laquelle je n’ai pas cherché à aborder cette question.
Sandra Travers de Fautrier : La façon dont les textes de rap sont pris dans un contexte, et sont dépendants de la voix, du corps, m’évoque la poésie sonore. Je pense à Bernard Heidsieck disant qu’après sa mort sa poésie n’existerait plus. Le geste littéraire est rénové, pensé autrement. Cela expliquerait peut-être que le rap soit difficile à lire. À la différence de la poésie classique, il se soutient difficilement sans la voix.
Bettina Ghio: C’est évidement un aspect fondamental du rap, mais que je n’ai pas abordé ici. J’ai parlé ici seulement du texte, mais ce qui définit le rap en tant que tel, c’est un ensemble d’éléments où la force des phrases et la puissance de la voix des rappeurs servent à établir des variables de qualité. La performance que Paul Zumthor signalait à la base de toute poésie orale, on la retrouve de toute évidence dans le rap et c’est cela qui fait qu’un rap est difficilement imitable. Après, que le rap « soit difficile à lire », je n’en suis pas sûre. En 2000 et l’année dernière, les Editions de la Table Ronde ont publié des anthologies de rap que l’auteur a destinées « à tous ceux qui auront plaisir à en lire ».
Antonia Zagamé : Je me demande dans quelle mesure l’usage que fait le rap du littéraire ou de la littérature se distingue de celui qu’en fait la chanson. S’agit-il d’une appropriation sociologique plus forte ?
Bettina Ghio : Je pense que la différence tient surtout à la discipline que le rappeur s’impose sur la rime et l’emploi des mots. Si dans la tradition de la chanson française, cela existe aussi – je pense notamment à Bobby Lapointe et à ses jeux des mots – cela ne me parait pas être de rigueur. On peut retrouver d’ailleurs dans certains raps des critiques adressées à de mauvais rappeurs pour être de mauvais rimeurs. En même temps, la chanson peut être plus facilement interprétée par d’autres, ce qui n’arrive pas dans le rap dont la voix du rappeur est inséparable de son texte.
Virginie Huguenin : Ce qui m’intéresse, c’est le sentiment d’une présence des références littéraires qui ne passerait pas par la lecture. Il y aurait des expériences littéraires hors du livre, ce qui ne serait pas sans compliquer le travail !
Bettina Ghio : À ce propos me revient une référence à Céline et à la provocation de ses phrases : l’expression « sodomie verbale » chez NTM m’a notamment frappée. Peut-être que cela est à mettre au compte d’une même façon de concevoir le monde : haine, mépris, cela est commun à certains rappeurs et à Céline.
Linda Farès : Je suis frappée, pour ma part, par un autre aspect : car si tu as insisté sur la continuité des références, on peut aussi souligner l’effet de déterritorialisation, que l’on trouve aussi chez des auteurs francophones. Je pense au rappeur Kerry James, qui écrit :
« J’manie la langue de Molière, j’en maîtrise les lettres
Français parce que la France a colonisé mes ancêtres
Mais mon esprit est libre et mon Afrique n'a aucune dette. »
Peut-être s’agit-il de revendiquer les références littéraires pour les déplacer, se les réapproprier pour mieux les retourner contre la langue française.
Hélène Merlin-Kajman : Je repense, dans notre questionnaire sur la littérature, à la question portant sur l’appartenance (ou non) à la littérature de genres comme le rap, le slam, etc. De toute évidence, votre travail, s’il éclaire véritablement le rap de manière intrinsèque, complexifie ce type d’interrogation. On voit, par exemple, comment la thèse de Florence Dupont, selon laquelle les critiques contemporains auraient oublié le fonctionnement des événements poétiques et théâtraux de l’Antiquité (et, en conséquence, ne recourraient au postulat du sens et de la littérature que pour compenser l’absence d’événement) se trouve déplacée : ce que montrent les textes de rap, c’est que l’« événement » de la littérature peut se reproduire hors de son contexte d’apparition : qu’il y a de l’itération événementielle de la littérature, en quelque sorte. Cela complexifie, en conséquence, notre propre recherche : car suffit-il qu’il y ait référence explicite à la littérature pour qu’un texte soit littéraire ? Non, sinon, il n’y aurait que des discours (au sens de l’analyse des discours), pas de littérature.
Cela montre aussi que, contrairement à l’idée selon laquelle la littérature nourrit des préoccupations sociales pour les idéologiser de façon consensuelle (c’est ce modèle que convoque R. Barthes lorsqu’il prétend que c’est la littérature qui a « condamné » Dominici (« L’Affaire Dominici », dans Mythologies) : le modèle XIXe siècle, balzacien), l’inverse peut aussi se produire. Votre travail me fait donc éprouver une perplexité nouvelle face à la question du questionnaire que je viens d’évoquer. En fait, cela nous ramène à la question de la valeur. Si l’on entend la question comme une manière de demander s’il y a, dans tel ou tel genre, un « effort littéraire », on va répondre oui sans hésiter pour le rap ; mais cela n’éclairerait pas forcément notre recherche. J’aimerais aussi revenir à la remarque d’A. Bentolila évoquée tout à l’heure : n’est-ce pas en fait le même geste que de dire que les textes de rap sont « littéraires », mais à l’envers ?
Stéphanie Burette : Je me sens gênée par rapport à l’idée de la différence de valeurs. Peut-on apprécier la différence sans se rapporter à un panthéon d’auteurs ? Ne peut-on pas dire que le rap peut avoir de la valeur tout court, sans évaluer celle-ci à la valeur littéraire ?
Bettina Ghio : Au-delà de cette question de la valeur, ce qui m’intéresse vraiment est que ces textes prouvent que la littérature continue à être une pratique.
Hélène Merlin-Kajman : J’aimerais préciser ce que j’entendais par « complexification autour de la question de la valeur ». Certes, la notion de « geste littéraire » évoquée par Sarah Nancy au début de la discussion est convaincante, parce qu’elle libère d’une conception de la valeur en termes de « panthéon », et qu’elle empêche de s’en tenir au rejet de la littérature à laquelle conduit l’hypothèse de F. Dupont. Mais ce geste suppose d’être défini, et cela autrement que par des effets d’échos, de rimes, etc.
Julia Gros de Gasquet : Je me demande si le recours à la notion d’effet, au sens rhétorique, ne peut pas nous aider – l’effet en vue duquel le texte est produit, d’une part, et l’effet comme résultat, d’autre part. Les concerts visent à susciter un sentiment de révolte. En cela, le rap est une parole éloquente.
Sandra Travers de Fautrier : L’intention est en effet centrale et permet notamment de ne pas parler de valeur. D’un point de vue juridique, l’œuvre est ce qui est mis en forme, ce qui suppose une intentionnalité.
Brice Tabeling : J’éprouve de l’incertitude à ce sujet : l’intentionnalité suppose une maîtrise, un agent responsable, alors que l’effet peut être beaucoup plus confus. Même s’il y a un « je » exprimé dans les textes, il est difficile de prêter une intentionnalité à ce « je », alors que, de toute évidence, les phrases elles-mêmes ont un effet.
Sarah Mouline : J’aimerais revenir sur le rapport entre les textes de rap et la littérature assimilée à travers l’école (assimilation qui se voit, par exemple, à travers leurs noms : « Corneille »). Je me demande comment la violence des élèves se « positionne » par rapport à la violence de certains textes, comme certains textes longtemps censurés de Baudelaire, Céline, qui sont maintenant proposés à l’étude par l’Education nationale. On dirait que la violence est devenue académique.
Brice Tabeling : Je me demande si l’on a vraiment besoin de la question de la valeur. Ne peut-on pas la suspendre ? Quel intérêt y a-t-il à définir la littérature à partir de la valeur ? Poser la question du beau n’est pas poser celle de la valeur.
Hélène Merlin-Kajman : Je ne pense pas avoir affirmé qu’il fallait se la poser. Je m’interroge, simplement, car je constate que beaucoup de nos discussions tournent autour de cette question. Peut-être est-il temps de l’affronter. Par exemple, si le rap est de la littérature, alors pourquoi ne pas l’enseigner ? D’autre part, la question de la valeur, c’est aussi celle d’« avoir des valeurs », donc la question de l’éthique. Lévi-Strauss dit qu’il n’y a aucun critère pour comparer les cultures entre elles, mais qu’à l’intérieur d’une culture, on n’en est pas quitte avec la question de la valeur.
Stéphanie Burette : Le problème, selon moi, est que le postulat de la valeur crée de la hiérarchie, donc de l’exclusion. Pour préciser : ce que je voudrais, c’est pouvoir dire que le rap appartient à la littérature, et cela non pour l’intégrer dans un système de hiérarchie, mais pour rendre compte de l’effet important que j’éprouverais.
Hélène Merlin-Kajman : Mais la hiérarchie des choses n’est pas une hiérarchie des personnes, et prononcer des jugements de valeur, n’est pas censurer.
Stéphanie Burette : C’est précisément cela dont je ne suis pas certaine.
Brice Tabeling : Pour revenir à mon propre doute : le problème, pour moi, n’est pas l’exclusion produite par la valeur, mais la difficulté qu’il y a à fonder les valeurs. En littérature, il me semble possible d’assumer un relativisme total.
Hélène Merlin-Kajman : Cela m’évoque la réflexion de J.-F. Lyotard, dans Au juste, qui fait remarquer que la décision ne peut être dérivée d’un corps de descriptions, de réglementations. Ce qui fait qu’on choisit n’est pas justifiable.
Sarah Nancy : Pour ma part, je m’étonne des incertitudes qui s’expriment concernant l’intérêt de la question de la valeur. Il me semblait, en effet, que, dès le début du projet, la réflexion sur les usages de la littérature s’était située en quelque sorte dans un troisième temps qui assumait l’importance de cette question : il ne s’agissait évidemment pas de s’en remettre à un panthéon des valeurs, il ne s’agissait pas non plus de souscrire au relativisme (relativisme qui peut conduire à affirmer qu’il n’y a pas de littérature mais seulement du « littéraire »), mais d’affirmer que « tout ne se vaut pas ».
Stéphanie Burette : Je me demande si tout usage du verbe « valoir » pose vraiment la question de la valeur.
Mathilde Faugère : Pour revenir à la position relativiste défendue par Brice : cela signifie-t-il qu’on choisit les textes pour une visée extérieure à eux-mêmes ?
Brice Tabeling : Je suis moi-même tout à fait perplexe à cet égard.
Nous projetons de consacrer une séance prochaine à cette question de la valeur.