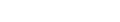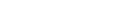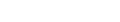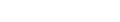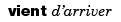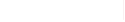n° 10 - M. Hersant, Chénier, Eschyle, Ronsard, etc. : les classiques en procès
Littérarité n° 10
Préambule
Le 23 juin 2018, nous recevions Marc Hersant au séminaire de Transitions pour discuter, entre autres matières, de « l'affaire Chénier ». Nous publions aujourd'hui le texte issu de son intervention, qui fournit une pièce précieuse au dossier : le texte, vif et virtuose, met (dans un même mouvement) à distance et en pratique la tentation judiciaire qu'illustrait la lecture de Chénier par les agrégatifs auteurs de la lettre-pétition. Marc Hersant récuse avec force le procès fait à Chénier et la possibilité même de lire « L'Oaristys » comme la représentation d'un viol. Plus largement – et plus crucialement, de son propre aveu et avis –, il conteste le « procès à épisodes » faits aux textes du canon, aux Classiques, dont la poésie de Chénier est à peine un exemple. Tout se passe, explique-t-il, « comme s’il fallait mettre sous surveillance et parquer dans un espace d’observation et de méfiance un certain nombre de textes du passé qui évoqueraient des réalités brutales que les historiens de la littérature, pour une raison au fond assez obscure (une admiration inconditionnelle et mécanique pour les textes canoniques ? Mais c’en est à peine un…), refuseraient de voir. » Se joue de nouveau ici une certaine conception de la littérarité, qui se révèle au fil des lignes et avec laquelle Transitions aime tout particulièrement dialoguer.
L. F.
Marc Hersant est professeur des Universités à l'Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, où il enseigne la littérature du XVIIIe siècle. Il est spécialiste des mémorialistes d'Ancien Régime et de l'écriture de l'histoire à l'époque classique. Il s'intéresse plus largement à la question de la vérité dans les discours du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, à l'analyse du récit et à la théorie de la fiction. Outre de nombreux articles, il a publié en 2009 Le Discours de vérité dans les Mémoires du duc de Saint-Simon chez Champion ; en 2015, Voltaire : écriture et vérité chez Peeters, et l'année suivante, une biographie remarquée de Saint-Simon chez Gallimard.
Chénier, Eschyle, Ronsard, etc. : les classiques en procès
Marc Hersant
06/07/2019
La réflexion que je propose ici part d’une expérience professionnelle récente, que je voudrais expliquer brièvement. Pendant l’année universitaire 2017-2018, j’étais chargé à l’Université Paris 3 de la préparation des agrégatifs de Lettres au programme de littérature française du XVIIIe siècle, la reproduction dans la collection « Poésie Gallimard » d’une édition dépassée et fautive des Poésies d’André Chénier[1], écrivain de la fin du XVIIIe siècle qui a longtemps été considéré, à tort ou à raison, comme le seul vrai poète de son époque et parfois même de son siècle dans sa totalité, mais qui est en réalité assez peu lu aujourd’hui, et dont la gloire a donné des signes d’usure. Cependant, il s’agit d’une œuvre difficile : pour la comprendre et pour l’apprécier à sa juste valeur, il fallait pour les étudiants qui se préparaient au concours installer l’écrivain dans un paysage littéraire mal connu, la poésie du XVIIIe siècle, s’approprier en partie sa connaissance intime de la poésie antique, avec laquelle Chénier dialogue constamment, au point que certains de ses textes sont criblés de moments de traduction ou de quasi-traductions de vers anciens, s’imprégner de toute une mouvance de la philosophie des Lumières dans laquelle Chénier s’était reconnu (très probablement ce qu’on met aujourd’hui sous l’étiquette des « Lumières radicales » et du matérialisme athée[2]), comprendre à partir d’influences disparates un mélange assez déroutant de libertinage et de sentimentalisme, redécouvrir un moment crucial de notre histoire (la Révolution Française et ses immédiats antécédents) auquel notre poète réagit parfois, dans les dernières années de sa vie, « au jour le jour », et j’en oublie sans doute dans le faisceau de connaissances susceptibles de rendre cette œuvre lisible et compréhensible, de la rapprocher de nous et de lui permettre d’atteindre nos sensibilités, de toucher nos cœurs, de rencontrer nos attentes esthétiques. Ce travail de contextualisation est ingrat. Il ne permet pas à lui seul de rendre les textes vivants, et seule une interaction constante entre toutes les sortes de savoirs que j’ai recensés et un ressourcement constant dans les textes permet éventuellement de se les approprier. Je dis « éventuellement », car bien des textes, même informés par un savoir immense, restent muets et ne nous parlent plus guère : ils restent prisonniers de leur époque et peinent à percer le mur du temps qui nous séparent d’eux. Les rares qui parviennent à nous atteindre et à nous concerner sont pour la plupart ceux qu’une longue tradition actuellement chahutée a recensés comme « classiques », comme chefs-d’œuvre qui méritent qu’on se fatigue un peu pour accéder à l’émotion, à la pensée, au sentiment d’accomplissement esthétique, qu’ils peuvent encore éventuellement susciter chez leur lecteur. Si un texte ne réussit plus à opérer ce transfert temporel, il n’a d’ailleurs aucune raison de rester dans le canon (ce qui ne l’empêche pas de garder une valeur documentaire : c’est ainsi que La Henriade, d’ailleurs déjà méprisée par Chénier[3], a fini par sortir du canon) ; s’il n’est pas considéré comme canonique mais parvient à atteindre et à concerner aujourd’hui des lecteurs, il a les meilleures raisons du monde pour faire son entrée dans le saint des saints. Le canon n’est donc pas un monument hiératique et immobile, une espèce de pyramide à la présence écrasante et même intimidante d’injonction d’admirer, mais un ensemble flexible et instable qui vit d’un dialogue constamment réactualisé avec le présent et avec ses exigences (émotionnelles, intellectuelles, esthétiques). Or, on assiste actuellement à une attaque de plus en plus fréquente de ce canon (autrefois pesamment sacralisé) sur plusieurs fronts : en particulier, les (ex) textes canoniques ne sont plus appréhendés avec une sympathie universelle et a priori, comme ils pouvaient l’être à l’époque de la religion de l’art, mais envisagés au contraire de plus en plus souvent avec un soupçon systématique et sommés de défiler comme autant d’accusés potentiels dans un procès (imaginaire, puisque les accusés sont morts) de racisme, d’homophobie, d’antisémitisme, de misogynie, de complicité colonialiste, etc. Loin d’être envisagés a priori comme des objets d’admiration et comme des sources de plaisir (intelligent et raffiné, cela va sans dire), ils sont soupçonnés d’avoir participé, sur une longue durée historique, au règne d’un mâle blanc et hétérosexuel dominateur et oppressif. Les autrefois intouchables Rabelais et Montaigne sont présentés, non certes sans arguments, comme des archétypes du mépris insupportable qui a accablé la femme sur la longue durée de l’histoire de l’Occident ; Voltaire, autrefois attaqué comme destructeur des croyances religieuses ou encensé comme apôtre de la tolérance et d’une version laïque du « aimez-vous les uns les autres », est accusé, non sans quelques raisons, de racisme, d’homophobie[4] et d’antisémitisme ; Rousseau passe ici pour pour un grand penseur du couple, là, non sans quelques raisons lui aussi, pour l’écrivain antiféministe par excellence confinant les femmes dans des rôles sociaux stéréotypés ; Le Marchand de Venise suscite fréquemment une sorte d’embarras dont les mises en scène accusent la pesanteur et le Mahomet de Voltaire, qui est pourtant une de ses tragédies les plus réussies, a attiré contre lui, sur un front totalement différent, l’hostilité des communautés musulmanes, puisqu’elle présente le prophète comme un imposteur cruel et cynique. Une représentation des Suppliantes d’Eschyle vient d’être empêchée à la Sorbonne au prétexte que la tragédie du grand poète grec serait « raciste » et que les choix de mise en scène accentueraient cette dimension. Un poème des Amours de Ronsard est dénoncé comme incitation au viol, ce qui n’empêche pas les œuvres de Sade, où l’incitation au viol est réelle et constante, et qui ne suscitent bizarrement pas de déchaînement sur ces divers fronts, d’autant plus qu’une légende tenace fait de Sade un auteur « féministe[5] », d’avoir connu récemment le triomphe d’une publication dans la « Bibliothèque de la Pléiade ». Et tandis que Notre Dame des Fleurs de Jean Genet, qui commence par une célébration du meurtre et des meurtriers, est dans toutes les librairies, c’est un poème du pauvre André Chénier, écrivain idéaliste et malheureux du dix-huitième siècle finissant, qui s’est retrouvé soudain sur le banc des accusés. Il faut dire que Jean Genet est un bon élève du canon qui y est entré comme il faut, c’est-à-dire par effraction : gay, propalestinien, chantre des travestis, icône de la culture « queer », il a droit, lui, à être joué sur toutes les scènes théâtrales les plus prestigieuses et à figurer dans les programmes d’enseignement. Chénier n’étant pas enveloppé dans une telle aura protectrice est, lui, devenu une nouvelle et assez improbable victime du procès à épisodes dont je fais état et ce, à propos, et qui plus est, non seulement d’un de ses textes les plus parfaitement insignifiants, mais d’un texte qui est à peine le sien, puisqu’il s’agit d’une traduction d’une idylle de Théocrite, peut-être même d’une espèce d’exercice scolaire, en tout cas la production d’un apprenti-poète de dix-huit ans faisant plus ou moins heureusement ses gammes. À la même époque, le poète Lebrun-Pindare, qui devait devenir un des grands amis de Chénier et communier avec lui dans le culte de la poésie ancienne, avait lui-même proposé une traduction en vers de la même idylle, présentée dans l’édition par Georges Buisson et Edouard Guitton des Œuvres poétiques de Chénier comme « une scène assez leste d’amour rustique, où est dépeint franchement, sans mièvrerie ni obscénité, mais avec une finesse malicieuse, le manège instinctif du désir conquérant et de la timide envie[6] ». Mais y a-t-il « timide envie » ou non ? Et vivre une « timide envie », cela protège-t-il d’être la victime d’un viol si la timidité est plus forte que l’envie, et si cette timidité oppose un barrage constant et sans failles à l’envie prédatrice du mâle qui vous harcèle ? À moins qu’il n’y ait pas d’envie du tout d’un côté, et une envie qui détruit toute résistance sur son passage de l’autre, auquel cas le viol est certain, et la représentation de viol avérée. Toutes ces questions sont des vraies questions, mais jusqu’à une époque très récente, et à propos de ce poème, on ne se les était pas posées. La lettre « ouverte », qui est à l’origine de cette espèce d’affaire est sans doute le premier lieu où elles se sont présentées comme allant de soi. Je voudrais d’ailleurs revenir sur quelques lignes qui concentrent ses enjeux et m’apparaissent comme particulièrement problématiques :
Étudiant⋅e⋅s en préparation du concours des agrégations externes de Lettres modernes et classiques, nous sommes nombreux⋅ses à avoir été interpellé⋅e⋅s et dérangé⋅e⋅s[7] par un poème figurant dans le recueil des Poésies d’André Chénier. En effet, nous nous sommes rendu compte que le poème « L’Oaristys », que nous avions immédiatement[8] identifié comme la représentation d’une scène de viol, était couramment interprété au prisme d’une « convention littéraire » qui évacue cet aspect et, par-là, toute interrogation sur le sujet. Après l’avoir évoqué et commenté en classe, il nous a semblé indispensable de bénéficier d’une clarification concernant ce type de textes mettant en scène des violences sexuelles, notamment dans le cadre de l’exercice de l’explication de texte. […] : nous souhaiterions une réponse claire et définitive sur l’attitude à adopter et le vocabulaire à utiliser pour décrire ces textes[9].
Par honnêteté, je dois tout de suite préciser ma position : la lecture du texte de Chénier/Théocrite comme représentation d’un viol me paraît totalement injustifiée, à supposer qu’on admette qu’on ne peut pas lire un texte de manière complètement libre et lui attribuer le sens qu’on veut, autrement dit si l’on admet que commettre des contresens sur un texte, en particulier des contresens orientés par une certaine manière de « vouloir lire », cela existe[10]. Mais je voudrais d’abord revenir sur le passage de la lettre/pétition que je viens de citer. On y lit notamment que le poème est « couramment interprété au prisme d’une “convention littéraire” qui évacue cet aspect » (la dimension de viol de la scène représentée). Ce qui est donc accusé, au-delà du poème lui-même (qui est cependant lui aussi une cible), c’est une tradition ou un consensus critique qui implicitement protégerait ce texte d’une lecture « juste » osant appeler les choses par leur nom, et qui, en l’occurrence, utiliserait le mot « viol » pour rendre compte de ce qui est représenté dans ce dialogue. Or, je suis obligé à contre-cœur d’utiliser une espèce d’argument d’autorité – j’ai lu la quasi-totalité de la critique sur Chénier pour préparer le cours d’agrégation de 2017-2018 – pour dire que ce qui est affirmé ici n’a aucun fondement. La réalité est que la critique n’a que très peu parlé de ce texte, qui n’a pas spécialement attiré l’attention des spécialistes et des commentateurs célèbres ou inconnus qui ont travaillé sur Chénier. Le plus souvent, il est commenté brièvement comme un indice de l’excellente culture antique de Chénier puisqu’il a traduit approximativement ce texte de Théocrite alors qu’il était encore très jeune. Et l’idée de viol n’ayant effleuré l’esprit d’aucun critique qui a commenté ce texte, ce n’est pas au nom d’une convention littéraire ou d’une érudition timorée que ce thème n’a pas été abordé, mais plus probablement parce que ce texte a laissé assez indifférents la plupart des critiques même les plus inconditionnels de Chénier. Le texte n’est donc pas « protégé », par une hypocrisie historiciste, d’une lecture juste (avec viol), et les agrégatifs qui ont écrit cette espèce de pétition sont sans doute les premiers lecteurs à l’avoir lu en faisant cette hypothèse qu’il y aurait ici peinture d’un viol, et soit dit en passant les premiers à l’avoir, pour cette raison discutable, mis sur le devant de la scène et suscité du coup autant d’intérêt[11] pour lui. Deuxième problème : le poème de Chénier est à deux reprises rangé dans une catégorie plus générale, d’abord dans celle d’un « type de textes mettant en scène des violence sexuelles » puis dans le pluriel franchement inquiétant de « ces textes » qui l’installe dans un ensemble de textes du même genre, c’est-à-dire de textes qui mettent en scène des violences sexuelles et que le conformisme critique traite comme si ce qu’ils représentaient était parfaitement innocent. Je remarque encore une fois que ce n’est pas un texte de Sade ou de Lautréamont qui est choisi, car on voit bien que tous les critiques qui s’en sont occupés appellent précisément un chat un chat et un viol un viol : qui nierait par exemple qu’il y a représentation multiple de viols dans Justine ? Je pense aussi et par exemple à un texte impressionnant de violence réelle envers la femme comme le poème « À celle qui est trop gaie » des Fleurs du mal, exemple saisissant de désir de renversement de l’acte sexuel en acte de meurtre : cette violence avait d’ailleurs, au terme du procès qui avait été fait à Baudelaire, mis ce poème au rang des pièces condamnées. Ce n’est donc pas un poème « sulfureux » qui a été choisi, et c’est ce qui me paraît le plus significatif et le plus intéressant. En effet, l’attaque porte non pas sur ce dont parlent les textes (même si c’est l’enjeu le plus apparent, même si le texte est présenté comme en lui-même dérangeant), mais sur la légitimité ou non de l’identifier clairement dans l’acte critique et plus spécifiquement dans sa version scolaire qu’est l’explication de texte de concours. Or, personne au concours ne sera choqué si, à propos du poème de Baudelaire dont j’ai parlé, l’idée de violence sexuelle est évoquée. La raison est tout simplement que dans le cas de Baudelaire, cette lecture est pertinente et que ce serait ne pas voir la violence inouïe de la relation à la femme qui y est décrite qui serait un impardonnable contresens. Le problème n’est donc pas de pouvoir ou de ne pas pouvoir parler de sexualité ou de violence sexuelle dans un oral de concours, et je dirai qu’en réalité dans notre travail de commentaire des textes nous ne cessons de parler avec beaucoup de liberté de sexualité (qui est après tout un des thèmes fondamentaux de tout ce que nous appelons « littérature »), et qu’on ne voit vraiment pas pour quelle raison on se priverait de parler de viol à propos de ce texte s’il y avait effectivement viol dans ce qu’il décrit. Le prétendu consensus décrit dans cette pétition n’existe donc pas – personne n’a jamais songé à dissimuler qu’il y a un viol dans ce poème puisque personne n’a jamais pensé avant les agrégatifs qui l’ont écrite qu’il y en a un – et la pudibonderie, s’il y en a une, est plutôt à chercher du côté des auteurs de cette pétition que du côté des enseignants et des critiques qui y sont attaqués. On doit revenir en effet sur la pesanteur sémantique du démonstratif de la fin du passage que j’ai cité, « ces textes », qui inscrit « L’Oaristys » dans une série, comme s’il fallait mettre sous surveillance et parquer dans un espace d’observation et de méfiance un certain nombre de textes du passé qui évoqueraient des réalités brutales que les historiens de la littérature, pour une raison au fond assez obscure (une admiration inconditionnelle et mécanique pour les textes canoniques ? Mais c’en est à peine un…), refuseraient de voir.
La réponse qu’on pourrait faire à cette pétition et à ses signataires, c’est donc que les érudits qui connaissent bien la littérature du XVIIIe siècle, lorsqu’ils refusent de voir un viol dans ce texte[12], ne le font pas au nom de je ne sais quelle convention molle, de je ne sais quel académisme bienséant et hypocrite, complice de diverses formes historiques d’oppression. Je vais d’abord laisser de côté le fait que ce texte est une traduction du grec ancien, même si j’en dirai un mot plus loin, pour l’envisager à l’intérieur des modèles culturels que les textes du XVIIe et du XVIIIe siècle nous donnent à voir. Or, toute la littérature de l’Ancien Régime nous met en face d’une évidence que j’ai presque honte de rappeler : les rôles sexués y sont fortement stéréotypés, et dans les premières approches, dans les premières parades sexuelles, l’homme est presque toujours en position de conquérant et la femme ou la fille en position de forteresse à conquérir. Il y a donc conventionnellement d’un côté un rôle d’attaque, et de l’autre, un rôle de défense, et c’est un premier point dont il me semble nécessaire de convenir qu’à l’intérieur de ce modèle culturel dont on pense naturellement ce qu’on veut, une conquête réussie, en ce sens que du côté de l’assiégé(e) la défense a suffisamment faibli pour s’avouer consentement ou a purement et simplement disparu, n’est pas un viol. Que ce soit l’homme ou la femme, celui ou celle qui prend l’initiative n’est pas un violeur si il ou elle obtient le consentement de l’autre. Aujourd’hui, cette initiative peut venir de la femme, même si selon les milieux sociaux et les éducations on peut observer de beaux restes du modèle ancien ; au XVIIIe siècle, il était absolument exceptionnel qu’elle vienne de la femme et l’homme était censé tacitement assumer presque obligatoirement ce rôle : il y a cependant un poème de Chénier également au programme qui illustre ce cas de figure, Lydé[13]. Une femme – espèce de vamp avant la lettre – s’y adresse assez brutalement à un jeune destinataire masculin pour l’attirer dans ses « filets amoureux » et le destinataire de son discours enflammé n’a pas la parole. Ce thème de la femme conquérante semble avoir vraiment intéressé Chénier car, en réalité, le texte du volume au programme est un « puzzle » de textes épars dans les manuscrits de Chénier qui traitent grosso-modo du même sujet et on retrouve ce genre de personnage féminin entreprenant dans certaines pièces de Marivaux comme Arlequin poli par l’amour. Mais pour revenir à des figures emblématiques de l’initiative masculine, Dom Juan, parangon de cet esprit de conquête appliqué à la sexualité, n’est pas, dans la pièce de Molière, un violeur et ne le devient, sauf erreur de ma part, que dans la première scène, absolument stupéfiante, de la tentative de viol d’Anna dans l’opéra de Mozart puis dans sa réitération avec Zerlina à la fin du premier acte. Le Dom Juan de Molière est un fourbe qui promet le paradis social et amoureux aux femmes qu’il séduit, mais elles sont « consentantes », comme on dit, et par conséquent, quoique trompées dans leurs illusions, elles ne sont pas violées. Le Don Giovanni de Mozart est lui un authentique violeur récidiviste. Dans le roman de Laclos, Valmont est peut-être un monstre, mais ce n’est pas un violeur, en tout cas pas avec la présidente – le cas de Cécile est beaucoup plus problématique. Il fait le siège interminable de Tourvel et finit par conquérir cette forteresse apparemment imprenable mais il n’engage aucun commerce sexuel avec elle sans son consentement : c’est une question de dignité libertine pour lui, et ce consentement est la condition de son succès plein et entier. Il l’abandonne certes de manière abjecte après l’avoir conquise, mais c’est encore autre chose. Crébillon met en scène dans plusieurs de ses œuvres le travail de conquête de l’homme et la résistance de la femme : il y a quelques années à l’agrégation était ainsi au programme son premier roman épistolaire monophonique, les Lettres de la marquise de M*** au comte de R***. Le roman ne nous donne à lire que les lettres de la marquise, jamais celles de son amant, mettant en scène d’abord, et très longuement, le personnage féminin dans son rôle conventionnel de résistance passant par un badinage ironique très brillant, puis cédant progressivement, s’abandonnant enfin à une véritable tempête amoureuse passant par des phases d’ivresse, d’effervescence, d’abattement, de jalousie et de désespoir, de séparation et de retrouvailles. Pas de viol non plus, donc. Hélène Merlin-Kajman, dans un des textes qu’elle a écrits sur ce dossier, tente une distinction entre « consentir » et « céder[14] » mais je ne suis pas absolument certain que cette distinction vaille pour le texte de Chénier, pas plus que pour ceux de Molière, de Laclos ou de Crébillon dont j’ai parlé. Les femmes de ces œuvres de fiction ne se contentent pas de céder, elles consentent, et il en est de même, j’essaierai de le montrer, de la femme du dialogue poétique de Chénier.
La première chose que j’opposerai à la lecture qui est faite de ce texte comme viol est donc qu’il voit un refus de la jeune femme qui y est mise en scène là où on peut la voir dans le rôle conventionnel de résistance que jouent la marquise de Crébillon ou la présidente de Laclos qui résistent aussi longtemps qu’elles peuvent avant de consentir, parce qu’il en va de la dignité et de l’honneur de la femme de ne pas se donner trop vite : cette résistance passe forcément par la multiplication d’actes verbaux de refus provisoire, point commun entre la marquise de Crébillon, la présidente de Laclos et la petite Naïs du poème archi-mineur qui nous occupe. Ce n’est donc pas parce que, dans la dynamique de l’échange, il y a réitération des refus de la femme qu’il y a viol au moment du passage à l’acte : il n’y a viol que si ce refus est maintenu jusqu’au bout, si aucun consentement ne vient effacer les refus antérieurs, et si l’homme oblige la femme à l’acte sexuel alors qu’elle n’a d’aucune manière donné son accord. Le problème en ce qui concerne ce poème, c’est que l’accord le plus net n’est donné par la jeune fille que juste avant la consommation de l’acte sexuel, et qu’il y a avant cela, au fil du poème, ce que notre époque appellerait des « attouchements » : j’y reviendrai. Mais partons de la fin. La réplique qui indique que l’acte sexuel est accompli est celle du vers 86 : « Ah ! méchant ! qu’as-tu fait[15] ? ». Vu le badinage entre les deux tourtereaux qui suit, il est difficile d’interpréter cette réplique comme celle d’une femme sous le choc d’un viol qu’elle viendrait de subir, et elle semble plutôt l’ultime tentative de la femme qui a consenti de se décharger de la responsabilité de l’acte sexuel en l’attribuant entièrement au protagoniste masculin. Or, juste avant le passage à l’acte lui-même, on note un signe incontestable d’acquiescementà la réalisation de l’acte sexuel. La réplique de Naïs est la suivante :
Ah !… Daphnis ! je me meurs… Apaise ton courroux,
Diane.
On peut évidemment nier l’évidence, car le poème est court, et les choses vont vite. Mais cette réplique est un acte verbal de consentement. « Mourir » est utilisé ici dans le sens de « défaillir » et sans aucune ambigüité il ne s’agit pas d’une ultime résistance mais d’une conscience qu’on est en train de s’abandonner et qu’on y prend du plaisir. Il y a mille occurrences du verbe « mourir » dans ce type de contexte, dans une littérature libertine ou non, et ce n’est pas un consensus mortifère des historiens de la littérature qui m’amène à en juger ainsi, mais une pratique régulière de la littérature ancienne qui fait de cette manière de comprendre le verbe « mourir » une sorte d’évidence. Quant à l’adresse à Diane, elle est claire : la jeune femme s’adresse à la gardienne de sa virginité pour s’excuser, et si elle craint sa colère, c’est bien, non seulement qu’elle consent, mais qu’elle assume une part de responsabilité dans le passage à l’acte. Ce n’est pas la colère de Diane contre son amant qu’elle évoque, mais bien celle de la déesse contre elle-même. Le vers de l’idylle de Théocrite est d’ailleurs encore plus clair sur ce point puisque la jeune fille s’excuse auprès de Diane de lui être infidèle, ce qui donne en traduction : « 0 Diane ! Ne te fâche pas ! Je te suis infidèle. » Et cette infidélité est bien celle de la jeune femme, et pas de son « assaillant ». N’oublions pas que c’est un Chénier « jouvenceau » de dix-huit ans traduisant d’assez près son cher poète grec qui est l’auteur de ce texte français. Conformément à ce qui se passe dans le poème de Théocrite, même si c’est de manière moins explicite, Naïs est dans la version française infidèle à Diane en renonçant à la chasteté et en s’abandonnant avec une ivresse à laquelle elle ne peut pas résister au plaisir charnel. Alors bien sûr, comme nous sommes dans une culture de la domination masculine sur la femme, on peut aller jusqu’à penser que tout acte sexuel entre homme et femme, sous l’Ancien Régime, est un viol. On peut aussi hésiter à aller si loin.
Avant la consommation de l’acte sexuel, il y a certes, comme je l’ai déjà signalé, plusieurs passages qui correspondent assez bien à ce qu’on appellerait aujourd’hui des « attouchements », et même quelque chose de plus, il faut bien l’admettre, puisque des parties du corps de la jeune femme sont sans son accord dénudées par l’entreprenant berger. Cependant, ces « attouchements » sont eux-mêmes précédés d’une réplique où la jeune femme avoue que ce qu’elle craint, ce n’est pas tant la consommation de l’acte sexuel que la colère de son père (« Mon père le verrait »), ou encore le surgissement d’un tiers qui serait le témoin de la scène amoureuse. En traduisant ces répliques dans la langue actuelle de tous les jours, cela donnerait à peu près, en édulcorant : 1) « J’ai peur que Papa ne soit très fâché » ; 2) : « Tu es sûr que personne ne va nous surprendre ? ». Naïs a également concédé un peu plus tôt qu’un mariage ne serait finalement pas une mauvaise idée (« Il est vrai, ta famille est égale à la mienne »). Elle a multiplié les signes du fait qu’elle est à la fois tentée et effarouchée (ce que les annotateurs Buisson et Guitton appellent avec leur gros bon sens de connaisseurs et de spécialistes, je le rappelle, une « timide envie »). On peut donc sans trop d’exagération interpréter ces « attouchements » comme les hardiesses de celui qui comprend qu’elle est en train de consentir et en tire les conséquences de manière un peu leste (mais n’oublions pas que Chénier est imbibé de littérature libertine : ce serait un autre dossier à ouvrir[16]), non comme les violences de celui qui saurait pertinemment qu’elle ne consent pas, et se lancerait malgré tout dans lesdits « attouchements ». La différence est peut-être ténue, mais elle est importante, et me semble suffisante pour justifier l’idée de viol à propos d’un texte comme La Nuit et le moment de Crébillon[17] et la repousser pour ce poème de Chénier. N’oublions pas en outre que ce texte est aussi une traduction/adaptation d’un poème antique et que l’idylle de Théocrite se termine par un retour à la narration, autre élément qu’il faut mettre au dossier, dont la traduction donne ceci :
Ainsi murmuraient tout bas ces jeunes amants au milieu de leurs doux ébats. Le couple furtivement uni se relève : la bergère retourne vers ses brebis, la rougeur sur le front, mais la joie dans le cœur, et Daphnis, fier de sa conquête, rejoint gaiement ses taureaux[18].
Si Chénier n’a pas traduit ces derniers vers, ce n’est pas pour changer le sens du poème original, où les mêmes attouchements se produisent, et où il est bien question, non de viol, mais de conquête. C’est plutôt parce qu’il voulait conférer au poème la pureté formelle d’un dialogue de type théâtral de bout en bout, que le fragment narratif de Théocrite venait briser. Si la jeune femme de Théocrite a « la rougeur sur le front mais la joie dans le cœur », on ne voit pas pourquoi la jeune femme de Chénier serait, elle, la victime de cet acte sinistre et odieux qu’est un viol. Le couple « furtivement uni » est-il devenu, en passant du grec au français, un duo constitué d’un violeur et de sa victime ? L’hypothèse est difficile à soutenir. Soit il y a viol chez Théocrite, soit il n’y a viol ni chez Théocrite ni chez Chénier, mais je ne vois pas l’ombre d’un argument à donner pour qu’il y ait viol chez l’un, et non chez l’autre.
Trop d’arguments tuent l’argumentaire, peut-être, et à quoi bon les entasser ? Mais dans ce procès, l’accusation a l’initiative, et une accusation très grave, puisqu’elle consiste à essayer de nous convaincre que conquérir (de manière certes pressante) le consentement d’une femme et la violer sont une seule et même chose, l’accusé dans le procès étant triple : l’homme de manière générale (disons le mâle occidental hétérosexuel) ; la littérature ancienne comme témoin et complice de l’écrasante domination de la femme par ce dernier ; l’interprétation prétendument hypocrite des textes anciens par des historiens de la littérature présentés comme les cautions savantes d’une interprétation « molle » des textes qui refuse de voir l’évidence (donc le viol) en face. Or, une chose qui mérite d’être remarquée, c’est que d’autres poèmes de Chénier abordent le thème du viol de manière explicite, et qu’ils le font toujours de manière fortement dramatisée et avec une condamnation sans ambiguïté de la violence sexuelle. Qu’attendre d’autre, d’ailleurs, de celui qu’on appelle traditionnellement le « doux Chénier » ? Dans le poème L’Aveugle, qui, contrairement à « L’Oaristys », est souvent considéré comme une des pièces maîtresses de l’œuvre du poète, le combat des Centaures et des Lapithes a pour origine la tentative de viol de la femme d’un Lapithe par le Centaure Eurytus. La description du massacre qui suit, débauche d’énergie virile et sanglante, est encensée par plusieurs critiques comme une des manifestations les plus frappantes du génie épique de Chénier, et répond directement à la brutalité bestiale de la provocation initiale.
Enfin, l’Ossa, l’Olympe et les bois du Pénée
Voyaient ensanglanter les banquets d’hyménée,
Quand Thésée, au milieu de la joie et du vin,
La nuit où son ami reçut à son festin
Le peuple monstrueux des enfants de la nue,
Fut contraint d’arracher l’épouse demi-nue
Au bras ivre et nerveux du sauvage Eurytus.
Soudain, le glaive en main, l’ardent Pirithoüs
« Attends ; il faut ici que mon affront s’expie,
» Traître ! » Mais, avant lui, sur le centaure impie,
Dryas a fait tomber, avec tous ses rameaux,
Un long arbre de fer hérissé de flambeaux[19].
Mais surtout, à la fin des années 1780, Chénier avait ébauché un grand poème sur le thème de Suzanne, le personnage de l’Ancien Testament, victime d’une tentative de viol par deux vieillards libidineux un jour où son mari est absent. Le viol est même le sujet principal du poème et l’épisode de la tentative de viol son épisode le plus important, du moins dans les lambeaux de textes qui nous sont parvenus. Or, le viol est l’objet d’une condamnation évidente dans le poème, alors qu’on ne trouve strictement rien de semblable dans « L’Oaristys », tout simplement parce que Chénier lui-même n’avait pas songé une seconde que ce ballet de jouvenceaux émoustillés pouvait être interprété comme une scène de viol. Le début de Suzanne en revanche donne le ton :
Je dirai l'innocence en butte à l'imposture,
Et le pouvoir inique, et la vieillesse impure,
L'enfance auguste et sage, et Dieu, dans ses bienfaits,
Qui daigne la choisir pour venger les forfaits[20].
et la partie rédigée des préparatifs du viol va dans le même sens :
À loisir les infâmes vieillards
S’enivrent quelque temps d’impudiques regards.
Ils attendent qu’au ciel la belle vertueuse
Offre les doux transports de son âme pieuse ;
Qu’elle rêve à l’époux cher à son souvenir,
Que son esclave enfin n’ait plus à revenir :
Puis, comme deux serpents à l’haleine empestée.
Quittant les noirs détours d’une rive infectée.
Fondent sur un enfant qui dort au fond d’un bois[21].
Dans l’imaginaire de Chénier, de vieux pervers peuvent violer une jeune et belle jeune femme, ce sont des « infâmes », des « serpents », dégoûtants et sordides. Dans L’Aveugle ce sont des « centaures » chez qui l’animalité déborde l’humanité et qui manifestent une virilité prédatrice et dévastatrice, qui ne s’exprime que dans une débauche de violence. Mais il n’est question de rien de tout cela quand deux adolescents séduisants, jeunes, « naïfs » (c’est un des termes clés de toute sa poésie) et faits si je puis dire l’un pour l’autre se « draguent », le garçon y mettant fatalement, particulièrement sous l’Ancien Régime – mais parfois aussi aujourd’hui, semble-t-il – un peu plus d’énergie et de détermination que la fille. Alors bien sûr, on peut toujours prétendre que c’est sans le vouloir et sans le savoir que Chénier peint un viol dans « L’Oaristys », parce qu’il est enveloppé dans une culture du viol qui imprègne son inconscient et remonte comme naturellement dans sa poésie. Mais sur le plan conscient, sa réprobation du viol est évidente et accuser son « inconscient » de (jeune) homme d’Ancien Régime est tout de même lui faire un étrange et obsessionnel procès. Il faut ajouter que l’érotisme de la poésie de Chénier se déploie constamment dans un monde préchrétien et que la sexualité, sauf justement dans ses formes les plus brutales et les plus menaçantes, y est constamment innocentée, y compris dans ses variantes homosexuelles, ce qui est particulièrement remarquable dans l’éblouissant poème sans titre autrefois commenté par Jean Starobinski[22], où la « leçon de flûte » est une forme d’initiation aux corps qui pourrait, si l’on y tient absolument, apparaître comme le résultat d’une manipulation et donc d’une forme insidieuse de viol de l’élève par le professeur, gros sabots interprétatifs qui ne laissent que peu de chance à la grâce du poème d’atteindre son lecteur et à la poésie de l’envelopper de sa magie[23]:
Toujours ce souvenir m’attendrit et me touche,
Quand lui-même appliquant la flûte sur ma bouche,
Riant et m’asseyant sur lui, près de son cœur,
M’appelait son rival et déjà son vainqueur.
Il façonnait ma lèvre inhabile et peu sûre
À souffler une haleine harmonieuse et pure.
Et ses savantes mains prenant mes jeunes doigts,
Les levaient, les baissaient, recommençaient vingt fois,
Leur enseignant ainsi, quoique faibles encore,
À fermer tour à tour les trous du buis sonore[24].
J’en arrive donc à une première conclusion : non seulement il me paraîtrait douteux de parler de viol à propos de « L’Oaristys », mais il me paraîtrait tout aussi discutable de parler de viol à propos d’une scène réelle similaire entre un jeune homme et une jeune femme qui se passerait de nos jours, même si les codes amoureux – puisqu’on ne peut pas nier leur existence – ne sont évidemment pas les mêmes.
Mais de mon point de vue cette affaire pose encore une autre question. N’oublions pas qu’elle a surgi au sein d’une préparation à l’agrégation de Lettres, et que ses acteurs sont censés être intéressés par ce que nous appelons la « littérature ». Les étudiants et les étudiantes qui ont créé cet événement ont choisi la littérature comme objet de réflexion de toute une vie, puisqu’ils passent un concours qui professionnalise leur rapport à la littérature et institutionnalise leur vocation à la faire lire (et accessoirement à essayer de la faire aimer[25]). Or, l'un des éléments les plus précieux de la littérature des siècles anciens est qu’elle nous libère de notre contemporanéité et nous offre un espace de liberté : elle nous permet, parce qu’elle n’est pas en phase avec notre présent, de nous construire une forme de résistance intérieure à tout ce que notre époque nous présente comme une évidence, notamment lorsqu’elle introduit une double et dangereuse confusion, d’une part entre œuvre et discours[26], d’autre part entre œuvre et produit[27]. Les textes littéraires (et de manière générale les œuvres d’art) venus d’un lointain passé qui parviennent à affecter notre présent sont une de nos meilleures protections contre cette menace que le présent fait (comme tout présent refermé sur lui-même) peser sur notre liberté. Cela ne nous empêche pas de confronter les textes du passé à nos soucis éthiques et idéologiques actuels, et nous pouvons (et même devons) le faire dans une certaine mesure, mais et avec beaucoup de prudence, et en gardant la conscience que ce n’est peut-être pas ce que nous avons à faire de plus intéressant avec eux. Une autre question que pose cette affaire est donc celle de l’actualisation brutale des textes d’autrefois sommés de répondre aux questionnements d’aujourd’hui, et l’appauvrissement extrême du rapport que nous entretenons avec eux si nous sommes à leur égard dans une posture de suspicion idéologique et d’injonction de conformité[28]. Je reviens à l’exemple de la représentation des Suppliantes d’Eschyle empêchée à la Sorbonne, car il montre que cette « injonction » a pour horizon une espèce de censure. On me dira que ce n’est pas exactement la même chose, et que les agrégatifs qui réclament la possibilité de parler de « viol » à propos du texte de Chénier ne demandent pas qu’il soit supprimé du programme : je note toutefois à nouveau qu’ils se disent « dérangés » non seulement par l’interprétation du poème mais par le poème lui-même. La source idéologique du malaise ainsi exprimé n’est peut-être pas tout à fait la même. Mais ce qui est commun à toutes ces attitudes, c’est une espèce d’agressivité a priori envers les « classiques », tombés de leur piédestal et traités maintenant comme si leur statut, qui n’est plus protégé par aucun consensus admiratif, était celui de n’importe quel discours social. La littérature, qui a perdu presque tous ses privilèges en devenant un produit de consommation comme un autre, est en train de perdre le dernier qui lui restait, et le plus précieux, celui de vivifier et d’enrichir nos vies. Traitée comme une accusée, sa grandeur passée semble une raison de plus de s’acharner sur elle dans une entreprise jamais terminée de démolition des idoles. Et dans cette logique, les textes les plus médiocres produits dans la logique de bien-pensance satisfaisant à tous les critères éthiques et politiques en vigueur peuvent être encensés en toute impunité et les ex-chefs-d’œuvre du canon pris à parti et traités comme les « complices » d’une oppression de longue durée.
Ce n’est pas, on l’a compris, que je tienne beaucoup au poème de Chénier qui a été l’occasion de cette espèce d’affaire. J’ai réagi en le lisant et en le relisant d’une manière en partie similaire à celle d’Hélène Merlin-Kajman qui avait remarqué dans un de ses textes sur ce dossier que « L’Oaristys » « l’indiffère esthétiquement et l’exaspère idéologiquement[29] ». Sur le premier plan, le plan esthétique, je suis parfaitement d’accord, et je n’avais d’ailleurs pas choisi pour cette raison ce poème dans mon programme d’explications de textes ou d’études littéraires, tout simplement parce qu’il me paraissait préférable de focaliser l’attention des étudiants sur les plus grandes réussites poétiques de Chénier plutôt que de m’acharner à commenter ou à faire commenter une « broutille », voire un simple exercice de style, de sa jeunesse. Je ne pourrais en revanche pas dire que je suis « exaspéré » par l’idéologie sous-jacente au texte, d’une part parce que son origine est obscure (antique ? propre au dix-huitième siècle ou à l’âge classique ?) ensuite parce que je ne suis même pas sûr qu’il s’agisse d’une « idéologie » à proprement parler, même implicite, même inconsciente. Toute topique n’est pas « idéologique ». La question de la valeur est cependant ici hors-sujet, car si l’on peut juger médiocre le poème de Chénier, on peut juger beaucoup plus accompli le poème de Ronsard qui a été présenté comme une incitation au viol : sa beauté ne l’a pas protégé d’une comparable mise en accusation (des professeurs du secondaire déclarent même sur la toile renoncer désormais à faire lire Ronsard à leurs élèves…), dont la réitération est en train à la fois de s’enhardir et de se banaliser, et dont l’essence est un déni assumé et même théorisé de la spécificité des œuvres d’art et des œuvres littéraires, traitées comme des discours ordinaires, comme des discours de pouvoir dans une ligne héritée, dans deux perspectives différentes, de Louis Marin ou d’Alain Viala. Or oui, bien sûr, les œuvres littéraires et les œuvres d’art sont des discours. Mais pas seulement. Le « reste » est précieux et fragile, irremplaçable même. Il ne constitue pas pour nos vies un piège, mais un don. En sommes-nous vraiment arrivés à devoir réapprendre à le recevoir ?
[1] André Chénier, Poésies, édition Louis Becq de Fouquières, 1994, Gallimard, « Poésie ».
[2] Sur ce point, voir notamment A. Niderst, « Le matérialisme de Chénier », Être matérialiste à l’âge des Lumières. Hommage offert à Roland Desné, éd. B. Fink et G. Stenger, Paris, PUF, 1999, p. 219-231.
[3] Je me permets de renvoyer sur ce point à mon article sous presse « Errances et décomposition de l’épopée au XVIIIe siècle : le jugement d’André Chénier sur La Henriade », contribution à un volume sur La Henriade de Voltaire dirigé par Jean-Marie Roulin et Danièle Maria, Honoré Champion, 2019, p. 217-231.
[4] J’ai moi-même montré que sur ce front l’accusation n’est pas forcément injuste, même si l’idée d’homophobie est complètement anachronique relativement au XVIIIe siècle : voir « Sodome à Potsdam : les passions entre hommes dans les Mémoires pour servir et la vie de Monsieur de Voltaire », actes des Journées Voltaire organisées en juin 2013 par Olivier Ferret et Florence Lotterie à l’Université Paris-Sorbonne sur « Voltaire et le sexe », Revue Voltaire, n° 2014, p. 99-113.
[5] Ce qui est archi-faux : c’est le seul point sur lequel je suis d’accord avec Onfray et son livre « coup de poing » sur le « divin marquis ». Mais depuis un siècle il s’est trouvé un nombre ahurissant de voix pour faire survivre ce paradoxe à propos d’un écrivain d’une misogynie proprement abjecte qui écrit dans sa correspondance sans nulle ironie qu’une femme est naturellement l’esclave de son mari et que la manière dont un homme « utilise » une femme est aussi indifférente que la manière dont il utilise… sa « chaise percée » ! Sade parle ici en son propre nom et on ne peut pas mettre ces idées sur le compte des nombreux personnages de fiction qui, dans son œuvre, théorisent sans fin l’infériorité de la femme.
[6] Œuvres poétiques, I, éd. Georges Buisson et Edouard Guitton, Paradigme, 2005, p. 329. Je souligne les derniers mots. Il est intéressant par ailleurs de remarquer que ledit volume avait été lui-même au programme d’agrégation une dizaine d’années auparavant et que « L’Oaristys » y figurait : à l’époque, sans avoir soulevé une telle tempête.
[7] Je souligne. Ce n’est pas ici l’interprétation du poème qui dérange, mais le poème lui-même. Ou du moins c’est plus qu’ambigu : cette phrase prise isolément a un sens incontestable : les étudiantes et étudiants ont été « dérangés » par le poème. La phrase suivante suscite un doute : c’est la prétendue interprétation traditionnelle du poème surtout qui dérangerait, mais elle n’efface en rien l’idée précédente.
[8] Je souligne.
[9] https://lessalopettes.wordpress.com/2017/11/03/2540/. Consulté le 7 mai 2019.
[10] On ne souscrit donc pas ici au laisser-faire interprétatif prôné par un Stanley Fish…et largement relayé en France et en Europe par de nombreux intellectuels typiquement « post-modernes ». Je ne développe pas ce point que j’ai abordé dans mon article « Entre Charybde et Scylla : historicisme et “actualisme” dans les études littéraires sur les siècles d’Ancien Régime », n°2014 de la revue Dix-huitième siècle, dirigé par Michel Delon et Jean Mondot, p. 131-145.
[11] Intérêt qui n’a rien de « littéraire », bien entendu.
[12] Ce qu’ils ne font certes pas tous : certains dix-huitièmistes de grand renom, qui ne sont donc pas d’accord sur ce point avec l’auteur de ces lignes, ont signé la pétition.
[13] P. 95 dans l’édition mentionnée des Poésies de Chénier.
[14] http://www.mouvement-transitions.fr/index.php/component/content/article?id=1502:saynete-n-73-a-chenier-h-merlin-kajman, consulté de 9 juin 2019.
[15] Pour toutes les citations du poème, voir p. 79-85 dans l’édition mentionnée de Chénier, celle qui a été mise au programme de l’agrégation.
[16] Pas d’un libertinage cruel à la Sade, mais d’un libertinage heureux et hédoniste.
[17] Qui présente un certain nombre de similitudes avec le poème de Chénier mais paraît nettement plus ambigu voire pervers dans la relation qu’il construit entre les deux protagonistes.
[18] Je souligne les différents éléments qui mettent en évidence que la réaction de la jeune femme après la consommation de l’acte sexuel n’est pas celle d’une femme violée, sauf à considérer qu’une femme de l’Antiquité ou de l’Ancien Régime puisse être heureuse d’avoir été violée. Mais que n’inventerait-on pas pour injecter l’idée de « viol » dans ce poème qui ne lui a rien demandé ?
[19] P. 20-21 de l’édition « Poésie Gallimard ».
[20] P. 387 de l’édition « Poésie Gallimard ».
[21] P. 393 de l’édition « Poésie Gallimard ».
[22] Dans son magistral article « Une leçon de flûte », Langue française, sept. 1974, p. 99-107, repris dans La Beauté du monde, Paris, Gallimard, 2016, p. 298-308.
[23] Désenchanter à tout prix la littérature semble d’ailleurs être l’obsession de ceux qui attaquent les textes du passé pour leur (éventuelle) non-conformité aux valeurs actuelles.
[24] P. 131-132 de l’édition « Poésie Gallimard ».
[25] Même si évidemment aucun programme officiel n’a (heureusement) jamais mis l’obligation d’aimer à l’ordre du jour. Aimer n’est ni une « connaissance » ni une « compétence ».
[26] Confusion dont sont particulièrement responsables les excès de la rhétorique et de l’argumentation comme grilles presque uniques d’analyse des textes du passé.
[27] Il suffit de consulter Amazon pour constater que les Mémoires d’outre-tombe dans la « bibliothèque de la Pléiade » sont un produit, et que la quasi-totalité de la production littéraire actuelle est captive de cette conception.
[28] Sur le double danger d’une actualisation réductrice et d’un historicisme qui anesthésie les textes anciens et les enferme dans leur époque, je renvoie à nouveau à mon article « Entre Charybde et Scylla : historicisme et ‘actualisme’ dans les études littéraires sur les siècles d’Ancien Régime », n°2014 de la revue Dix-huitième siècle, dirigé par Michel Delon et Jean Mondot, p. 131-145.
[29] http://www.mouvement-transitions.fr/index.php/litterarite/articles/n-7-h-merlin-kajman-encore-chenier-et-au-dela, consulté le 9 juin 2019.