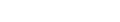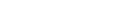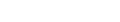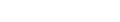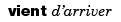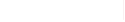Inédit
Structures paradoxales du trauma à travers deux exemples de romans du 11-septembre :
Don DeLillo, Falling Man ; et Jonathan Safran Foer, Extrêmement fort et incroyablement près
Préambule
Les 13, 14 et 15 décembre 2018 s’est tenu un colloque international sous l’égide de Transitions consacré à « Littérature et trauma ». Il a rassemblé trente-six communiquants réunis en sessions, elles-mêmes réunies en journées. Marc Amfreville est intervenu lors de la première journée, celle du 13 décembre au matin, consacrée à « Un champ émotionnel en débat », lors de la session « L’entrée du trauma(tisme) dans la culture littéraire ».
Marc Amfreville se penche sur deux romans « du 11 septembre » pour montrer comment « la fiction ambitieuse s'est toujours donné pour mission de permettre au lecteur d'entendre le non-dit et de rétablir les liens manquants entre images déferlantes et sons troublants »
H. M.-K. et T. P.
Marc Amfreville est professeur de littérature américaine à l’université Paris-Sorbonne-Paris IV et psychanalyste participant au IVe Groupe. Il a été président de l’AFEA, a traduit plus de cinquante romans. Il a ouvert à l’université Paris-Sorbonne un atelier de recherche sur les écritures du trauma (ARTE) qui a récemment donné lieu à un numéro, « Trauma », dans la revue en ligne Sillages critiques, et prépare une monographie qui devrait s’intituler Le Paradoxe, entre littérature et psychanalyse.
Structures paradoxales du trauma à travers deux exemples de romans du 11-Septembre :
Don DeLillo, Falling Man ; et Jonathan Safran Foer, Extrêmement fort et incroyablement près[1]
Marc Amfreville
02/03/2019
Introduction
On est tenté de dire que les deux romans retenus, en adhérant de si près à la structure paradoxale du traumatisme dans son acte même de représentation, parviennent à fusionner la dimension intime de la blessure psychologique et ses implications universelles. Parce que le trauma est une percée si violente qu’elle perturbe la structure même d’un être tout en indiquant dans ses manifestations même une direction possible pour la guérison, il fournit un modèle créatif pour la littérature. La fiction ambitieuse s’est toujours donné pour mission de permettre au lecteur d’entendre le non-dit et de rétablir les liens manquants entre images déferlantes et sons troublants : DeLillo et Safran Foer radicalisent cette forme d’expérimentation pour permettre à leurs lecteurs d’accéder à la réalité d’un traumatisme qui n’a pas seulement laissé ses traces chez ses victimes évidentes.
Au lit, cette nuit-là, j’ai inventé un drain spécial qui se trouverait sous chaque oreiller de New York et qui serait relié au réservoir. Chaque fois que les gens pleuraient pour s’endormir, les larmes allaient toutes au même endroit, et le matin, le météorologue pouvait signaler si le niveau d’eau du réservoir des larmes avait monté ou baissé, et on pouvait savoir si New York était en bottes lourdes. (Extrêmement fort et incroyablement près, 38)
Choix d'un corpus
La première difficulté à laquelle on est confronté lorsqu’on s’apprête à aborder la question du trauma dans sa représentation littéraire est celle du choix d’un roman qui permettra d’approfondir la question sans en faire le patient d’une opération qu’elle n’a jamais demandée. En d’autres termes, il faut trouver un texte contemporain qui semble suffisamment informé de la théorie du trauma pour éviter le piège d’un engagement circonstanciel et commercial à l’approfondissement (pseudo) psychologique, tout en démontrant une indépendance artistique, un examen personnel de cette question par l’auteur, qui par définition saura transcender la simple transcription d’une théorie à la mode en termes fictifs. C’est ainsi que je me suis tourné vers L’Homme qui tombe et Extrêmement fort et incroyablement près. Ces romans peuvent être qualifiés de textes « du trauma », si l’on est prêt à prendre l’expérience du jeune Oskar de la perte de son père dans les attentats terroristes du 11 septembre 2001 comme une deuxième étape d’un traumatisme transgénérationnel qui a valeur de percée des défenses psychiques : l’attentat de Dresde à la fin de la Seconde Guerre mondiale que ses grands-parents ont subi et dont on ne parle jamais. De même, le fait que Keith soit témoin de la mort de son ami dans la tour, et qu’il en perde ensuite le souvenir, peut être considéré comme une adaptation de la bi-directionalité de la Nachträglichkeitet de son influence sur la forme littéraire choisie pour l’intrigue.
Traumatisme : retour à la définition (et remise en question)
La véritable question qui découle de cette inquiétude est celle de la « scientificité » même du concept, et de la validité de son application au domaine des œuvres de fiction qui ne mettent pas en scène le traumatisme au sens originel. Ce qui complique les choses, c’est qu’à quelques exceptions près qui traitent de personnages réellement traumatisés, la majeure partie de la production critique des « Trauma Studies » s’intéresse à un sens du mot qui a plus à voir avec les catastrophes historiques et à une difficulté inhérente à leur représentation fictive : la Shoah, Hiroshima, et dans une moindre mesure la guerre du Vietnam. Comment concilier ces sujets avec l’essentiel (proche de l’essence humaine), l’intime, l’expérience interne du traumatisme ? Dans quelle mesure pouvons-nous suivre (entre autres) les réflexions éclairantes de Cathy Caruth dans Trauma: Explorations in Memory (1995) et Unclaimed Experience (1996) sans trahir, d’un point de vue strictement littéraire, les potentiels infinis de l’anéantissement apparemment total de la mémoire d’un être humain ? Alors que Freud semble dans ses dernières réflexions sur le traumatisme - Moïse et le monothéisme a été publié en 1939, l’année de sa mort - ouvrir la voie à une application historique de la théorie du traumatisme, des analyses ultérieures ont montré à quelle vitesse on pouvait perdre de vue la nature profondément intrapsychique des mécanismes dont il avait si bien fait la preuve de l’existence.
Permettez-moi de me citer comme base de cette réflexion, puisque mon objectif est d’aller plus loin aujourd’hui, et dans une certaine mesure, même de corriger une erreur :
Figure même du paradoxe, le trauma se dit dans son impossibilité à se dire, et cet échec même du dire est la condition de sa reconnaissance comme tel. Il faut un effort incommensurable de l’imagination, dont seule peut-être la fiction est capable, pour envisager un deuil non su, une perte non ressentie, la mort interne d’une vie dont l’absence serait l’empreinte[2].
Ce qui n’est pas abordé du tout dans cette définition antérieure, c’est ce que l’on appelle depuis 1980 le PTSD (syndrome de stress post-traumatique), et que Freud avait progressivement pris en compte dans l’évolution de sa théorie du traumatisme. En d’autres termes, il me semblait à l’époque - pas si lointaine - que les « études sur le trauma », pour atteindre leur objectif éthique, devaient se concentrer sur des textes qui traitaient de chocs si dommageables qu’ils ne pouvaient être représentés, ou plutôt sur des textes qui avaient trouvé des moyens ingénieux de contourner le paradoxe fondamental de l’indicible au sens propre. La critique sérieuse s’éloignerait alors naturellement des acceptions rebattues du mot « traumatisme » et considérerait des fictions (ou des pièces de théâtre) centrées sur la question centrale de savoir comment exprimer l’inexprimable, comment dire le non-dit sans trahir la réalisation de l’« indicible » : en d’autres termes ceux qui induisaient un rapport totalement nouveau au langage ou plutôt exigeaient un langage qui porte en lui-même la trace de son incapacité à représenter.
Un rapide survol de l’histoire de la notion devrait commencer par rappeler que traumatisme signifie « blessure » et dérive du verbe grec τιτρωσκω qui signifie « percer ». Avant que Pierre Janet n’importe pour la première fois le mot dans le domaine de la psychologie, il faisait référence à la rupture physique des tissus. Cette étymologie violente devrait en soi nous aider à refuser les extensions abusives à des événements simplement dérangeants. La notion a connu une évolution plutôt sinueuse avec Freud : une véritable séduction pendant l’enfance (1895-6), le fantasme d’une telle intrusion (1897), l’insupportable confrontation avec les atrocités de la Première Guerre mondiale (1915), menant à la mort et la mélancolie (1917) et Au-delà du principe de plaisir (1920), et enfin la définition moins connue qu’il donne du traumatisme dans Moïse et le Monothéisme en 1939, sans doute influencé par Ferenczi. Dans ce dernier livre, Freud juxtapose deux effets paradoxaux du traumatisme qui pourraient bien contribuer à élargir notre définition de travail. D’une part, les effets négatifs : « Rien ne doit être rappelé ou répété des traumatismes oubliés[3] »; d’autre part, des traumatismes positifs, « qui s’efforcent de réactiver le traumatisme, de se souvenir de l’expérience oubliée ou, mieux encore, de la rendre réelle, de la revivre par sa répétition » (ibidem). Je n’ai pas ici l’espace nécessaire pour examiner les conséquences théoriques d’une telle contiguïté contradictoire ; sa charge paradoxale peut cependant être mise à profit dans le domaine de la critique littéraire en pensant aux PTSD sous l’angle d’une histoire impossible. Pas nécessairement le blocage total de la mémoire, mais l’isolement d’images fugitives sans rapport qui impliquent le lecteur dans la reconstruction du sens. Une telle conception avait déjà commencé à éclairer les pensées de Freud lorsqu’il s’est penché sur l’effet de la Première Guerre mondiale sur les anciens combattants. Il a peu à peu privilégié une vision des événements traumatisants comme étant à l’origine de la décharge d’une trop grande quantité d’énergie négative pour être enregistrée sous la forme de traces mnésiques organisées. Ces « non-mémoires » surgissaient alors de l’inconscient où elles avaient été scellées, sous la forme de cauchemars ou de visions hallucinatoires diurnes et de comportements erratiques.
Pas seulement des synecdoques
L’homme qui tombe de DeLillo montre précisément la compréhension nécessaire des deux effets contradictoires du trauma, et répond ainsi aux exigences stimulantes de Susana Onega concernant les ajustements formels que la fiction doit subir : « Pour relever le défi de donner une voix narrative au trauma, la littérature elle-même doit s’éloigner des schémas séquentiels traditionnels et développer de nouvelles formes, tout comme elle doit réviser les notions de temps, de mémoire et d’histoire[4]. » En d’autres termes, plus du côté de la littérature – et de Freud dans son analyse de la Gradiva de Jensen quand il disait que le poète en savait toujours plus que le scientifique –, il semble que l’écrivain ait réussi à concevoir de nouveaux modes de représentation des comportements post-traumatiques qui pourraient bien enrichir la connaissance théorique et médicale. Il est essentiel à cet égard de préciser que les remarques suivantes, consacrées aux romans de DeLillo et Safran Foer, ne sont pas un exercice de « psychanalyse appliquée ». Ils visent plutôt à mettre en lumière une vision littéraire spécifique qui, à bien des égards, s’apparente à, recoupe, ou même concurrence la théorie psychanalytique.
Dès son titre, L’Homme qui tombe affirme sa double ambition : plonger sans réserve dans l’intime et atteindre le plus universel en faisant réfléchir l’homme à sa nouvelle destinée. L’homme indéterminé et éponyme qui tombe peut ainsi se référer à l’artiste de la performance qui se jette du sommet de gratte-ciels avec un harnais de sécurité (qui ne le protège pas du choc et de la douleur), à Keith Neudecker, le protagoniste qui était dans la tour nord le 11 septembre ou à Hammad, qui volait sur l’un des deux avions qui ont frappé le World Trade Center – sans parler de toutes les personnes anonymes qui ont sauté de leurs fenêtres avant l’effondrement des tours, ou, comme suggéré plus haut, l’homme en général, l’humanité du XXIe siècle qui a été témoin passif, victime ou criminel, de l’attaque sans précédent.
Loin d’un recours quelque peu banal à la synecdoque qui ne décrirait que trois ou quatre expériences humaines individuelles exemplaires, le texte semble viser à embrasser l’ensemble des composantes de cet événement traumatique en brouillant précisément les distinctions entre ses différents acteurs et spectateurs. Au-delà des personnages auxquels on pourrait faire allusion dans le titre, les femmes du roman, Lianne, Florence et Nina, les enfants même, participent aussi à l’indistinction générale, ou ce que nous pourrions définir comme la fluctuation du sens. Mention spéciale à Lianne, qui préside les séances thérapeutiques pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, qui découvre l’étonnante performance de l’Homme qui tombe et qui déclenche évidemment le souvenir de centaines de sauts de panique avant que les tours ne s’écroulent, qui se révèle enfin hantée à jamais par le suicide de son père. D’une manière qui transcende son statut de personnage dans une intrigue, elle rassemble plusieurs signifiants de la mort, du suicide, de la mémoire et de la perte qui servent de puissants contrepoints au traumatisme. DeLillo semble en effet décliner tous les potentiels narratifs du trauma, tant au niveau thématique qu’au niveau formel. Pour ce faire, il recourt à plusieurs techniques, et tout d’abord à ce qui apparaît comme une focalisation externe, qui, combinée à l’utilisation de pronoms dont les référents ne sont révélés que bien plus tard, plonge le lecteur dans la dimension énigmatique du trauma, ou plutôt le confronte à la réaction étrange provoquée par la rencontre avec une personne traumatisée :
Ce n’était plus une rue mais un monde, un espace-temps de pluie de cendres et de presque nuit. Il marchait vers le nord dans les gravats et la boue et des gens le dépassaient en courant, avec des serviettes de toilette contre la figure ou des vestes par-dessus la tête. Ils pressaient des mouchoirs sur leur bouche. Ils avaient des chaussures à la main, une femme avec une chaussure dans chaque main, qui le dépassait en courant. Ils couraient et ils tombaient, pour certains, désorientés et maladroits, avec les débris qui tombaient autour d’eux, et il y avait des gens qui se réfugiaient sous des voitures. (L’Homme qui tombe, 3)
Cette première page est en fait la clé de la formule narratologique à l’œuvre dans tout le roman et trouve ses racines et sa justification dans le contenu traumatisant. Le lecteur découvre d’abord Keith errant dans la rue juste après avoir descendu l’escalier du gratte-ciel juste avant l’effondrement de la tour. Avec les esquisses naïves de la seconde moitié du paragraphe cité, il devient évident qu’en regardant le personnage de l’extérieur, on suit aussi le courant de ses pensées. Si les notations sont si clairement descriptives, c’est parce que l’homme traumatisé voit le monde ainsi. Il a perdu la chaîne de cause à effet et ne fait que juxtaposer des points d’information sans les relier, à rebours, à l’intrusion soudaine de l’avion ou, vers l’avant, à la chute imminente de la tour. Comme je l’ai rappelé plus haut, d’un point de vue théorique, le personnage est la proie d’images obsédantes qui ne peuvent se transformer en mémoire intégrée à cause de leur intensité même, et nous voyons ici une intuition à l’œuvre, qui fait écho à la célèbre métaphore de la vésicule utilisée par Freud dans Au-delà du principe de plaisir pour illustrer le fonctionnement des stimuli externes et la membrane imaginaire qui les protège. Ainsi, le recours à la troisième personne dans L’Homme qui tombe signale de la manière la moins emphatique la vérité la plus profonde du texte : en encapsulant des réminiscences, Keith est devenu un étranger à lui-même, un observateur extérieur dont la mémoire ne lui appartient plus. Les actions, pourtant analysées en plongeant dans l’esprit transparent du protagoniste, sont, dès la première page, totalement passées sous silence. Keith n’essaie pas – ou plutôt ne peut pas – comprendre pourquoi il cherche refuge chez Lianne, l’épouse dont il est séparé depuis plusieurs années, pourquoi il est sorti de la tour avec une mallette qui ne lui appartient pas, pourquoi il restituera sa propriété à une inconnue qui devient sa maîtresse à un moment où il se sent plus proche que jamais de sa femme, pourquoi il vide progressivement sa vie de toute signification possible en consacrant tout son temps au poker et à des jeux de l’argent, laissant son enfant se distancer de lui. Les affects passent donc lentement mais sûrement de l’incompréhensibilité à la non-existence, suivant le schéma de la dissolution des émotions connues pour caractériser les patients atteints de PTSD.
Dans le cas de Keith, le souvenir de l’événement central qui n’a pas été enregistré ne s’est pas complètement effacé, mais la chaîne logique de la narration intérieure est irrémédiablement brisée. Un peu comme l’interminable descente des escaliers sous la menace constante de la désintégration de la tour, ou le plongeon compulsif dans l’air de ceux qui ne supportaient pas cette angoisse, avait gelé toutes ses ressources émotionnelles, éteint la conscience de lui-même comme agent viable dans le monde, peut-être même annihilé la faculté d’envisager le monde lui-même. Il est intéressant de noter que l’attaque terroriste n’est jamais décrite de l’extérieur : comme dans Fugitive Pieces d’Ann Michaels[5], le lecteur est appelé à fournir les images manquantes qu’il a sans doute retenues des reportages des médias.
De la même manière, mais pour d’autres raisons – premièrement, Oskar n’est pas techniquement victime de l’attentat terroriste, deuxièmement, en raison d’un récit à la première personne qui s’appuie sur des connaissances partielles et imprécises liées à son âge – Extrêmement Fort aborde la représentation du trauma par des moyens indirects : les paroles de Thomas Schell, enregistrées sur le répondeur de la famille et les photos d’un homme anonyme qui tombe, à la fin même du texte.
A l’inverse, enfermés dans le cerveau du protagoniste au moment même où celui-ci est emprisonné dans la tour en ruine, nous voyons la réaction physique de Keith à l’agitation et à ses conséquences, une dizaine de pages avant la fin, comme si le texte entier avait été une tentative de retrouver ce souvenir. Ce n’est qu’alors qu’il retrouve la véritable origine « intime » de son trauma : les derniers instants d’un ami qui meurt dans ses bras : « C’est à ce moment-là qu’il s’est demandé ce qui se passait ici » (311). On note l’utilisation déstabilisatrice de l’adverbe « ici » qui restitue l’immédiateté de l’image invoquée. L’ensemble du roman peut alors être lu, bien qu’il ne souligne jamais vraiment sa mission, comme la délimitation du mouvement lent vers un telosqui est en même temps son origine. Il y a plus qu’une simple guérison thérapeutique, ou le retour en arrière conventionnel vers les sections précédentes du livre qui sont maintenant claires. Nous avons toutes les raisons de considérer cette construction - à la fois psychologique et narratologique – comme la transcription littéraire du concept de Nachträglichkeit. Un tel schéma se retrouve de manière convaincante dans L’Homme qui tombe où le souvenir retrouvé de la mort de l’ami de Keith rend compte de toutes les images de « chutes » qui imprègnent le texte. Insistons sur le fait que le mécanisme textuel à l’œuvre ici ne décrit pas exactement la récupération d’une perte de mémoire du point de vue du personnage. La révélation finale a lieu après le chapitre d’ouverture. En d’autres termes, si le noyau traumatique était caché au lecteur, nous ne pouvons pas affirmer sans risque que le personnage l’avait radicalement exclu de sa conscience. L’éloignement provoqué par le trauma de Keith, cependant, « explique » tout le fonctionnement du roman car le protagoniste, à mi-parcours de l’intrigue, avait été présenté comme aussi étranger à nous, à sa femme et à lui-même :
Ces nuits-là, parfois, il semblait sur le point de dire quelque chose, un fragment de phrase, c’était tout, et cela mettait fin à tout entre eux, à tout discours, à toute forme d’arrangement déclaré, à toute dérive amoureuse encore présente. Il avait ce regard vitreux dans les yeux et un sourire sur la bouche, un défi pour lui-même, garçon et horrible. Mais il n’a pas mis en mots ce qui se trouvait là, quelque chose de si sûrement et imprudemment cruel qu’il l’effrayait, qu’il ait parlé ou non. Le regard l’effrayait, le corps incliné. Il marchait dans l’appartement, légèrement courbé sur le côté, un sourire de culpabilité tordu, prêt à casser une table et à la brûler pour pouvoir sortir sa bite et pisser sur les flammes. (131)
Il faut être particulièrement sensible ici à la succession rapide des différents points focaux : d’abord, la perspective de sa femme qui est témoin des effets de l’extérieur, et ensuite, l’expression des désirs intérieurs de Keith en matière de violence et de transgression. Il est même montré à plusieurs reprises comme l’esclave de son « instinct sauvage », comme « double en lui-même, traînant l’ombre tendue du non-dit » (203), ou « un mécanisme auto-opérant » (287). Il ne retrouvera probablement jamais la raison, même après le retour de sa mémoire, comme l’indiquent les derniers mots du texte (« rien dans sa vie » 316), et cette fin peu concluante est révélatrice en soi. Tout à fait singulier et individualisé, le protagoniste devient l’emblème de son époque et de son environnement : il est désormais intrinsèquement défini comme un produit d’« après les avions », hanté par les souvenirs éternels de la chute.
Il faut revenir aux détails de ce roman pour voir comment – alors que jusque-là les chapitres consacrés aux terroristes et ceux traitant des New-Yorkais avaient été soigneusement séparés – le brouillage de la distance entre l’avion et la tour est carrément supprimé :
Une bouteille est tombée du comptoir dans la cuisine, de l’autre côté de l’allée, et il l’a regardée rouler par-ci par-là, une bouteille d’eau vide, faisant un arc de cercle dans un sens et reculant dans l’autre, et il l’a vue tourner plus vite, puis glisser sur le plancher un instant avant que l’avion heurte la tour, chauffer, puis faire le plein, et une onde de choc passe dans la structure qui fait tomber Keith Neudecker de son siège et le fait tomber sur un mur. Il s’est retrouvé face à un mur. Il n’a pas lâché le téléphone avant de toucher le mur. Le plancher a commencé à glisser sous lui et il a perdu l’équilibre et s’est calmé le long du mur jusqu’au plancher. (306)
La fusion des deux scènes, des deux personnages, s’articule autour de l’effet évidemment calculé du « passage à travers la structure » métaphorique qui pourrait faire référence soit à l’avion, soit au gratte-ciel, mais qui renvoie finalement à la construction même du texte. Alors que l’intérieur et l’extérieur se confondent, ou plutôt qu’un espace s’incarne dans l’autre dans une image de « rupture » intimement liée à l’effraction psychique, le trauma s’affirme à la fois comme une réalité individuelle et une métaphore centrale de l’annihilation.
Travaux du deuil
Décrivant et partageant ces cauchemars communs, le roman de DeLillo s’avère éclairé par une position philosophique audacieuse : le 11-septembre appartient à l’expérience humaine en général, sa reconstitution fictive pourrait fournir, quoique de façon peu probable, une forme de thérapie éthique, comparable au deuil. Et le deuil, c’est précisément le sujet central de Extrêmement fort et incroyablement près. La plus grande partie de la narration est assumée par Oskar Schell, environ deux ans après la mort de son père, lorsqu’il se lance dans une quête chimérique de la serrure qui correspondra à la clé qu’il vient de trouver accidentellement en brisant le vase dans lequel elle était cachée dans le placard de son père jamais visité auparavant. Il convient de noter rapidement que l’inversion même du motif romantique traditionnel de la recherche de la clé manquante est en soi un signe du sens dessus dessous de l’après-11-Septembre, mais c’est aussi un moyen de défamiliariser l’intrigue et donc de désorienter le lecteur. Un tel but étant clairement étayé par l’introduction de photographies ou d’illustrations qui, de fait, n’illustrent pas toujours littéralement le texte mais contribuent plutôt à le déstabiliser, par divers moyens : la présence de mots rayés (l’exemple le plus flagrant étant « Pour pleurer essayer de vivre » 268, 273), la compression du texte au point de le rendre totalement illisible et presque totalement noir (280-284), le recours obsessionnel aux listes et aux rimes qui le hantent : « Les avions qui entrent dans les bâtiments. Les corps qui tombent » (230), ou enfin, la pseudo écriture manuscrite rouge soulignant la page écrite (208-216).
Le reste du roman est constitué des lettres du père de Thomas Schell à l’enfant qu’il n’a jamais connu depuis qu’il l’a abandonné alors que sa femme était enceinte, et on ne peut s’empêcher de se rappeler la scène finale dans laquelle grand-père et petit-fils réunis déterrent le cercueil de leur fils et leur père respectifs pour le remplir des lettres que le vieil homme avait écrites à Thomas Schell pendant sa vie. L’écrit devient ainsi un moyen de combler le vide laissé par le trauma tout en le matérialisant : le sort du père d’Oskar n’a jamais été clairement établi, son corps a disparu dans la catastrophe, un cercueil vide a été enterré à sa place. Tous ces manques sont aujourd’hui comblés par une cérémonie transgénérationnelle, au cours de laquelle les personnages de Hamlet et de Yorick du narrateur fusionnent, cérémonie qui peut réconcilier l’enfant protagoniste avec l’idée même d’un avenir (hors fiction ?). Il peut maintenant grandir parce que la chaîne du temps, interrompue par la désertion de son grand-père et la mort prématurée de son père, a été réparée. La mise en abyme de la perte – l’absence du père de Thomas Schell préfigurant et prolongeant la sienne dans la vie de son fils – en plus de ses puissantes implications psychologiques et émotionnelles, devient rétroactivement une nouvelle source de langage, comme en témoigne la présentation à rebours des photographies de l’homme qui tombe, de son presque atterrissage à son vol dans le ciel près de la tour dont il a probablement sauté.
Et si j’avais eu plus de photos, il aurait volé à travers une fenêtre, de nouveau dans le bâtiment, et la fumée se serait répandue dans le trou par lequel l’avion était sur le point de sortir.
Papa aurait laissé ses messages à l’envers, jusqu’à ce que la machine soit vide, et l’avion aurait volé à l’envers loin de lui, jusqu’à Boston. (325)
Suit une page entière écrite dans un passé irréel, mise en évidence par une série de « aurait été », qui à la fois nie la perte traumatique et l’affirme comme le début d’un véritable processus de deuil. Se reprochant amèrement de ne pas avoir trouvé la force de décrocher le téléphone lorsque son père sur le point de mourir laissait des messages sur le répondeur, Oskar ajoute : « J’aurais dit "papa ?" à l’envers, ce qui aurait sonné comme "papa" dans le bon sens. » (326, la dernière page)
Rapproché de l’entreprise de DeLillo, caractérisée comme nous l’avons vu par un recul similaire de l’engourdissement à la mémoire, de l’amnésie à la conscience, Extrêmement fort transcende l’histoire individuelle d’un enfant pour acquérir une valeur universelle par la création d’un nouveau langage, défini par sa propre performativité, alors que l’écrit présent sous la forme de la masse des papiers dans les tours jumelles est clairement accusé d’entretenir les flammes. « Ils étaient tous du carburant. Peut-être que si nous vivions dans une société sans papier [...] Papa serait encore en vie. Peut-être que je ne devrais pas commencer un nouveau volume. » (325).
Mais lisez aussi : « J’ai inventé un livre qui énumère chaque mot dans chaque langue. Ce ne serait pas un livre très utile, mais vous pourriez le tenir et savoir que tout ce que vous pouvez dire est entre vos mains. » (316)
Inscrit dans cette veine métafictionnelle qui condamne et exalte l’écrit, une tradition américaine qui remonte à Charles Brockden Brown et à l’héritage puritain, on peut aussi voir dans la position d’Oskar la filiation de Huck Finn, qui se méfie de toutes sortes d’activités « sivilisées » (sic) au moment même où il se lance dans celle qui pourrait combler à jamais le vide entre enfant et adulte en faisant appel à son ancien self pour comprendre celui du présent, sur un mode proprement wordsworthian (l’enfant n’est-il pas le père de l’homme ?) C’est grâce à l’enfant qui est en nous que nous pouvons entendre, devenir sensibles et finalement faire nôtre un destin qui peut avoir été mais qui n’a jamais été le nôtre.
C’est une pensée stimulante si l’on se souvient que c’est notre Hilflosigkeit – pour reprendre le mot que Freud a d’abord utilisé pour décrire l’impuissance de l’enfant en l’absence de sa mère, puis pour en faire le synonyme d’un trauma universellement partagé – qui nous permet d’entendre celui des autres. Judith Butler, dans son récent Precarious Lives, en partie motivée par les événements du 11-Septembre 2001, exprime la même conviction que l’identité pourrait avoir à voir avec le deuil, c’est-à-dire la reconnaissance de la perte et l’abandon volontaire de la maîtrise :
Revenons à la question du chagrin, aux moments où l’on subit quelque chose qui échappe à son contrôle et où l’on se trouve en dehors de soi, non pas à côté de soi-même. Peut-être pouvons-nous dire que le deuil contient la possibilité d’appréhender un mode de dépossession qui est fondamental pour ce que je suis. (Butler, 28[6])
Pour conclure sans conclure
C’est donc le privilège de la littérature, de l’art en général peut-être, comme j’espère l’avoir montré avec les exemples de DeLillo et de Safran Foer, de proposer des « faits alternatifs » au sens le plus noble, non Trumpiste du terme, c’est-à-dire comme les créatures de l’imagination, et donc de façonner une autre réalité, en tenant compte de l’expérience humaine originaire tant dans son sens historique que psychique. C’est cependant son obligation éthique, je crois, de ne pas s’écarter de la représentation d’un autre type de faits : ceux qui constituent la vérité de ce qui peut le moins facilement s’exprimer : dépossession, perte et deuil. Des faits, en d’autres termes, qui constituent l’essence insaisissable de l’être, à la croisée de l’individu et du collectif, de la plus grande intimité et de la communauté la plus large. Si la destruction du World Trade Center et d’innombrables vies humaines est un fait qui ne tolère aucune fiction alternative, sa représentation par le langage paradoxal du trauma dans sa forme la plus novatrice prolonge la leçon déconstructrice de l’incertitude d’une psychanalyse bien comprise.
[1] Les citations des deux romans de mon corpus ont été traduites par mes soins. Il y sera fait référence en français respectivement sous les titres de L’ Homme qui tombe et de Extrêmement fort. Les indications de pages renvoient aux éditions en version originale : Don DeLillo, Falling Man, New York, Scribner, 2007 ; et Jonathan Safran Foer, Extremely Loud and Incrediby Close, Londres, Penguin, 2006.
[2] Marc Amfreville, Ecrits en souffrance, Paris, Michel Houdiard Editeur, 2009, p. 44.
[3] Sigmund Freud, L’Homme Moïse et la religion monothéiste (1939), Paris, Folio Gallimard, 2000, p. 122.
[4] Susana Onega, « Ethics, Trauma and the Contemporary British Novel » in Literature and Value, Sibylle Baumbach et Herbert Grabes éds, vol 2. Trier, WVT Wissenshaft Verlag, 2009, p. 9 (ma traduction).
[5] Anne Michaels, Fugitive Pieces, Londres, Bloomsbury, 1997.
[6] Judith Butler, Precarious Lives, the Power of Mourning and Violence, Londres, Verso, 2004. Ma traduction.