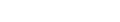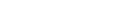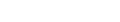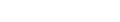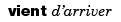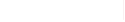Conversation critique n°16.1
Comment les œuvres-témoignages se distinguent-elles des autres types de témoignage ? D’abord par leur degré d’élaboration et leur ampleur interne (ce qui n’est pas forcément affaire de dimensions). Ou par la complexité de leurs relations aux faits ou aux situations historiques et par leur sens de l’ici-maintenant. Mais aussi, et peut-être surtout, par leur degré d’initiative quant à la réception. Elles ont à rencontrer l’accueil fait au témoignage en général – avec ses différentes composantes, historique, politique, morale, judiciaire… Mais c’est aussi pour les traverser vers – et dans – une écoute plus indéfinissable. Alors même qu’en tant que témoignages, elles sont chargées d’un contenu et d’une transmission si spécifiques, les œuvres-témoignages osent ce qu’il y a de plus aléatoire et de plus imprévisible : le rapport littéraire au lecteur indéterminé, l’adresse poétique à ce que Mandelstam appelle « l’interlocuteur ».
C’est ainsi que, disant à l’orée de certaines œuvres-témoignages capitales le plus clair désir d’être entendu, des phrases fameuses se sont inscrites dans nos mémoires : celles de l’avant-propos de L’espèce humaine, ou celles de la « préface de janvier 1947 » de Si c’est un homme.
« Il y a deux ans, écrit Robert Antelme, durant les premiers jours qui ont suivi notre retour, nous avons été, tous je pense, en proie à un véritable délire, nous voulions parler, être entendus enfin. »
Et Primo Levi : « En fait, ce livre était déjà écrit, sinon en acte, du moins en intention et en pensée dès l’époque du Lager. Le besoin de raconter aux autres, de faire participer les autres, avait acquis chez nous, avant comme après notre libération, la violence d’une impulsion immédiate, aussi impérieuse que les autres besoins élémentaires. »
C’est en tant que témoin des camps, sans doute, qu’Antelme et Levi (parlant d’ailleurs au « nous », pour des foules) demandent à être entendus. Mais cette revendication, s’ils ont la force de lui donner d’emblée, au-delà de la douleur ou même de l’amertume, une portée et une sorte de certitude, c’est dans la mesure où elle est soutenue par l’ampleur de l’œuvre qui, dans l’un et l’autre cas, s’amorce et qui implique et, pour une part, enveloppe, sa réception.
Contre l’intention totalitaire d’étouffer les voix des témoins, mais aussi contre la dilution à laquelle les sociétés démocratiques modernes (où tout est susceptible de devenir, médiatiquement, témoignage) risquent toujours de les livrer, les œuvres-témoignages ont cette force singulière, comme un défi contre ce qui les entoure et les menace de les priver de toute écoute, d’incorporer leur propre réception – ou du moins une anticipation de celle-ci.
Anticiper l’écoute ? Réaliser paradoxalement, pour les phrases que l’on forme - pour qu’elles puissent s’élancer - , une réception à demi hallucinatoire ?
C’est un geste tout immédiat qu’osèrent certains poètes des ghettos qu’on retrouvera, brièvement, plus loin.
Ou bien, c’est le poète Sutzkever qui, parlant au procès de Nuremberg (quelques pages, dans ce livre, sont consacrées à ce moment), contraint, par l’extrême tension où il est, la salle au silence ; il lui impose, pendant quelques interminables minutes, son propre silence – et c’est sur le fond de ce double silence qu’ensuite ses propos, puissamment, vont sonner… Ainsi réalise-t-il une captation d’attention qui est homologue à la prise opérée par les poèmes sur une écoute à la fois immédiate et à jamais possible.
*
Une réceptivité interne à l’œuvre ? Dans la neige telle qu’elle est dite dès le texte initial des Récits de la Kolyma, on sent l’engloutissement d’innombrables vies et l’effacement des voix dans des distances muettes. Mais c’est elle aussi qui semble à mesure devenir la surface – ou en termes plastiques – le support même en quoi, écrivant enfin, inscrire des traces.
D’emblée, l’œuvre effectue, sous nos yeux – et comme en évaluant nos diverses capacités d’attention -, ce en quoi elle cherchera à marquer le moindre de ses traits – ceux par lesquels elle fait revenir le passé. [...]
C’est une indubitable puissance d’œuvre qui s’impose dans certains des textes écrits non pas tardivement, mais sur-le-champ.
Reconstruire, et non pas après coup, mais au milieu de ce qui arrive : tel est alors l’impératif. Ou plutôt construire autre chose que tout le connu, un témoignage-œuvre qui ne peut tenir que sur soi, ou qui n’ait d’autre appui que le futur le plus hypothétique et dont celui qui parle sera presque certainement exclu.
Nicolas Lapierre, présentant Le livre retrouvé de Simba Guterman, remarque : « à suivre l’architecture du récit (…) il était clair aussi que c’était plus qu’un journal dont la tenue, alors, était tout simplement mortellement dangereuse. Le souci littéraire de l’auteur était évident. »
« Souci littéraire » ? Peut-être. Mais il n’y a rien là d’un supplément esthétique. C'est l’acte même de témoigner qui exige un travail – parfois quasi instantané, fruste, follement pressé – sur toutes les dimensions de la parole.
« Nous sommes le 7 mai 1943. Moi, ingénieur agronome Calel Perechodnik, représentant typique de l’intelligentsia juive, j’entreprends de décrire le sort de ma famille pendant l’occupation allemande. Ce n’est pas une œuvre littéraire, je n’en ai ni l’ambition ni la capacité. Ce n’est pas non plus une histoire des Juifs polonais. C’est l’histoire d’un Juif et de sa famille juive. »
S’il écarte toute visée « littéraire », Perechodnik va en revanche parler – et avec quelle rage ! - d’« œuvre ». C’est la seule réponse qu’il puisse tenter à ce qui lui est arrivé et à quoi il se reproche d’avoir participé. [...]
Dans la petite ville d’Otwock, en Pologne, en février 1943, Calel Perechodnik s’était engagé dans la police juive pour, écrit-il, « éviter les rafles et les camps ». Il dut assister à la déportation de sa femme et de sa fille non seulement dans l’impuissance, mais avec un atroce sentiment de culpabilité.[...]
Ce n’est pas une œuvre « littéraire », nous avertit Perechodnik. Il reste que l’on pourrait penser, en lisant ce qu’il veut « œuvre », à des cas où la littérature, précisément, a été portée au point où elle risquait de perdre ses droits ou sa possibilité sous l’effet de la privation la plus cruelle.
La mort de l’enfant est au cœur des Contemplations de Hugo – et le poète tente d’y inclure aussi le silence. Mais Mallarmé, lui (alors qu’il a écrit des « Tombeaux » de Baudelaire, Verlaine, Poe ou Gautier), n’est pas parvenu à réaliser après la mort de son fils, un « tombeau d’Anatole ». Il disait, avouera-t-il plus tard à sa fille Geneviève, admirer ou envier ce qu’avait réalisé Hugo dans les Contemplations. « Moi, avouait-il, je n’ai pas pu. »
Du réel où la parole s’arrête, où le poème semble incongru, à rejeter : telle s’objecte, chez Mallarmé, la mort de l’enfant. Cependant, on a des notes de Mallarmé – qui ont été publiées et où la poésie ou le langage comme tels sont soupesés par rapport à l’évènement nu. Il n’y a pas eu, de sa part, un pur silence. Et l’opposition avec Hugo n’est pas simple. Chez tous deux la pensée et l’élaboration poétique, avec de violents renversements (inscrits dans le texte publié chez Hugo, cantonnés dans les ébauches sans œuvre chez Mallarmé), se sont rebellés contre la séparation – avec acharnement, comme une continuité à nourrir et de telle façon que la poésie en soit secrètement transformée.
Or ici il s’agit de tout autre chose. Ce sont des assassinats – non une mort par accident, comme pour la fille de Hugo, ou par maladie, comme pour le petit garçon de Mallarmé. Ces morts sont marquées par la haine et la volonté de détruire davantage que la vie. Elles ont été inscrites dans un ordre entier qui est venu trouver là sa confirmation. Et cet ordre n’a-t-il pas de surcroît triomphé en faisant participer cet homme, Perechodnik, à son organisation, en faisant de lui un élément de son mécanisme, en l’utilisant pour refermer son piège.[...]
*
Avons-nous renoncé à la question de la littérature ?
A ne plus considérer le témoignage exclusivement selon son contenu factuel, mais comme acte où se trouvent impliqués, voire problématiquement reformés, tous les rapports et liens dans lesquels quelqu’un existe ou aura existé, c’est à des intrications singulières du témoignage et de l’œuvre qu’il faut apprendre à prêter attention. Opposer la validité historique à la reconstruction par le témoin – qui ne serait jamais qu’individuelle, subjective, exposée aux erreurs, rebelle à la critique – ne nous suffit évidemment plus. L’acte de témoigner et sa reprise en œuvre ne peuvent être soumis à de pareilles dichotomies. Il y a là, en revanche, de quoi interroger plus précisément toute mise en œuvre littéraire du témoignage.
__________
Claude Mouchard, Qui si je criais… ? Œuvres-témoignages dans les tourmentes du XXe siècle, Laurence Teper, Paris, 2007, p. 26-28 et 59-63
Augustin Leroy
05/03/2022
Pourquoi nommer « littéraire » ou « littérature » les textes qui témoignent des « tourmentes du XXe siècle[1] » ? La question est à double tranchant : elle touche à la définition de la littérature – qui est variable non seulement historiquement, mais aussi, comme l’ont montré les travaux d’Hélène Merlin-Kajman[2], moralement, en fonction des mondes que les lecteurs (privés, enseignants, critiques, institutions) inventent et transmettent par son usage. Mais elle touche également à la définition du témoignage et à sa valeur, qui, parce que possiblement littéraire, excèderait les « différentes composantes, historique, politique, morale, judiciaire » de celui-ci.
Claude Mouchard, dans Qui si je criais… ?, pose cette question à double tranchant sans, pour autant, trancher. D’un côté, il reconnaît, dans la catégorie des « œuvres-témoignages », qu’il est le seul, à ma connaissance, à mobiliser, « un rapport littéraire au lecteur indéterminé. » De l’autre, lisant des passages de « Suis-je un meurtrier », de Calel Perechodnik, et à la suite de celui-ci, il atténue « toute visée "littéraire" » de l’œuvre-témoignage et s’inquiète de l’effet qu’un « supplément esthétique » aurait sur la puissance de vérité d’une œuvre écrite « sur le champ », au plus près de l’horreur de l’extermination.
Méfiance, donc, envers l’effet généré par la littérarisation des témoignages ou leur institutionnalisation comme genre littéraire. C’est que, selon Mouchard, « l’ici et maintenant » où se démènent les écritures tourmentées est de tout autre nature que les tourments vécus et mis en œuvre par les auteurs reconnus par la tradition et l’institution littéraire. Prenant l’exemple de Hugo et Mallarmé ayant perdu leur enfant, tout comme Perechodnik a perdu sa fille, il distingue néanmoins le trauma privé, aléatoire, de la perte d’un enfant, de la violence historique de l’extermination (dont Perechodnik devient, malgré lui, un agent – il est donc et bourreau et victime). Aux yeux de Claude Mouchard,« ici il s’agit de tout autre chose. Ce sont des assassinats – non une mort par accident, comme pour la fille de Hugo, ou par maladie, comme pour le petit garçon de Mallarmé. »
Est-il possible de sortir de cette opposition entre, d’un côté, la littérarité commune à ces œuvres – une puissance de destination arrachée in extremis à la violence de la perte – et de l’autre côté, le décalage (le « tout autre chose » défendu par Claude Mouchard) généré par le contexte de leur création, qui, les arrimant à un évènement passé qu’elles transportent avec eux, leur donne pour seule valeur de « témoigner » de ce qui a eu lieu ?
Au fond, on pourrait formuler la question autrement, à partir de la figure du récepteur plutôt que de la nature de l’œuvre : quelle écoute accorder à ces textes ? La question reste difficile, puisqu’à nouveau, la discipline dont se revendique tel ou tel lecteur déterminera l’amplitude des effets de l’œuvre en question. Faut-il l’écouter comme un document chargé « d’un contenu et d’une transmission si spécifiques », ce qui impliquerait que l’œuvre-témoignage n’est que ce dont elle témoigne ? Ou est-il possible, - ce sera l’hypothèse que j’aimerais défendre – d’imaginer un lecteur qui, ignorant tout du XXe siècle en tant que tel, puisse recevoir, écouter et reconnaître un je ne sais quoi, ça, la pulsion, ultime tentative d’une voix qui, en l’absence de destinataires externes doués de visage, invente son propre interlocuteur (« cet interlocuteur-ami idéal » que théorise Mandelstam[3] et qu’évoque Mouchard au début de l’extrait), un « tu » interne, dernier point de résistance « contre l’entreprise totalitaire d’étouffer les voix des témoins » ?
J’emprunte l’hypothèse d’un « tu » intime à la lecture que la psychanalyste Marcianne Blévis[4] opère à propos de Dori Laub et de la « disparition du "tu" intérieur dans les traumas extrêmes », parce que je crois qu’elle se pose, en des termes différents, une question proche de celle que porte le texte de Mouchard, lorsqu’elle se demande ce que signifie l’expression de Dori Laub, « trauma psychique massif » :
Qu’est-ce qu’un trauma psychique massif ? À son origine, une agression elle aussi massive, avance Dori Laub. Ces mots sont rarement employés. Désignent-ils un régime traumatique très différent de ceux qui sont extrêmement singuliers voire banals, ou bien éclairent-ils un aspect, resté dans l’ombre, de tous les traumatismes ?
La question de Marcianne Blévis me semble correspondre à l’interrogation de Mouchard, qui questionne la pertinence de l’analogie entre le tourment vécu et porté par l’œuvre de Perechodnik et celui dont témoignent Hugo et Mallarmé, identifiés « à des cas où la littérature, précisément, a été portée au point où elle risquait de perdre ses droits ou sa possibilité sous l’effet de la privation la plus cruelle. ». Si je reformule en entremêlant les termes, ma question serait : les œuvres-témoignage désignent-elles un régime d’écriture et d’adresse des tourments très différent de celui qui est reconnu comme littéraire (Hugo, Mallarmé, bien d’autres encore) ou bien éclairent-elles un aspect, resté dans l’ombre, de toute littérature ?
Autrement dit : la littérature n’est-elle pas toujours une affaire de langage et de tourments, les « œuvres-témoignages » devenant alors les tentatives les plus radicales, les plus exposées, de mettre en relation un « je » et un « tu », selon une configuration où le « je » et le « tu » se croisent, se reconnaissent et s’écoutent, dans l’épreuve de leur commune altérité ?
Si j’en reviens à la fiction de mon lecteur anhistorique, que j’imagine martien, ou d’une humanité tellement éloignée dans le temps qu’elle a oublié le savoir historique positif constitué autour du XXe siècle, celui-ci pourra-t-il écouter ce qui, dans le texte de Perechodnik comme dans tant d’autres (Imre Kertèsz, Robert Antelme, Primo Lévi, mais aussi Varlam Chalamov, rescapé des camps soviétiques, ou Tôge Sankichi, auteur des Poèmes de la bombe atomique), cherche désespérément à protéger une zone à la fois « intrapsychique » et « intersubjective », un lien entre l’intériorité d’un « tu » et un espace de partage où ce « tu » existe à l’endroit de l’autre qui aide, par sa présence, « à verser la solitude traumatique, qui menace toujours, au compte du défi d’exister. [5] » ?
Je le crois – c’est une conviction, un engagement qui repose sur de l’indémontrable, que je sais fragile, instable – et qui pourtant me souffle son évidence.
Toutefois, j’ai escamoté une série de problèmes, en ne prenant la littérature qu’à partir de la double figure de l’écoute-adresse, comme si entre le texte et mon lecteur imaginaire (oui, mon « tu » interne se rêve martien. Et alors ?) il n'y avait pas besoin d’intermédiaires [6], de relais offrant à ce lecteur le texte et le contexte. Comme l’écrit Hélène Merlin-Kajman dans l’Animal ensorcelé à propos des œuvres-témoignages, le commentaire « littéraire » doit ici impérativement s’accompagner de références historiques, mais à certaines conditions. Il ne s’agit pas, selon elle, de faire
l’histoire rhétorique ou « littéraire » du genre des œuvres-témoignages ; ni l’histoire sociale des auteurs ; car de telles histoires, en mobilisant les paramètres d’une rationalité surplombante, font perdre au geste tout son sens de geste, une fois placé dans la distance et la perspective d’un objet de connaissance. Ici plus que jamais, le texte doit rester pris dans la relation du don.
L’œuvre-témoignage n’est pas une catégorie comme pourraient l’être le roman, la poésie ou le théâtre. C’est le cas-limite où une œuvre de langage active, au plus près de l’anéantissement, la possibilité de sa survie et de sa transmissibilité en tant que parole ayant existé. Si cette parole propose un savoir, ce savoir est moins de l’ordre d’un savoir positif sur l’histoire que de l’ordre de ce que M. Blévis appelle un « savoir du traumatique [7]» – le développement de la capacité à écouter et sentir la vulnérabilité humaine.
Suis-je en train de dé-historiciser l'approche des œuvres-témoignage et de leur donner une valeur exemplaire ou identificatoire, essentialisant du même coup « la littérature » par le détour à travers le lieu « hors-temps » de la psychanalyse ? C'est le risque, en effet, et c'est pourquoi je ne disqualifie certainement pas la validité et l’utilité de l’histoire pour « baliser » la réception des œuvres-témoignages et éviter « que la détresse qui [les] oriente ne devienne matière à enchantements et à sidérations imaginaires » (H. Merlin-Kajman). Mais ce n’est pas pour rien que j’imaginais un lecteur « martien » : je me demande si, entre Hugo et Perechodnik en passant par Mallarmé, il s’agit vraiment de « tout autre chose », comme le suggère Mouchard et, d’une autre façon, Hélène Merlin-Kajman. Ce n’est pas un hasard selon moi si les deux exemples qu’il choisit interpellent la perte de l’enfant – comme c’est aussi le cas chez M. Blévis, qui analyse en dernier lieu le trauma d’une femme dont le bébé a été arraché de ses bras par les nazis. Je pense que pour Hugo, Mallarmé, Perechodnik et cette jeune femme, la mort de l’enfant menace la possibilité de toute adresse, abîmant, parfois détruisant l’existence du « tu » interne. Ce n’est donc pas « tout autre chose », et les phrases des uns et des autres peuvent s’écouter et se répondre, à condition de leur donner une configuration critique qui mette en jeu, également, le « tu » interne du commentateur, critique ou professeur - d’un intermédiaire chargé de l’autorité de la transmission.
En un mot, j’imagine qu’il y a du commun entre ces œuvres et je me demande s’il serait possible de constituer un corpus qui fasse le pari de ce commun à condition que la vigilance et la délicatesse poussent l’adulte à s’assurer que le don destiné à l’enfant – qu’il soit disparu, interne, ou dans une salle de classe – ne soit pas que le don d’un enfant mort, mais la preuve sensible qu’il y a du lien, toujours, en dépit des fatalités de l’existence, des crimes de l’histoire et de ses « tourments » massifs.
[1] Le titre du livre de Mouchard, « Qui si je criais… ? Oeuvres-témoignages dans les tourmentes du XXe siècle », mériterait un long commentaire. J’attire simplement l’attention du lecteur sur l’emploi du mot « tourmentes ». Il manifeste la distance que prend l’auteur vis-à-vis des disciplines de l’histoire et du droit et de la psychanalyse, comme si leurs catégories ne pouvaient pas rendre compte des multiples facettes de ce que la tourmente désigne. Si la version féminine du mot évoque une tempête subite, précipitée, l’amplitude du spectre sémantique du mot masculin est également frappante : issu du « tormentum » latin, qui désigne aussi bien une machine de guerre qu’un instrument de torture, le tourment renvoie aussi bien à la douleur physique qu’à la souffrance psychique. Il implique donc de prêter attention aux causes autant qu’aux effets, à l’intériorité de la douleur vécue comme à l’extériorité des évènements où elle advient. En un mot, je crois que le mot de « tourment / tourmente », chez Mouchard, est une traduction, en littérature, du terme psychanalytique de trauma – qu’il faut distinguer de celui de traumatisme, qui suppose l’extériorité de l’évènement et de la cause traumatique.
[2] On citera, à titre d’exemples récents, Lire dans la gueule du loup (Gallimard, 2015), L’Animal ensorcelé (Ithaque, 2016) et La littérature à l’heure de #MeToo (Ithaque, 2020).
[3] Ossip Mandelstam, « De l’interlocuteur », consultable sur le site de Po&sie, n°35, 1985 ( https://po-et-sie.fr/texte/de-linterlocuteur/ , consulté le 4 mars 2022)
[4] Marcianne Blévis , « À propos de la disparition du “tu” intérieur dans les traumas extrêmes : une lecture de Dori Laub », intervention donnée lors du colloque de Transitions « Littérature et trauma », et publiée sur le site de Transitions (https://www.mouvement-transitions.fr/index.php/intensites/litterature-et-trauma/sommaire-de-litterature-et-trauma/1643-n-4-m-blevis-a-propos-de-la-disparition-du-tu-interieur-dans-les-traumas-extremes-une-lecture-de-dori-laub#_ftnref9)
[5] Idem
[6] En réalité, le livre de Mouchard occupe cette fonction intermédiaire dans mon commentaire. Mais rien ne permet d’universaliser la délicatesse vigilante et attentive dont il fait preuve, dans et par son écriture.
[7] Hélène-Merlin Kajman, L’Animal ensorcelé. Traumatismes, littérature, transitionnalité , Ithaque, Paris 2016, p. 434. L’auteure souligne.