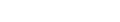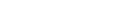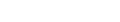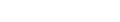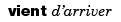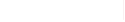Conversation critique n°14.1
En réalité, l’historicité qui apparaît au XIXe siècle dans le domaine de la littérature est une historicité d’un type tout à fait spécial et qu’on ne peut en aucun cas assimiler à celle qui a assuré la continuité ou la discontinuité de la littérature jusqu’au XVIIIe siècle. L’historicité de la littérature au XIXe siècle ne passe pas par le refus des autres œuvres, ou leur recul, ou leur accueil ; l’historicité de la littérature au XIXe siècle passe obligatoirement par le refus de la littérature elle-même, et ce refus de la littérature, il faut le prendre dans tout l’écheveau très complexe de ses négations. Chaque acte littéraire nouveau, que ce soit celui de Baudelaire, de Mallarmé, des surréalistes, peu importe, implique au moins, je crois, quatre négations, quatre refus, quatre tentatives d’assassinat : refuser d’abord la littérature des autres ; deuxièmement refuser aux autres le droit même à faire de la littérature, contester que les œuvres des autres soient de la littérature ; troisièmement se refuser à soi-même, se contester à soi-même le droit de faire de la littérature ; et enfin, quatrièmement, refuser de faire ou de dire autre chose dans l’usage du langage littéraire que le meurtre systématique, accompli, de la littérature.
Donc on peut dire, je crois, qu’à partir du XIXe siècle tout texte littéraire se donne et prend conscience de lui-même comme une transgression de cette essence pure et inaccessible que serait la littérature. Et pourtant, en un autre sens, chaque mot, à partir du moment où il est écrit sur cette fameuse page blanche à propos de laquelle nous nous interrogeons, chaque mot pourtant fait signe. Il fait signe à quelque chose car il n’est pas comme un mot normal, comme un mot ordinaire. Il fait signe à quelque chose qui est la littérature ; chaque mot, à partir du moment où il est écrit sur cette page blanche de l’œuvre, est une sorte de clignotant qui cligne vers quelque chose que nous appelons la littérature. Car, à dire vrai, rien, dans une œuvre de langage, n’est semblable à ce qui se dit quotidiennement. Rien n’est du vrai langage, je vous mets au défi de trouver un seul passage d’une œuvre quelconque que l’on puisse dire emprunté réellement à la réalité du langage quotidien.
Et quelquefois je sais bien que cela se produit, je sais bien qu’un certain nombre de gens ont prélevé des dialogues réels, quelquefois même enregistrés au magnétophone, comme Butor vient de le faire pour sa description de San Marco, où il a collé sur la description même de la cathédrale les bandes magnétiques reproduisant le dialogue des gens qui visitaient la cathédrale et faisaient les commentaires dont les uns concernaient la cathédrale elle-même, et dont les autres concernaient la qualité des « ice creams » que l’on peut manger sur place.
Mais l’existence d’un langage réel ainsi prélevé et introduit dans l’œuvre littéraire, quand cela se produit, ce n’est pas plus qu’un papier collé dans un tableau cubiste. Le papier collé, dans un tableau cubiste, il n’est pas là pour faire « vrai », il est là au contraire pour trouer en quelque sorte l’espace du tableau, et c’est de la même façon que le langage vrai, quand il est introduit réellement dans une œuvre littéraire, est placé là pour trouer l’espace du langage, pour lui donner en quelque sorte une dimension sagittale qui, en fait, ne lui appartiendrait pas naturellement. Si bien que l’œuvre n’existe finalement que dans la mesure où à chaque instant tous les mots sont tournés vers cette littérature, sont allumés par la littérature, et en même temps, l’œuvre n’existe que parce que cette littérature est en même temps conjurée et profanée, cette littérature qui pourtant soutient chacun de ces mots et dès le premier.
On peut donc dire, si vous voulez, qu’au total, l’œuvre comme irruption disparaît et se dissout dans le murmure qu’est le ressassement de la littérature ; il n’y a pas d’œuvre qui ne devienne par là un fragment de littérature, un morceau qui n’existe que parce qu’il existe autour d’elle, en avant et en arrière, quelque chose comme la continuité de la littérature.
Il me semble que ces deux aspects, de la profanation et puis de ce signe perpétuellement renouvelé de chaque mot vers la littérature, il me semble que ceci permettrait d’esquisser en quelque sorte deux figures exemplaires et paradigmatiques de ce qu’est la littérature, deux figures étrangères et qui peut-être pourtant s’appartiennent.
L’une serait la figure de la transgression, la figure de la parole transgressive, et l’autre au contraire serait la figure de tous ces mots qui pointent et font signe vers la littérature ; d’un côté donc la parole de transgression, et d’un autre côté ce que j’appellerais le ressassement de la bibliothèque. L’une, c’est la figure de l’interdit, du langage à la limite, c’est la figure de l’écrivain enfermé ; l’autre au contraire, c’est l’espace des livres qui s’accumulent, qui s’adossent les uns aux autres, et dont chacun n’a que l’existence crénelée qui le découpe et le répète à l’infini sur le ciel de tous les livres possibles.
Il est évident que Sade a articulé le premier, à la fin du XVIIIe siècle, la parole de transgression ; on peut même dire que son œuvre, c’est le point qui à la fois recueille et rend possible toute parole de transgression. L’œuvre de Sade, il n’y a aucun doute, c’est le seuil historique de la littérature. [...]
Il n’y a absolument aucun doute que la contemporanéité de Sade et de Chateaubriand n’est pas un hasard dans la littérature. D’entrée de jeu, l’œuvre de Chateaubriand, dès sa première ligne, veut être un livre, elle veut se maintenir à ce niveau d’un murmure continue de la littérature, elle veut se transposer aussitôt dans cette espèce d’éternité poussiéreuse qu’est celle de la bibliothèque absolue. Tout de suite, elle vise à rejoindre l’être solide de la littérature, faisant ainsi reculer dans une sorte de préhistoire tout ce qui a pu être dit ou écrit avant lui, Chateaubriand. Si bien que, à quelques années près, on peut dire, je crois, que Chateaubriand et Sade constituent les deux seuils de la littérature contemporaine. Atala, ou les amours de deux sauvages dans le désert et La Nouvelle Justine, ou les Malheurs de la vertu, ont vu le jour à peu près en même temps. Bien sûr, ce serait un jeu facile de les rapprocher ou de les opposer, mais ce qu’il faut tenter de comprendre, c’est le système même de leur appartenance, c’est le pli en quoi naît en ce moment, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, dans de telles œuvres, dans de telles existences, l’expérience moderne de la littérature. Cette expérience, je crois qu’elle n’est pas dissociable de la transgression et de la mort, elle n’est pas dissociable de cette transgression dont Sade a fait toute sa vie et dont il a payé d’ailleurs ce prix de liberté que vous savez ; quant à la mort, vous savez aussi qu’elle a hanté Chateaubriand dès le moment où il a commencé à écrire, il était évident pour lui que la parole qu’il écrivait n’avait de sens que dans la mesure où il était en quelque sorte déjà mort, dans la mesure où cette parole flottait au-delà de sa vie et au-delà de son existence.
Michel Foucault, « Littérature et langage » [1964], dans La Grande étrangère. À propos de la littérature, éd. EHESS, 2013, p. 83-89.
Augustin Leroy
08/01/2022
Ce texte de Michel Foucault me donne envie d’aller à la pêche.
Il me donnerait presque le dégoût de la littérature, tant j’ai l’impression d’y retrouver une phraséologie surannée et surtout, a-critique. Comment l’auteur de l’Archéologie du savoir peut-il écrire des phrases comme « Sade, c’est le paradigme même de la littérature » ou encore « L’œuvre de Sade, il n’y a aucun doute, c’est le seuil historique de la littérature », sans interroger les raisons objectives de cette périodisation, en multipliant les présents de vérité générale et en invoquant la littérature comme une figure mystique, « essence pure et inaccessible », qui aurait trouvé le lieu de sa réalisation dans la modernité ?
Décidément, j’ai vraiment envie d’aller à la pêche, même s’il fait moche et qu’il pleut des grosses gouttes froides et picardes. Même les poissons, à part quelques carnassiers affamés, sont allés faire la sieste au fond des eaux grises, entre les branches et la vase. Au moins, là, il y aurait quelque chose, de l’ordinaire.
Justement, comme exemple de ce que serait l’ordinaire du langage, Foucault évoque Butor et le brouhaha du flot touristique. « Ice-cream » devient le modèle même de la trivialité du langage, un mot de la tribu, la tribu des mangeurs de glace qui ne peuvent pas, dans leur ignorance crasse, apprécier les qualités architecturales de Saint-Marco.
Pourtant, les glaces, c’est bon, ça coule, ça colle et ça fond, ça fait grossir et mal aux dents, on mange en secret la dernière (mais, hélas, l’emballage sur le dessus de la poubelle trahit le gourmand), on en fait cadeau, on s’en souvient lorsqu’on ne peut plus en manger… On peut faire l’expérience du temps, perdu, retrouvé, collant, manquant ou fondu, au contact d’un Magnum ou d’un cornet, qui sont par ailleurs moins sinistres qu’une ostie ou un crucifix.
Pourquoi la littérature ne serait-elle pas une œuvre du langage ordinaire ? « Allô », c’est un poème : ça veut dire qu’il y a quelqu’un, que ce quelqu’un répond – en vie, chaud, précaire. La ligne peut couper.
La Grande Absente, elle, on risque pas de la perdre, par définition…
Foucault détermine l’historicité singulière de la littérature moderne autour de deux figures, celle de la transgression et celle de l’accumulation, Sade et Chateaubriand. Le lieu de la seconde figure, c’est la bibliothèque, ou « l’espace des livres qui s’accumulent, qui s’adossent les uns aux autres, et dont chacun n’a que l’existence crénelée qui le découpe et le répète à l’infini sur le ciel de tous les livres possibles ».
Ou encore « espèce d’éternité poussiéreuse »… - Vite, ma canne à pêche !
S’il est un concept de Foucault qui me transporte, c’est celui d’hétérotopie, qui désigne les « espaces différents, ces autres lieux », et qu’il développera dans un texte datant de 1967[1], mais dont il n’autorisera la publication qu’en 1984. Constitutive de l’idée de culture, parce qu’elle implique que des espaces sacrés puissent accueillir des gestes de profanation, juxtaposant plusieurs espaces incompatibles, tressant des temporalités hétérogènes, l’hétérotopie pourrait, je crois, être une façon de dire l’espace littéraire. Rien de très original là-dedans, j’imagine que d’autres y ont déjà pensé. Foucault donne d’ailleurs comme exemple d’hétérotopies la bibliothèque - mais également la prison, le miroir, le bateau ou le cimetière.
Je ne sais comment dire ma perplexité face à l’écart entre la conceptualisation géniale de cette notion et la définition de la littérature que défend Foucault dans La Grande Etrangère. Sans parler de la bibliothèque, qui y apparaît comme un cimetière livresque où s’élabore la relation avec les morts, certes, mais seulement depuis le point de vue de la mort, comme parole « d’outre-tombe ». Pourtant, lorsque Chateaubriand raconte, dans les premières pages des Mémoires, que, face à la sévérité de sa tante qui guette la moindre de ses incartades, il s’est un jour décidé à faire « tout le mal qu’on attendait de lui », je ne sens pas l’ombre de la mort qui passe, mais la colère de l’enfance qui éclate, la sienne, la mienne et celles d’autres enfants qui naîtront. Non, Chateaubriand n’a pas écrit seulement dans « la mesure où il était en quelque sorte déjà mort ». Pas tant que je le lirai.
Il est vrai qu’on pourrait m’opposer que l’articulation de ces deux pôles, transgression et accumulation, forme la structure de l’hétérotopie. Je répondrais que ce qui la caractérise, ce n’est pas seulement une structure, mais aussi une visée, qui se destine, comme le bateau de mes rêves, à « la plus grande réserve d’imagination ». Sans se confondre avec elle, l’hétérotopie est aussi une utopie.
« Dans les civilisations sans bateaux les rêves se tarissent, l'espionnage y remplace l'aventure, et la police, les corsaires. », écrit Foucault en conclusion de son merveilleux texte sur les hétérotopies. C’est pourquoi je suis contre le meurtre des bateaux et, du même coup, contre le meurtre de la littérature - meurtre dont la résolution serait aujourd’hui confiée à Rantanplan, le nullissime chien policier de Lucky Luke.
D’ailleurs, finissant d’écrire, ce n’est plus à la pêche que j’ai envie d’aller mais à la mer, pour embarquer, cette fois, avec Foucault. La Grande Etrangère restera à quai. Bon vent !
_______________________________
[1] Michel Foucault, Dits et écrits,1984, Tome IV, texte 360.