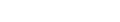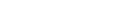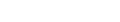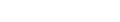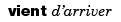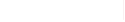Conversation critique n°13.1
Moment important que celui où une société a prêté des mots, des tournures et des phrases, des rituels de langage à la masse anonyme des gens pour qu’ils puissent parler d’eux-mêmes – en parler publiquement et sous la triple condition que ce discours soit adressé et mis en circulation dans un dispositif de pouvoir bien défini, qu’il fasse apparaître le fond jusque-là à peine perceptible des existences et qu’à partir de cette guerre infime des passions et des intérêts il donne au pouvoir la possibilité d’une intervention souveraine. L’oreille de Denys était une petite machine bien élémentaire si on la compare à celle-ci. Comme le pouvoir serait léger et facile, sans doute, à démanteler, s’il ne faisait que surveiller, épier, surprendre, interdire et punir ; mais il incite, suscite, produit ; il n’est pas simplement œil et oreille ; il fait agir et parler.
Cette machinerie a sans doute été importante pour la constitution de nouveaux savoirs. Elle n’est pas étrangère non plus à tout un nouveau régime de la littérature. Je ne veux pas dire que la lettre de cachet est au point d’origine de formes littéraires inédites, mais qu’au tournant du XVIIe et du XVIIIe siècle les rapports du discours, du pouvoir, de la vie quotidienne et de la vérité se sont noués sur un mode nouveau où la littérature se trouvait elle aussi engagée.
La fable, selon le sens du mot, c’est ce qui mérite d’être dit. Longtemps, dans la société occidentale, la vie de tous les jours n’a pu accéder au discours que traversée et transfigurée par le fabuleux ; il fallait qu’elle soit tirée hors d’elle-même par l’héroïsme, l’exploit, les aventures, la Providence et la grâce, éventuellement le forfait ; il fallait qu’elle soit marquée d’une touche d’impossible. C’est alors seulement qu’elle devenait dicible. Ce qui la mettait hors d’accès lui permettait de fonctionner comme leçon et exemple. Plus le récit sortait de l’ordinaire, plus il avait de force pour envoûter ou persuader. Dans ce jeu du « fabuleux exemplaire », l’indifférence au vrai et au faux était donc fondamentale. Et s’il arrivait qu’on entreprenne de dire pour elle-même la médiocrité du réel, ce n’était guère que pour provoquer un effet de drôlerie : le seul fait d’en parler faisait rire.
Depuis le XVIIe siècle, l’Occident a vu naître toute une « fable » de la vie obscure d’où le fabuleux s’est trouvé proscrit. L’impossible ou le dérisoire ont cessé d’être la condition sous laquelle on pourrait raconter l’ordinaire. Naît un art du langage dont la tâche n’est plus de chanter l’improbable, mais de faire apparaître ce qui n’apparaît pas – ne peut pas ou ne doit pas apparaître : dire les derniers degrés, et les plus ténus, du réel. Au moment où on met en place un dispositif pour forcer à dire l’« infime », ce qui ne se dit pas, ce qui ne mérite aucune gloire, l’« infâme » donc, un nouvel impératif se forme qui va constituer ce qu’on pourrait appeler l’éthique immanente au discours littéraire de l’Occident : ses fonctions cérémonielles vont s’effacer peu à peu ; il n’aura plus pour tâche de manifester de façon sensible l’éclat trop visible de la force, de la grâce, de l’héroïsme, de la puissance ; mais d’aller chercher ce qui est le plus difficile à apercevoir, le plus caché, le plus malaisé à dire et à montrer, finalement le plus interdit et le plus scandaleux. Une sorte d’injonction à débusquer la part la plus nocturne et la plus quotidienne de l’existence (quitte à y découvrir parfois les figures solennelles du destin) va dessiner ce qui est la ligne de pente de la littérature depuis le XVIIe siècle, depuis qu’elle a commencé à être littérature au sens moderne du mot. Plus qu’une forme spécifique, plus qu’un rapport essentiel à la forme, c’est cette contrainte, j’allais dire cette morale, qui la caractérise et en a porté jusqu’à nous l’immense mouvement : devoir de dire les plus communs des secrets. La littérature ne résume pas à elle seule cette grande politique, cette grande éthique discursive ; elle ne s’y ramène pas non plus.entièrement ; mais elle y a son lieu et ses conditions d’existence.
De là son double rapport à la vérité et au pouvoir. Alors que le fabuleux ne peut fonctionner que dans une indécision entre vrai et faux, la littérature, elle, s’instaure dans une décision de non-vérité : elle se donne explicitement comme artifice, mais en s’engageant à produire des effets de vérité qui sont reconnaissables comme tels ; l’importance qu’on a accordée, à l’époque classique, au naturel et à l’imitation est sans doute l’une des premières façons de formuler ce fonctionnement « en vérité » de la littérature. La fiction a dès lors remplacé le fabuleux, le roman s’affranchit du romanesque et ne se développera que de s’en libérer toujours plus complètement. La littérature fait donc partie de ce grand système de contrainte par lequel l’Occident a obligé le quotidien à se mettre en discours ; mais elle y occupe une place particulière : acharnée à chercher le quotidien au-dessous de lui-même, à franchir les limites, à lever brutalement ou insidieusement les secrets, à déplacer les règles et les codes, à faire dire l’inavouable, elle tendra donc à se mettre hors la loi ou du moins à prendre sur elle la charge du scandale, de la transgression ou de la révolte. Plus que toute autre forme de langage, elle demeure le discours de l’« infamie » : à elle de dire le plus indicible – le pire, le plus secret, le plus intolérable, l’éhonté. La fascination qu’exercent l’une sur l’autre, depuis des années, psychanalyse et littérature est sur ce point significative. Mais il ne faut pas oublier que cette position singulière de la littérature n’est que l’effet d’un certain dispositif de pouvoir qui traverse en Occident l’économie des discours et les stratégies du vrai.
Michel Foucault, « La vie des hommes infâmes», dans Dits et écrits , Tome III, Gallimard, 1994, p.251-253.
Benoît Autiquet
04/12/2021
Récemment, mon attention a été attirée par une collection des éditions « La Découverte », intitulée « À la source ». L’ouvrage d’Arlette Farge Vies oubliées[1] l’a inaugurée en 2019 ; plus récemment, Jérémy Foa a fait paraître Tous ceux qui tombent[2], récit du massacre de la Saint-Barthélemy à travers ses acteurs les plus humbles, qu’ils soient bourreaux ou victimes. Dans ces deux ouvrages, le célèbre texte de Foucault, « La vie des hommes infâmes », est cité en introduction. On retrouve aussi cette veine foucaldienne dans la présentation de la collection qui est donnée par la maison d’édition sur une page des Rendez-vous de l’Histoire de Blois[3]. Il s’agit de faire droit à « telle pièce d’archive », que l’on a « la joie, mais aussi souvent l’embarras » de découvrir, et qui fait entendre des « voix dissidentes, menues et puissantes cependant ». Or, ces « sources discordantes » sont « trop souvent tues ou négligées » ; la collection se donne pour but de les mettre en lumière. A l’horizon, « il y aura le plaisir de l’objet découvert, l’archive décalée, le personnage historique insolite ou l’évènement banal ». « Joie », « plaisir », « embarras » aussi : c’est à une appréhension sensible de l’archive que les éditeurs nous invitent. Et, comme adossé au trouble esthétique suscité par l’archive, il y a le geste de faire entendre une voix dissidente que le pouvoir – politique et disciplinaire – aurait enfouie. Cette esthétique historienne est aussi une politique.
Cet agencement est déjà chez Foucault, au tout début des « hommes infâmes ». Foucault raconte sa rencontre avec les pièces d’archives que le lecteur s’apprête à découvrir dans la suite du livre. Il écrit : « j’avoue que ces "nouvelles", surgissant soudain à travers deux siècles et demi de silence, ont secoué en moi plus de fibre que ce qu’on appelle la littérature »[4]. Moi qui ai d’abord voulu faire de l’histoire, moi qui n’ai pas été, dès ma tendre enfance, un lecteur passionné de romans, je souscris tout à fait à cette phrase. La nécessité d’« avouer » en moins, cela dit : l’idée qu’un document peut susciter plus de plaisir qu’un récit artificiellement composé paraît presque banale aujourd’hui, ne serait-ce qu’avec l’avènement esthétique du documentaire. Du reste, il me semble que les livres de Farge et de Foa, dans lesquelles l’écriture est particulièrement travaillée, relèvent de cette entreprise qui consiste à souligner l’impression esthétique d’un document qui n’a pas été, à l’origine, composé avec art.
J’adhère donc spontanément. Mais cette adhésion commence à me lasser. Surtout, je me demande s’il est vrai qu’il suffit de retourner « à la source » pour rendre « puissantes » ces voix « menues » ; je me demande si, dans cet apparent effacement des prétentions esthétiques de l’auteur devant le « surgissement » de ces voix – qui suffirait, par lui-même, à émouvoir le lecteur –, il n’y a pas, pour ces voix mêmes, le risque d’une disparition. « Puissantes », ces voix ne le sont peut-être pas d’elles-mêmes ; et il faut la maîtrise d’un certain art pour les rendre audibles. À mon tour de faire un aveu : je me suis parfois beaucoup ennuyé à lire les longs extraits d’archives publiés dans la collection « À la source ».
Il est d’autres manières d’appréhender Foucault aujourd’hui. En 2019, Jean-Claude Monod a proposé une réflexion sur la politique foucaldienne, qui ne concerne pas directement « la vie des hommes infâmes », mais, me semble-t-il, peut permettre d’y réfléchir. L’auteur souligne qu’au « paradigme disciplinaire », proposé par Foucault dans Surveiller et punir en 1975, se substitue un autre cadre d’analyse, notamment dans ses cours au collège de France de 1977 à 1979. Ce nouveau cadre, Monod le résume ainsi : il s’agit de « prendre au sérieux cette prétention du pouvoir moderne : s’exercer sur des individus libres »[5]. Il y aurait eu, au XVIIIe siècle (mais Foucault en voit les prémisses dès le XVIe siècle) une « refonte de l’art de gouverner », où le « gouvernement » ne se conçoit plus sans la liberté des sujets. « Il faut même, ajoute Monod, créer, favoriser les conditions de la liberté, une liberté pensée non pas négativement, comme la franchise, l’affranchissement, mais comme capacité positive de circulation et de production, liberté de circuler et d’entreprendre, liberté de fixer les prix, etc. »[6]. Bref, il s’agit d’un « nouvel art de gouverner qui articule production de liberté et dispositifs de contrôle ». Et il semble à Monod qu’on puisse lire, dans les cours de la fin des années 70, une « admiration sourde » de la part du philosophe pour cette manière de gouverner[7].
Il me semble qu’il est possible de voir, dans « la vie des hommes infâmes », texte qui date de janvier 1977, les traces de cette évolution de la conception du pouvoir. Mais dans ce texte, la question est intimement liée à celle de la littérature – point que Monod ne traite pas dans son ouvrage. Nous avons vu qu’au début de l’article de Foucault, ce qui pouvait se substituer au plaisir littéraire, c’était un arrachement de l’archive au silence imposé par le pouvoir à une voix dissidente. Le plaisir se gagne alors contre le pouvoir, défini essentiellement comme dispositif disciplinaire. A la fin de l’article – c’est l’extrait que cette « conversation critique » commente –, le rôle de la littérature a changé. Elle est intégrée au dispositif du pouvoir, mais en marge de ce dispositif. Elle est à la fois ce par quoi le pouvoir « fait dire » la vie quotidienne, mais aussi ce qui, à l’intérieur du dispositif, porte l’infâmie de cette vie quotidienne. Ce qui peut procurer un plaisir esthétique, alors, ce n’est pas seulement de trouver dans une archive un document silencié[8] par un pouvoir uniquement disciplinaire, mais c’est de lire la vie quotidienne que le pouvoir, à travers la littérature qui en occupe les marges, a incité à dire.
Pour moi, qui suis un « littéraire » de métier et spécialiste de la fin du XVIe siècle, cette redéfinition importe beaucoup, puisqu’elle change le rapport que l’on peut avoir à la littérature d’Ancien Régime. Ne serait-elle que la voix officielle d’un pouvoir sans commune mesure avec la « vie quotidienne » ? La vraie vie serait-elle dans les archives, et dans les livres des historiens qui présentent les trésors enfouis qu’ils ont déterrés ? Pas forcément. On peut considérer que le développement des « Belles-Lettres », à partir de la fin du XVIe siècle, est la conséquence du développement, en marge des « dignités » qui structurent la société d’Ancien Régime, d’une société de « particuliers » : c’est la redéfinition du « public » identifiée par Hélène Merlin-Kajman[9]. Or, cette publication des « particuliers » à travers les « Belles-Lettres » ne va pas sans risque pour la dignité desdits « particuliers » : il suffit de lire l’effarement du jésuite François Garasse devant la manière dont un Pasquier, un Montaigne, un Théophile de Viau, se présentent publiquement. Il serait certes faux de dire que ces auteurs sont « infâmes » ; mais, aux yeux des tenants d’une société uniquement hiérarchisée par les dignités, ils sont du moins « indignes ». Et cette « indignité » s’articule, dans les Essais par exemple, avec une nette propension à dire « le plus secret » et « l’éhonté » ; Montaigne a fait entrer, pourrait-on dire, la « vie quotidienne » dans la littérature de langue française.
Bref, dans cette définition de la littérature que donne Foucault à la fin de son texte, je trouve cette hypothèse : et si la littérature, dès le début de son existence, avait partie liée avec l’idée de minorité – que Foucault formule pour sa part, d’une manière qu’on pourra juger quelque peu échevelée, par la notion d’« infâmie » ? Et si dès le départ, la littérature s’était évertuée à rendre justice, par le travail de la forme, à des matières « indignes » ?
_______________________________
[1]A. Farge, Vies oubliées. Au cœur du XVIIIe siècle, Paris, La Découverte, 2019.
[2]J. Foa, Tous eux qui tombent. Visages du massacre de la Saint-Barthélemy, Paris, La Découverte, 2021.
[3]https://rdv-histoire.com/Edition-2019-l-Italie/la-source-l-historien-et-ses-archives
[4]M. Foucault, « La vie des hommes infâmes » [1977], dans Collectif Maurice Florence, Archives de l’infâmie, éd. Les Prairies Ordinaires, 2009, p. 7.
[5]J.-C. Monod, L’art de ne pas être trop gouverné, Paris, Seuil, 2019, p. 34.
[6]Ibid., p. 39.
[7]Ibid., p. 46.
[8]Le terme est entré dans le Robert en 2021 ; il est utilisé, à l’origine, pour désigner le silence qu’impose un pouvoir ou une société à des minorités.
[9]Hélène Merlin-Kajman, Public et littérature au XVIIe siècle, Paris, Les Belles-Lettres, 1994 et L’Excentricité académique. Institution, littérature, société, Paris Les Belles Lettres, 2001.