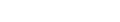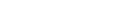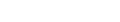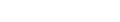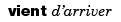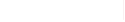Conversation critique n°11.2
À quelques dizaines de mètres de l’immeuble où nous nous étions installés, on construisait la chapelle de style roman dont Léonard Foujita avait dessiné les plans et qu’il allait décorer de fresques murales pour célébrer sa conversion rémoise au christianisme, survenue quelques années plus tôt dans la basilique Saint-Remi. Je ne le sus que bien plus tard : on ne s’intéressait guère à l’art, chez moi, et encore moins à l’art chrétien. Je ne l’ai visitée qu’en écrivant ce livre. Le goût pour l’art s’apprend. Je l’appris. Cela fit partie de la rééducation quasi complète de moi-même qu’il me fallut accomplir pour entrer dans un autre monde, une autre classe sociale – et pour mettre à distance celui, celle d’où je venais. L’intérêt pour la chose artistique ou littéraire participe toujours, consciemment ou non, d’une définition valorisante de soi par différenciation d’avec ceux qui n’y ont pas accès, d’une « distinction » au sens d’un écart, constitutif de soi et du regard que l’on porte sur soi-même, par rapport aux autres – les classes « inférieures », « sans culture ». Combien de fois, au cours de ma vie ultérieure de personne « cultivée », ai-je constaté en visitant une exposition ou en assistant à un concert ou à une représentation à l’opéra à quel point les gens qui s’adonnent aux pratiques culturelles les plus « hautes » semblent tirer de ces activités une sorte de contentement de soi et un sentiment de supériorité se lisant dans le discret sourire dont ils ne se départent jamais, dans le maintien de leur corps, dans leur manière de parler en connaisseurs, d’afficher leur aisance... tout cela exprimant une joie sociale de correspondre à ce qu’il convient d’être, d’appartenir au monde privilégié de ceux qui peuvent se flatter de goûter les arts « raffinés ». Cela m’intimida toujours, mais j’essayai néanmoins de leur ressembler, d’agir comme si j’étais né comme eux, de manifester la même décontraction qu’eux dans la situation esthétique.
Réapprendre à parler fut tout autant nécessaire : oublier les prononciations et les tournures de phrase fautives, les idiomatismes régionaux (ne plus dire qu’une pomme est « fière », mais qu’elle est « acide »), corriger l’accent du Nord-Est et l’accent populaire en même temps, acquérir un vocabulaire plus sophistiqué, construire des séquences grammaticales plus adéquates...bref, contrôler en permanence mon langage et mon élocution. « Tu parles comme un livre », me dira-t-on souvent dans ma famille pour se moquer de ces nouvelles manières, tout en manifestant que l’on savait bien ce qu’elles signifiaient. Par la suite, et c’est encore le cas aujourd’hui, je serai au contraire très attentif, en me retrouvant au contact de ceux dont j’avais désappris le langage, à ne pas utiliser des tournures de phrase trop complexes ou inusitées dans les milieux populaires (par exemple, je ne dirai pas « Je suis allé » mais « J’ai été »), et je m’efforcerai de retrouver les intonations, le vocabulaire, les expressions que, bien que les ayant relégués dans un recoin reculé de ma mémoire et ne les employant plus guère, je n’ai jamais oubliés : pas tout à fait un bilinguisme, mais un jeu avec deux niveaux de langue, deux registres sociaux, en fonction du milieu et des situations.
Didier Éribon, Retour à Reims, Flammarion, 2010, p. 108-109.
Augustin Leroy
02/10/2021
Je ne suis pas un lecteur de sociologie. J’ai un peu lu Bourdieu, Durkheim – c’est tout ce dont je me souviens. Je ne peux dès lors prétendre discuter l’intérêt scientifique que présente ce texte pour la sociologie, même si j’ai le sentiment qu’il n’apporte pas franchement de nouvelles connaissances ou de nouveaux points de vue permettant de faire progresser la réflexion.
Certes, je reconnais Bourdieu dans la notion de « distinction », ainsi que celle « d’habitus », moins explicite, dans l’analyse qu’Eribon propose de l’identité entre un langage et une classe sociale. Mais je crois que Bourdieu me serait, pour ce qui est du déploiement conceptuel de ces notions, une lecture plus utile.
Je suis étonné par la simplicité avec laquelle Eribon déroule son argumentaire, mêlant un vocabulaire analytique à un récit de soi. Je ne crois pas qu’il soit possible de parler d’autobiographie, dans la mesure où ce genre littéraire me semble impliquer qu’entre le « je » qui raconte et le « je » qui est raconté, affleurent des troubles, des anomalies, des hésitations témoignant de différences inhérentes à la construction d’une subjectivité. C’est aussi ce qui, dans une autobiographie, me touche : ce par quoi le sujet qui (s’)écrit, s’expose et se découvre dans l’écriture.
Ici, rien. L’énonciateur semble pouvoir se traverser sans affronter la moindre obscurité. Parlant de l’apprentissage de l’art dont il n’a pas pu bénéficier à cause de son origine sociale, il affirme que « [c]ela fit partie de la rééducation quasi complète de moi-même qu’il me fallut accomplir pour entrer dans un autre monde, une autre classe sociale – et pour mettre à distance celui, celle d’où je venais ». Comment parvient-il à se prendre comme objet d’analyse sociologique tout en éprouvant en sujet cette mise à distance entre soi et ceux qui ont accompagné son enfance ? Cela m’échappe. Eribon semble continuellement seul dans ces lignes, comme si cette rééducation n’avait été que le fruit d’un effort sur soi, par soi. Les figures amicales, professorales, les lectures, les plaisirs esthétiques qui ont pu contribuer à cette transformation sont évacués, comme s’ils n’avaient eu qu’une influence secondaire sur cette métamorphose sociale. Même cette fameuse basilique de Reims, dont l’évocation ouvre le propos, n’existe que dans le présent de l’écriture : « je ne l’ai visitée qu’en écrivant ce livre ». En somme, j’ai le sentiment qu’Eribon n’assigne à l’esthétique qu’une fonction utilitaire : briller en société, augmenter ses aptitudes de caméléon, lui donner l’autorité pour écrire un livre impliquant des considérations sur l’art. Rien de l’esthétique ne semble effleurer le sentir.
Du reste, la peinture ironique que brosse Eribon, lorsqu’il caricature la manifestation des goûts raffinés de la bourgeoisie, relève davantage du stéréotype que d’une réelle analyse sociologique (impossible de savoir, par exemple, si les individus qu’il décrit jouissant de leur capital culturel ne sont pas, comme lui, des transfuges de classe mimant « dans le maintien de leur corps, dans leur manière de parler en connaisseurs » leur appartenance au monde privilégié de ceux qui peuvent se flatter de goûter les arts « raffinés »). C’est jusqu’à l’emploi des guillemets, récurrents dans le passage, qui m’embarrasse. Eribon semble en effet citer un langage qui n’est pas le sien, mais ne peut pas le traduire dans un langage qui soit lui serait propre, soit serait vraiment celui de la sociologie. Les guillemets lui permettent ainsi de se désolidariser de la distinction culturelle, tout en lui préservant la possibilité d’en jouir.
Dans mon for intérieur de lecteur, je me demande bien comment il a pu réapprendre un langage, alors qu’il me semble si difficile de parler le langage que j’ai reçu de mes parents, de mes lectures, de l’école et de mes amis – des autres, en somme. Eribon semble y être parvenu sans effort : « bref, contrôler en permanence mon langage et mon élocution ».
Mais au-delà de ma surprise, je trouve extrêmement pauvre la définition du langage que dessine en creux Eribon. Celui-ci – comme l’art – est réduit à n’être qu’un instrument voué à garantir une place à celui qui le parle. Pour ma part, le langage me semble être l’expérience d’un risque, celui de l’expulsion permanente, de l’impossibilité qu’il y a à traduire l’intériorité en phrase compréhensible par un interlocuteur assez fou pour me lire ou m’écouter. Mais pour Eribon, le langage peut être assujetti. Etonnant de constater comme une critique de la domination sociale passe ici par une définition du langage qui l’arrime à celui qui le parle et le « contrôle ».
Je me rappelle qu’une fois, j’aidais un ami extrêmement pauvre, exilé de son pays, au français plus qu’approximatif, à rédiger une lettre de motivation pour travailler en tant qu’agent d’entretien. Faisant ce que je pouvais – en sachant que je ne déteste rien plus qu’écrire une lettre de motivation – j’utilisais mon langage d’universitaire : de belles tournures, des périodes rhétoriques, un vocabulaire riche, pensant ainsi donner une chance à mon ami d’obtenir un emploi et de quoi subvenir, quoique précairement, à ses besoins. La rédaction achevée, celui-ci me lit, éclate de rire et me dit : « c’est pas ma langue, ça, personne va y croire. Change ! ». Et il me corrige, transforme les tournures pour qu’elles correspondent au registre qu’il pensait être celui attendu pour l’emploi en question. De fait, il est indéniable que des sociolectes existent en fonction de la classe et des différentes instances qui jouent un rôle dans les échanges socio-linguistiques. Mais que dire du langage que nous parlons, mon ami et moi, lorsque nous rions ensemble de mes tournures, quand il me corrige (moi, le prof !) et que, d’aucune façon, je ne parle avec lui un autre langage que celui que j’utilise avec mon frère et ma sœur ? Sans doute est-ce un langage opaque, traversé de malentendus, d’incompréhension, de questions non résolues, de phrases en attente. Un langage incontrôlable, en somme – mais un langage chaleureusement amical, précisément parce qu’il traduit un lien énigmatique dont l’évidence, claire, ne peut se loger dans une phrase – ni dans aucun langage, registre ou niveau de langue.
Ce que j’essaye de dire, c’est que l’absence d’un sujet complexe à l’œuvre dans l’écriture d’Eribon simplifie violemment les problématiques socio-culturelles et socio-linguistiques qu’il interroge, au point de donner une définition de l’art et du langage si caricaturale qu’elle n’induit aucune productivité de la critique. Au contraire, elle réduit le plaisir esthétique, le rapport à l’autre et le langage à n’être que masques – derrière lesquels il n’y a personne.