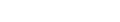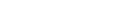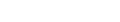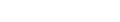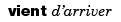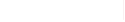Conversation critique n°8.1
[Jérôme David vient d’évoquer et d’essayer d’analyser le contenu d’une « cabane à bouquins » dont l’inscription sur la porte indique l’usage : « donnez, empruntez, partagez les livres que vous aimez »]
Ces formes de la mondialité littéraire échappent pourtant à une ressaisie d’ensemble : c’est là-haut une collection éditoriale prosélytique du « monde libre » d’il y a un demi-siècle, dont un volume parmi d’autres garde l’empreinte ; à côté, la vieille édition d’un texte français mineur du XIXe siècle qui ne fut guère traduit ; à mi-hauteur, le polar récent d’un auteur local où les recettes scandinaves du genre sont adaptées au décor d’une station de ski suisse ; et, par-ci par-là, les indices russes ou turcs d’une mondialité effective et tout sauf monolingue. La littérature mondiale ne s’y présente donc pas sur le mode de l’informe, mais sur le mode de l’informel.
3. J’emprunte cette conceptualisation de l’informalité à Stefano Harney et Fred Moten, et notamment à leur ouvrage The Undercommons
Leur perspective découle à mes yeux d’un triple héritage.
Dans le sillage de la sociologie américaine du travail et de l’opéraïsme italien des années 1960, très proches sur ce point précis, l’informalité consiste d’abord à étendre le champ de la pensée bien au-delà des seuls lieux et des seules autorités généralement associées à la connaissance et au savoir : une ouvrière sur sa machine, ou devant son tapis d’usine où défilent des pièces à vive allure, n’agit pas comme un automate — tout en rêvant à une autre vie sur le mode de la fantasmagorie ; elle réfléchit au monde qui lui passe littéralement entre les mains, elle ajuste sa place de travail à ses contraintes et à ses préférences, elle intervient dans ses relations avec ses pairs ou ses chefs en fonction de codes multiples qu’aucun règlement ne formalise. De même, un employé de bureau interprète sans cesse les consignes qu’on lui donne pour accomplir ses tâches d’une façon pour lui optimale, tout en tenant compte des attentes des collègues avec lesquels il coopère ou prend ses pauses.
Le monde social est ainsi traversé de part en part d’intellectualité. Ou, pour le dire avec Harney : « Quand je pense à l’étude ou au bureau [à ce que désigne pour lui le mot anglais « study »], je pense aussi bien aux infirmières durant leur pause clope qu’à ce qui se passe à l’université. »
Hériter de cette idée d’une intellectualité diffuse dans l’ensemble des groupes sociaux, cela équivaut, plus près de nous, à souscrire à ce que Jacques Rancière appelle « l’égalité des intelligences ». J’en conclus que quiconque dispose d’une bibliothèque où cohabitent des cultures littéraires de langues différentes — une bibliothèque qui contiendrait ne serait-ce qu’un seul texte en langue étrangère ou un seul texte traduit — pense la littérature mondiale à son échelle et à sa manière, qui peut évidemment être distraite, involontaire ou indifférente. Il faut compter avec cette intellectualité ordinaire de la littérature mondiale.
Si ma conférence était diffusée sur une plateforme me permettant de vous voir, vous qui m’écoutez, et si vous aviez fait le choix de prendre pour arrière-plan de vos visioconférences un pan de votre bibliothèque, comme cela arrive souvent, vous m’auriez sans doute donné à penser une forme supplémentaire de la littérature mondiale. Votre bibliothèque — visible, pour le coup — aurait nourri ma réflexion, à tout le moins de manière inconsciente.
La seconde généalogie de l’informalité dérive de l’ancrage de Fred Moten dans les « performance studies ». J’y vois pour ma part affleurer la radicalité des premiers « happenings » des années 1960 et, pour ce que j’en admire sur le sol européen, les interventions de Joseph Beuys ou de Robert Filliou.
Beuys a organisé plusieurs de ses expositions autour d’un dialogue avec le public, dont ne subsistent aujourd’hui que les tableaux noirs recouverts des schémas à la craie qui furent tracés durant ces séances. Ces performances impliquaient tout l’auditoire dans la production de formes communes, aussi bien symboliques que matérielles (dans telle école d’art, telle galerie, telle salle de musée) ; elles ouvraient à une pratique active et immédiate de la « sculpture sociale » collective de la société si chère à Beuys.
Quant à Filliou, le « Territoire de la République géniale » qu’il a proclamé au Stedelijk Museum d’Amsterdam en 1974 participait de la même esthétique dialogique : pendant un mois, l’artiste a hissé au rang d’art ses discussions avec les visiteurs ; sans leurs réflexions et leurs rêveries sur la république géniale, plus rien — ni l’art, ni l’artiste, ni le musée — n’aurait plus eu de sens.
De telles œuvres naquirent d’une informalité revendiquée comme condition de l’art — non pas un informe sans devenir, que les visiteurs seraient venus troquer contre un savoir de l’œuvre sûr de son droit muséal, mais un informel accueilli au musée, diffus au dehors, aux contours imprévisibles, et qu’une pratique artistique assemblerait, aviverait et accompagnerait vers des formes, aussi éphémères et pauvres fussent-elles. Le « Territoire de la littérature mondiale » pourrait n’être à son tour rien d’autre que la somme des occasions données à n’importe qui, depuis deux siècles environ, de réfléchir avec d’autres à la mondialité de la littérature.
Le dernier héritage sensible dans les propositions théoriques de Harney et Moten est issu de la « black music » — des manières qu’ont eues certains groupes d’artistes afro-américains de faire du jazz improvisé, de la « soul music » ou du rap. De John Coltrane à Ol’ Dirty Bastard du groupe Wu-Tang Clan, Moten a détaillé les chemins par lesquels certaines sociabilités en vigueur parmi les Afro-américains (ce qu’il qualifie de « black sociality ») en sont venues à imprégner des genres musicaux jusqu’à en devenir des éléments constitutifs.
Les formes musicales ont alors accueilli une informalité diffuse et fugitive, un en-deçà des normes sociales échappant à tout inventaire, et se sont présentées comme autant d’émergences provisoires de ce fonds commun, mouvant et critique. La « black music » a même parfois mis en abyme cette dette à l’endroit de la « black sociality », comme dans ce morceau de Marvin Gaye commenté par Moten, dont j’aimerais vous faire écouter le début pour mieux comprendre ce qu’il en dit dans son analyse.
Marvin Gaye, donc, dans « What’s going on ? », un titre de son onzième album produit par la Motown en 1971 [écoute].
Ecoutons maintenant Fred Moten parler de ce morceau de Marvin Gaye dans un entretien où il le mobilise pour donner à comprendre la notion d’« informalité » (je me suis permis de traduire le passage en français) :
« L’exemple classique de ce dont parle Stefano [Harney, à propos de la « study»], c’est “What’s going on ? ” de Marvin Gaye — et bien sûr le titre te le fait déjà savoir : waow, un truc is going on ! Cette chanson émerge de ce que quelque chose a déjà lieu. Ainsi, depuis une certaine perspective pourtant limitée, on reconnaît, il y a ces gens qui circulent alentour et parlent et se saluent — et soudain quelque chose que l’on reconnaît être de la musique émerge de ça. Mais là, si tu réfléchis un quart de seconde, tu te dis, “mais la musique était déjà là”. On faisait déjà de la musique. Donc, ce qui émerge n’est pas la musique en général, par opposition au non-musical. Ce qui émerge est une forme, à partir de ce que nous appelons [avec Stefano Harney] l’informalité. L’informel n’est pas l’absence de forme. C’est ce qui donne forme. L’informel n’est pas informe. Et ce que ces gens sont occupés à faire au début de “What’s going on ? ”, c’est de la study. Et quand Marvin Gaye se met à chanter, c’est aussi de la study. Ce n’est pas de la study, de l’étude, qui surgirait d’une absence d’étude, d’une absence de study. C’est une extension de la study. […]
Si ça venait de nulle part, si ça partait de rien, ce genre de trucs cherche juste à te faire savoir que tu as besoin d’une nouvelle théorie du rien et d’une nouvelle théorie du nulle part. »
Il en va de même de la littérature mondiale : si ça venait de nulle part, la « cabane à bouquins » chercherait précisément à nous faire savoir que nous avons besoin d’une nouvelle théorie du nulle part ; si ça part de rien, alors il nous faut une nouvelle théorie du rien.
Jérôme David, « Construire et déconstruire une bibliothèque de la littérature mondiale » (Collège de France, 16 mars 2021 : https://www.college-de-france.fr/site/william-marx/seminar-2021-03-16-15h30.htm) ,
Augustin Leroy
20/04/2021
Essayant de converser avec la réflexion proposée par Jérôme David, je me sens quelque peu démuni. Les références théoriques qu’il convoque, Stefano Harney et Fred Moten, ainsi que « l’opéraïsme italien » des années 60, me sont inconnues. Elles ne me touchent pas et n’éveillent en moi aucune mémoire commune. Voire, parfois, m’embarrassent, comme lorsque Harney, cité par J. David, conceptualise la « study » en postulant l’équivalence entre les « infirmières durant leur pause clope » et « ce qui se passe à l’université ». Je suis moralement mal à l’aise s’il s’agit de théoriser une notion qui ne fait pas de différences entre le lieu de l’université, où la pensée peut relativement décider des conditions de sa propre élaboration, et les conditions de travail d’une infirmière, ultra-précaires, épuisantes et peu valorisées. En un mot, je crois que ma situation professionnelle, en tant qu’universitaire, est largement privilégiée si on la compare au labeur quotidien que vivent les infirmières. Il me semble ainsi éthiquement discutable de subsumer ces différences sous la généralité conceptuelle de la « study ».
Pourtant, je suis touché par l’évocation d’une « ouvrière sur sa machine (…) rêvant à une autre vie sur le mode de la fantasmagorie », sans doute parce que je refuse de considérer que le rêve et la possibilité d’inventer sa vie sont le propre des intellectuels. Oui, penser que l'exploitation capitaliste dépossède de leurs rêves les ouvriers - ou ce qu’on appelait encore il y a peu, le prolétariat – est une stratégie de discours marquée par des présupposés idéologiques réducteurs et caricaturaux. A ce propos, je me rappelle que Rancière évoquait les lettres rédigées par des ouvriers, à la fin du XIXe, discutant littérature, arts, philosophie, et qu’il s’appuyait sur ces propos pour récuser l’idée selon laquelle les ouvriers ne pensent pas à cause de leur travail – ou ne pensent qu’à leur travail, soit pour l’optimiser, soit pour l’oublier, à grand renfort d’alcool. L’ouverture démocratique de la vie imaginaire que cherche à déployer Rancière, par le concept de « partage du sensible », me semble plus opérant que celui de « study » pour affirmer et exploiter les conséquences de « l’égalité des intelligences », dans la mesure où il permet au philosophe, à l’universitaire, de rendre quelque chose aux ouvriers qu’il évoque.
Mais la réflexion de J. David débute, non avec le bureau ou l’étude, mais avec « une cabane à bouquins ». Il est vrai que je peux me reconnaître dans l’excitation intellectuelle qu’éveille la découverte d’une bibliothèque de rue, avec ses titres et auteurs imprévus, ses rencontres inattendues, qui laissent au hasard le soin de constituer, à un moment donné, une image pensante et ouverte de la littérature mondiale, sans vouloir immédiatement la disséquer sous forme de catégories cloisonnantes et fermées.
Mais justement, cette bibliothèque n’est pas que le fruit du hasard… Il faut bien que quelqu’un, voyant cette bibliothèque, s’en saisisse au moins théoriquement pour l’incorporer à une réflexion sur la littérature. Quelle est la nature, la situation, de ce sujet qui constitue son objet pour en faire une synecdoque de la littérature mondiale? S’il s’agit, comme le propose J. David, d’élaborer « une théorie du rien », comment rendre compte du point de vue qui précède nécessairement ce « rien » qu’il invite à théoriser ? Il faudrait, je crois, poser une théorie du sujet et de sa situation avant de formuler cette « théorie du rien » ou du « nulle part » – qui deviendrait dès lors la théorie d’un rapport entre un sujet (qui n’est pas qu’un individu) et une « forme-sens », pour reprendre un concept de Meschonnic ou entre un sujet et le devenir-forme de l’informalité, pour reprendre les termes des auteurs mobilisés par J. David. Du moins, ce que j’en comprends...
Ainsi, je crois que la façon dont un universitaire se rapporte à « l’informalité » d’où émerge une chanson de Marvin Gaye ou un couplet d’Old Dirty Bastard diffère de la façon dont le chanteur ou le rappeur se rapportent à la « black sociability » dans laquelle ils évoluaient. La mort du second à 36 ans, victime d’une overdose, et les multiples incarcérations qu’il a traversées, ne fait-elle pas également partie d’un processus de dé-sociabilisation que subissent les noirs américains, par le biais de dispositifs législatifs et de stratégies institutionnelles qui ont leur histoire, de l’esclavage aux « projects », en passant par la ségrégation ? Ecrivant ma conversation, attablé à un vieux bureau de la maison solognote de mon beau-père, j’éprouverais quelque gêne à comparer ma situation de travail à la fureur et à la violence de celle d’où émerge la poésie musicale du rappeur américain. Mon informalité, disons, n’est pas l’informalité du Wu Tang Clan.
Pour autant, je reste d’accord avec J. David lorsqu’il postule l’indétermination de la pensée et de l’intellect – comme je le disais au début de mon propos. Mais alors, comment reconnaître la valeur de ce postulat sans faire fi des déterminations sociologiques et historiques qui façonnent, parfois empêchent, la « study » ? Ou plutôt, comment imaginer cet « en-deçà des normes sociales qui échappent à tout inventaire », sans atténuer les effets inégalitaires des structures sociales qui le contraignent ?
Du reste, j’ai le sentiment que cette figure inaugurale de la « cabane à bouquins » présente un paradoxe emblématique de mon trouble. D’un côté, elle implique de reconnaître l’impossibilité de circonscrire ce qui relève de la culture et ce qui n’en relève pas, fait valoir la relativité des catégorisations traditionnelles et active la puissance de transformation que génère la rencontre entre un livre et un lecteur. De l’autre côté, elle reste une bibliothèque, c’est-à-dire un lieu qui n’est pas neutre et dont l’existence résulte de constructions historico-sociales multiples, complexes et contradictoires. En un mot, une bibliothèque est aussi une institution de pouvoir, qu’elle soit mondiale ou nationale, publique ou privée, disposée sur un trottoir ou dans une maison bourgeoise. La série de tournures hypothétiques utilisées par J. David, lorsqu’il s’adresse à ses auditeurs et imagine qu’ils fassent figurer « un pan de leur bibliothèque » dans le cadre de leur caméra d’ordinateur, me rappelle que l’accès et le partage de cette bibliothèque mondiale ne s’effectuent pas sans conditions – et j’ai alors une pensée farouchement émue pour mes étudiants de Paris 8 qui refusent d’activer leur caméra lors des cours à distance, pour dissimuler la précarité de leur logement – et possiblement, leur absence de bibliothèque. Je crois donc que ce concept de « study », parce qu’il fait l’économie d’un certain nombre de déterminations historico-sociales, ne prend pas la responsabilité de sa valeur institutionnelle et des rapports de pouvoir qu’elle implique. Or, c’est précisément au nom de cette responsabilité qu’on peut lui demander des comptes – alors que personnellement, je n’ai jamais demandé de compte aux musiques de Marvin Gaye ou au rap d’Old Dirty Bastard, car alors, peut-être que je ne les écouterais pas.
Sans doute, je chausse de gros sabots, pour phraser maladroitement mes doutes et mes désaccords, grossissant ainsi la finesse et l’intelligence des propositions de J. David. Mais je crois qu’une Conversation critique réclame ce genre d’imperfections pour générer du débat – et affiner la grossièreté des questions pour mieux les poser et permettre de déployer leur puissance d’interrogation.