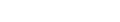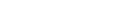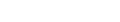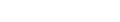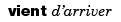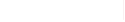Conversation critique n°5.2
Le réductionnisme de l’intelligence et de la discussion à l’intérêt politique[1] menace de politiser l’université de manière plus profonde et plus destructrice que jamais auparavant. Je dis « menace » parce que le déconstructionnisme n’a pas encore submergé l’université, comme certains critiques le proclament. Mais la menace anti-intellectuelle et « politisante » qu’il fait peser n’en est pas moins réelle. Une bonne partie de la vie intellectuelle, spécialement dans les humanités et les sciences sociales « douces », dépend du dialogue entre gens raisonnables qui ne sont pas d’accord sur les réponses à apporter à quelques questions fondamentales sur la valeur de différentes idées et réalisations littéraires, politiques, économiques, religieuses, éducatives, scientifiques et esthétiques. Les collèges et les universités sont les seules institutions sociales majeures ayant pour but de modeler la connaissance, la compréhension, le dialogue intellectuel et la recherche d’arguments raisonnés dans de multiples directions possibles. La menace du déconstructionnisme à l’encontre de la vie intellectuelle universitaire est double : elle refuse a priori qu’il y ait des réponses raisonnables aux questions fondamentales, et elle ramène chaque réponse à un exercice de pouvoir politique.
Considérée sérieusement selon ses propres termes, la défense décontructionniste d’un cursus plus multiculturel apparaît elle-même comme une affirmation du pouvoir politique au nom des exploités et des opprimés, plutôt qu’une réforme intellectuellement défendable. Le déconstructionnisme présente les critiques du multiculturalisme – si raisonnables soient-elles – comme politiquement rétrogrades et indignes de respect intellectuel. Face aux incertitudes et aux désaccords de la raison, là où les essentialistes réagissent en invoquant plutôt qu’en défendant des vérités intemporelles, les déconstructionnistes réagissent en écartant systématiquement les points de vue divergents, sous le prétexte qu’ils sont également indéfendables pour des raisons intellectuelles. La vie intellectuelle est alors « déconstruite » en un champ de bataille de classes, de sexes et d’intérêts raciaux, analogie qui ne rend pas justice à la politique démocratique dans ce qu’elle a de meilleur, laquelle n’est pas simplement une opposition de groupes d’intérêts rivaux. Mais l’image transmise de la vie universitaire – l’arène véritable de l’activité déconstructionniste – est plus dangereuse parce qu’elle peut créer sa propre réalité, transformant les universités en champs de bataille politiques plutôt qu’en communautés mutuellement respectueuses de leurs désaccords intellectuels.
Les déconstructionnistes et les essentialistes sont en désaccord sur la valeur et le contenu d’un cursus multiculturel. Le désaccord est exacerbé par l’aspect de jeu à somme nulle qu’est le choix entre œuvres canoniques et œuvres plus récentes, lorsque quelques cours fondamentaux nécessaires deviennent le centre de discussions académiques et publiques sur ce qui constitue une éducation idéale. Pourtant, le désaccord sur les livres indispensables et les manières de les lire n’est pas catastrophique en lui-même. Aucun cursus universitaire ne peut inclure tous les livres ni représenter toutes les cultures dignes de reconnaissance dans une éducation démocratique et libérale. Aucune société libre – à plus forte raison aucune université de maîtres et d’étudiants indépendants – ne peut davantage s’attendre à être d’accord sur des choix difficiles entre biens rivaux. La cause d’inquiétude sur les controverses actuelles à propos du multiculturalisme et le cursus universitaire est plutôt que les partis les plus bruyants, dans ces disputes, paraissent peu enclins à défendre leurs vues devant les gens avec qui ils sont en désaccord, pas plus qu’à cultiver sérieusement la possibilité de changements face à une critique bien raisonnée. Au lieu de cela, dans une réaction égale et opposée, les essentialistes et les déconstructionnistes expriment un dédain réciproque plutôt qu’un respect pour leurs différences. Ils créent ainsi, au sein de la vie universitaire, deux cultures intellectuelles mutuellement exclusives et dépourvues de respect, écartant toute volonté d’apprendre quelque chose de l’autre parti ou de lui reconnaître une quelconque valeur. Dans la vie politique, il existe en gros un problème parallèle de non respect et de défaut de communication constructive entre les porte-paroles des groupes ethniques, religieux et raciaux – problème qui débouche trop souvent sur la violence.
La permanence de plusieurs cultures mutuellement exclusives et non respectueuses n’est pas le principe moral du multiculturalisme, en politique ou en matière d’éducation. Ce n’est pas non plus une vision réaliste : ni les universités ni les administrations ne peuvent effectivement rechercher leurs objectifs de valeur sans respect mutuel entre les cultures variées qu’elles contiennent. Mais tous les aspects de la diversité culturelle ne sont pas dignes de respect. Certaines différences – racisme et antisémitisme sont des exemples évidents – ne devraient absolument pas être respectées même si l’expression de positions racistes et antisémites doit être tolérée.
La controverse sur les campus universitaires au sujet de propos racistes, ethniques, sexistes ou anti-homosexuels – ou de toute autre forme de discours agressifs dirigés contre les membres de groupes défavorisés – illustrent la nécessité d’un vocabulaire moral partagé qui soit plus riche que nos droits à un discours libre. Supposons que l’on reconnaisse aux membres d’une communauté universitaire le droit d’exprimer des positions racistes, antisémites, sexistes et anti-homosexuelles, à condition de ne menacer personne. Que reste-t-il à dire des propos racistes, sexistes, antisémites, et anti-homosexuels, qui sont devenus de plus en plus communs sur les campus ? Rien, si notre vocabulaire moral commun se limite au droit de liberté d’expression, sauf à contester ces propos sur la base même de la liberté d’expression. Mais dans ces conditions, le débat public passera rapidement du contenu pernicieux du discours au droit de libre parole de l’orateur.
Tout reste à dire, cependant, si on peut distinguer entre différences fondées sur la tolérance et différences fondées sur le respect. La tolérance s’étend à la gamme de points de vue la plus vaste, aussi longtemps qu’ils s’interdisent toute menace et autres torts directs et discernables envers les individus. Le respect est beaucoup plus discriminant. Bien que nous n’ayons pas besoin d’être d’accord avec une position pour la respecter, il nous faut la comprendre comme reflétant un point de vue moral. Un partisan déclaré de l’avortement, par exemple, devrait être capable de comprendre comment une personne moralement sérieuse peut, sans autres arrière-pensées, être opposée à sa légalisation. De sérieux arguments moraux peuvent être adressés contre celle-ci, et vice versa. Une société multiculturelle est contrainte d’inclure une vaste gamme de désaccords moraux respectables qui nous laissent la possibilité de défendre nos positions devant des gens moralement sérieux avec qui on n’est pas d’accord, et par là-même d’apprendre à partir de nos différences. De cette façon, on pourra faire vertu de la nécessité de nos désaccords moraux. […]
Les désaccords moraux respectables, par ailleurs, appellent le débat, non la dénonciation. Les collèges et les universités peuvent servir de modèle pour le débat, en encourageant les discussions intellectuelles rigoureuses, honnêtes, ouvertes et intenses, à l’intérieur et à l’extérieur des salles de cours. La volonté et la capacité de délibérer sur nos différences respectables font également partie de l’idéal politique démocratique. Les sociétés multiculturelles et les communautés qui militent pour la liberté et l’égalité de tous les peuples sont fondées sur le respect mutuel à l’égard des différences intellectuelles, politiques et culturelles raisonnables. Le respect mutuel requiert une bonne volonté répandue et une capacité à énoncer nos désaccords, à les défendre devant ceux avec qui nous ne sommes pas d’accord, à faire la différence entre les désaccords respectables et ceux qui ne le sont pas, et à garder l’esprit ouvert jusqu’à modifier notre opinion en face d’une critique bien argumentée. La promesse morale du multiculturalisme dépend du libre exercice de ces vertus de discussion.
Amy Gutmann, "Introduction", dans Charles Taylor, Multiculturalisme. Différence et démocratie, [1992], Paris, Flammarion/Champs, 1997, p. 34-39.
______________________
[1] La phrase est un peu difficile à comprendre hors contexte. Amy Gutmann évoque ici la tendance du déconstructionnisme à réduire toute position intellectuelle à une position de pouvoir. (Note de la rédaction)
Hélène Merlin-Kajman
03/04/2021
Cher Brice,
J’ai choisi de converser avec toi plutôt qu’avec le texte d’Amy Gutmann offert à la réflexion commune. Permets-moi cependant un mot sur ce qui fait l’intérêt à mes yeux de ce texte et a justifié son choix.
Comme tu le rappelles, en janvier, aucune tribune d’universitaires n’appelait encore à la vigilance, voire au coup de balai, à l’encontre de l’« islamo-gauchisme ». Après l’assassinat de Samuel Paty en octobre dernier, Jean-Michel Blanquer avait bien déjà dénoncé ce danger en braquant le projecteur sur l’université. Mais c’est en février qu’au fil de prises de parole publiques, cette étiquette, sans gagner en pertinence, s’est mise à gagner en extension pour incriminer non seulement une complicité idéologique criminelle avec le terrorisme islamiste, mais encore un militantisme politique en train de gangrener sournoisement l’université. Un ennemi diffus se trouve désormais accusé d’introduire en France l’abus « gauchiste » des « studies » américaines, ces « studies » qui n’ont cessé de sortir de l’ombre des sujets « mineurs » voire des objets mineurs (ex : « sound studies ») pour leur conférer dignité épistémologique et droit de cité universitaire.
Pourtant, et bien des voix l’ont rappelé, ces « studies » ont été largement inspirées par la « French theory ». Même si « islamo-gauchisme » résonne dans l’opinion de façon infiniment plus violente et ciblée que « déconstructionnisme » ne l’aurait fait (à qui ce mot aurait-il parlé du reste ?), les deux termes regroupent en gros, l’un dans la bouche de nos ministres soutenus par un certain nombre de nos collègues (nos « essentialistes »?), l’autre dans la bouche d’Amy Gutman, des positions comparables : les « bottes de sept lieues » nécessaires pour effectuer de tels « raccourcis » ont été chaussées, comme tu le suggères, et nous prennent au dépourvu.
Je t’accorde aussi que ce texte d’Amy Gutmann manque de cette subtilité, de cette qualité théoriques auxquelles nous aimons nous confronter dans nos débats. On fait vite le tour de ses arguments. Son appel récurrent à la raison et au respect est on ne peut plus irénique. Cependant, rapprocher son évocation d’une « menace anti-intellectuelle et politisante » pesant sur les débats universitaires par la faute des déconstructionnistes, de l’accusation de « dévoiement militant de l’enseignement et de la recherche » portée par Frédérique Vidal contre « l’islamo-gauchisme », comme tu le fais, ne me paraît ni tout à fait juste, ni vraiment éclairant.
Pour ma part, je lis dans le texte d’Amy Gutmann une volonté pragmatique : elle combat moins des idées ou des personnes (des penseurs, des chercheurs) qu’une situation dangereusement bloquée. Elle stylise une scène sur laquelle elle fait apparaître deux protagonistes en guerre ouverte : les essentialistes (longuement présentés dans le passage précédent la citation offerte à la « conversation critique ») et les déconstructionnistes. Ces derniers me semblent plus proches du multiculturalisme qu’elle appelle de ses vœux que les premiers. Ceci n’est pas un détail. Mais le découpage du texte empêchait sans doute de le sentir pleinement.
Certes, Amy Gutmann évoque bien une « menace » ; mais elle-même n’en profère aucune. Elle n’appelle pas l’État à la rescousse, elle ne cherche par à lancer une chasse aux sorcières. Elle réaffirme même, au contraire, l’exigence de tolérance inscrite dans la constitution américaine : « Certaines différences – racisme et antisémitisme sont des exemples évidents – ne devraient absolument pas être respectées même si l’expression de positions racistes et antisémites doit être tolérée. » En France, la loi interdit « l’expression de positions racistes et antisémites ». Un certain nombre des propos d’Amy Gutmann sont incompréhensibles en dehors des apories particulières nées de cette inconditionnalité de la liberté d’expression garantie par la loi fédérale américaine.
Selon moi, si Amy Gutmann en appelle au « respect » (moral) avec autant d’obstination, c’est précisément parce qu’elle refuse qu’il se confonde avec la « tolérance » : il faut tolérer l’expression de toutes les positions ; mais cette tolérance n’entraîne pas qu’elles soient toutes dignes de respect. Ce double constat modifie le sens que nous devons donner, ici, au mot « respect ». L’exigence morale qu’il désigne combat une position qui se contenterait, en guise de morale, de souscrire paresseusement au principe simplement juridique de la tolérance. Du coup, voici comment je me formule la question d’Amy Gutmann : comment faire pour que la défense du multiculturalisme ne tourne pas à la bataille rangée, bataille dont les suprémacistes blancs (c’est ainsi que je me représente le noyau dur formé par les « essentialistes ») sortiraient vainqueurs, protégés par la tolérance simplement juridique de leur liberté de parole ?
Supposons que l’on reconnaisse aux membres d’une communauté universitaire le droit d’exprimer des positions racistes, antisémites, sexistes et anti-homosexuelles, à condition de ne menacer personne. Que reste-t-il à dire des propos racistes, sexistes, antisémites, et anti-homosexuels, qui sont devenus de plus en plus communs sur les campus ? Rien, si notre vocabulaire moral commun se limite au droit de liberté d’expression, sauf à contester ces propos sur la base même de la liberté d’expression. Mais dans ces conditions, le débat public passera rapidement du contenu pernicieux du discours au droit de libre parole de l’orateur.
Je crois comprendre qu’ici, Amy Gutmann penche clairement en faveur du déconstructionnisme, à ceci près qu’elle lui reproche (n’oublions pas que c’est un protagoniste actuel sur une scène très concrète quoique stylisée, pas la philosophie d’un auteur majeur du XXe siècle même si celle-ci inspire ce protagoniste) d’affaiblir le combat en refusant d’envisager la « nécessité d’un vocabulaire moral partagé qui soit plus riche que nos droits à un discours libre ». Je comprends donc que le « respect » désigne les conditions pour qu’une scène puisse s’établir, non sans en exclure les positions qu’on est obligé de tolérer mais qu’on ne doit pas respecter. Pour les isoler ? Tu appelles cette scène « moyen terme ». Je le comprends. Mais ton rejet élude sa question : comment éviter que le dissensus ne débouche sur la guerre civile ?
Si j’ai choisi ce texte, et ce passage en particulier qui comprend la critique du déconstructionnisme plutôt que celle de l’essentialisme, c’est pour nous inviter, à Transitions, où il est clair que nous sommes plutôt « déconstructionnistes », à ne pas nous désintéresser de cet enjeu : l’hypothèse de la nécessité d’un « vocabulaire moral commun » qui rende possible des scènes de parole, parce que les protagonistes décideraient de se « respecter », de se faire crédit d’une sincérité morale dans leurs convictions. On ne peut nier qu’aujourd’hui, l’exigence de respect s’exprime de toute part : comment la traduire ? Il me plaisait même, en effet, que cette invite soit dite dans des termes « rétrogrades ». Je ne souhaitais pas pour autant conclure que Transitions (au nom qui peut très vite prêter à confusion) voulait offrir une scène pacifiée (civile) de débats – moyen terme. Mais essayer de nous demander pourquoi il y a aujourd'hui tant d’électricité dans l’air – un horizon de tabous – dès que certains sujets sont abordés. Pourquoi la censure est dans l’air du temps.
Tu l’entrevois déjà, mon désaccord avec toi est donc moins un désaccord théorique qu’un désaccord pragmatique. Peut-être même un désaccord rhétorique, en un sens du mot que je suis en train d’apprendre à investir de positivité grâce à la lecture de Blumenberg, lequel comprend la rhétorique à la lumière de la détresse humaine devant l’incapacité de l’humanité à atteindre l’être.
Je vais, faute de place, me contenter d’esquisser les contours de ce désaccord en passant par le détour d’une citation d’ Instructions païennes de Jean-François Lyotard (Galilée, 1977, p. 18-20). Et si je l’ai choisie, c’est d’abord parce que la forme dialoguée du livre fait écho au problème de la scène partagée soulevé par Amy Gutmann :
[...] mon récit comme tout récit a pour référence d’autres récits. C’est toujours : je dis qu’on dit.... Ce dont on parle, la diégèse...
- Diégèse ?
- La référence du récit actuel, l’histoire que le message narratif présent met en scène à l’“extérieur” des mots. Eh bien, considérez que la diégèse de mon récit, mais aussi du vôtre, n’est jamais faite d’événements ou de faits bruts, que ceux-ci nous sont apportés toujours par d’autres récits que le nôtre prend en référence.
- Quoi ! la Commune, Cronstadt, Budapest en 56, ce sont des histoires ! Et les morts ?
- Les morts ne sont pas morts tant que les vivants n’ont pas enregistré leurs morts dans les récits. La mort est matière d’archive. On est mort quand on est narré et qu’on n’est plus que narré. Et vous êtes invité à donner à l’archive toute l’extension souhaitable, en y comprenant les documents les plus anodins.
- Et les obus qui ont tué ces morts sont des récits ?
- Ils ne relèvent que de ça, et si vous me dites que non, et ce qu’ils sont selon vous, vous me ferez un récit, ou plusieurs. […] Les obus ne parlent pas, mais ils sont des références des récits qui les préparent et qui les commentent, et ils sont aussi un appoint de persuasion administré aux destinataires incrédules par des narrateurs décidés à convaincre. »
On pourrait sûrement consacrer des pages à analyser ce texte. Mais comme tel, il justifie à mes yeux la colère à la fois éthique et épistémologique de Carlo Ginzburg pour qui Jean-François Lyotard (ce Lyotard, qui n’est pas tout à fait celui du Différend) illustre un néo-scepticisme contemporain, en gros identique au « déconstructionnisme » d’Amy Gutmann malgré tous les points de divergence entre Lyotard et Derrida, qu’il juge très dangereux pour la connaissance historique .
De fait, face à ce texte, qu’on pourrait rapprocher de nombreux autres textes d’auteurs que toi et moi admirons autant que Lyotard, je me fais quelques remarques, des remarques qui m’irritent l’esprit.
La première, c’est un constat que je formule comme je peux. Il a donc fallu une scène d’interlocution pour présenter la pensée du philosophe païen. Ce dernier comprend parfaitement les questions de son interlocuteur. Malgré son ironie, il ne peut que les juger recevables : il doit les « respecter » pour y répondre. Il a même besoin d’elles : en y répondant, il cherche à convaincre son interlocuteur dans un langage dont il serait aisé de démontrer qu’il ne se tient pas en dehors de toute « illusion référentielle ». Sans le langage ordinaire de son interlocuteur, le philosophe païen n’instruirait pas son lecteur.
La seconde, qui est une conséquence de la première, concerne ce que j’appellerais la mauvais foi sophistique de la part du philosophe païen - lequel, certainement, la revendiquerait, acculant son interlocuteur à un vertige dévastateur. Le philosophe païen est tout sauf un maître ignorant, ou même un Socrate : il ne fait accoucher personne, il ne renvoie pas son interlocuteur à la responsabilité de son intelligence. Il le provoque et asserte, tout en lui volant la possibilité d’objecter dans son langage ordinaire. Il a beau jeu de dénoncer les manipulations rhétoriques fondées sur une pseudo-autorité des faits : il n’en intimide que davantage son interlocuteur (et son lecteur) par le brillant de ses paradoxes et l’autorité magistrale, quasi oraculaire, de ses réponses.
La troisième, c’est que le philosophe destinateur du philosophe païen (disons, l’auteur de ce dialogue) a donné à ce dernier un interlocuteur ad hoc : terriblement passif. « Essentialiste », je présume, mais un essentialiste bien docile. Naïf ? Au point d’en être éberlué, incapable de défendre le bon sens, d’opposer au philosophe païen la force du sentiment commun selon lequel il y a des existants (mon corps, ton corps, des arbres, la lumière du soleil...) devant lesquels le soupçon doit se suspendre (je paraphrase « Le consentiment » de Patrice Loraux).
La quatrième, enfin. Je suis désireuse, moi, d’entrer en débat avec le philosophe païen, et ne me laisserai pas « instruire » si facilement. Je ne suis pas intimidée par la crainte d’être traitée d’essentialiste. Je refuse que des interdictions de parole fonctionnent comme des signes de ralliement : il m’indiffère de subir l’anathème de quiconque. Donc, je lui ferai remarquer :
- que Vidal-Naquet ne voulait pas discuter avec des négationnistes, mais uniquement avec des historiens, et plus largement des interlocuteurs, convaincus que les obus n’étaient pas de la diégèse. « Essentialisme » ?
- que le réel s’atteste, parce qu’il ne dépend pas que de preuves discursives, mais d’une convergence de signes : mots, dans tous leurs états pas seulement « narrés » ; et aussi symptômes, etc. Il y a un dehors du langage, des communications non-linguistiques, des connaissances empiriques non formulées, etc.
- pour finir, de là, je lui lancerais un défi : décrivez-moi, lui demanderais-je, décrivez-moi dans les termes de votre paganisme les effets en tout genre de tous les discours tenus autour du coronavirus : masques, confinement, état d’exception, biopouvoir, etc. Mais sans attendre, je lui donnerais un conseil amical : « si vous avez des symptômes, faites plutôt en sorte de les croire immédiatement réels et susceptibles d’être communiqués à votre médecin de façon fiable par un jeu de langage référentiel. Vous gagnerez un temps précieux en termes de diagnostic. »
Je ne sais pas ce qu’il me répondrait.
Mais je terminerais en t’adressant une question.
Tu écris : « C’est uniquement en consentant aux acquis du déconstructionnisme qu’il me semble possible d’envisager un espace de discussion pour accueillir les différends intellectuels. »
La simple formulation de ta phrase ne fait-elle pas déjà tort à ceux qui ne consentent pas aux acquis du déconstructionnisme ?
Ou encore : comment feras-tu pour sélectionner tes interlocuteurs ?