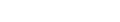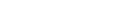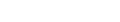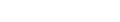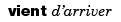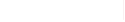Saynète n° 120.2.
Le jour vient, quand la nuit va !
Mon Oiseleau, mon Chardon, ma Minute, l'élan d'une aube est une force vive qui est à la fois un début et une fin. Un instant bref et fort comme un coup de tonnerre qui s'effrange en lumière, une étincelle qui nous fait renaître à nous-même.
Le jour vient, quand la nuit va...
Les aubes de mon enfance me manquent infiniment et celle-là plus que toute autre. Je ne parviens plus à vivre un moment neuf, désormais. Seuls, ces souvenirs que tu ravives me sont une fête.
Le jour vient, quand la nuit va...
Oui, mais si tu savais, petite, comme les aubes finissent par devenir lassantes ! Les aubes, les hommes, leurs peines, leurs joies, leur grande histoire, tout est tellement prévisible. Si tu savais comme on s'ennuie parfois ! La cruauté elle-même est si peu surprenante.
Les crépuscules m'exaspèrent davantage encore ! Je n'en puis plus de ces agonies outrancières. Crachats de couleurs, spasmes sanglants. La grande scène de la fin du jour m'indispose. Il ne manquerait plus qu'il gueule en crevant !
Que le soleil cesse de radoter et ne se lève plus, voilà qui serait réjouissant ! Que tout s'éteigne d'un coup pour toujours ! Je ne suis même pas si exigeante, ma fin à moi me suffirait.
L'ennui et l'amertume sont les grandes plaies du genre humain, mort ou vif.
Heureux ceux qui désirent jusqu'au bout, et même au-delà, ceux qui meurent curieux, heureux les oublieux qui redécouvrent chaque jour le monde, heureux les empathiques, les simples et les croyants ! Heureux les imbéciles !
Mais comment mourir tout à fait, quand je te sais si fragile à mes côtés ? Comment t'abandonner ?
Pourquoi ai-je tant changé ?
Notre père, sans doute, en était déjà là. Rien ne pouvait plus le faire vibrer que le sang des batailles.
Pourtant, il avait frémi en regardant la vallée.
Il m'a fallu du temps pour comprendre ce qu'il respectait en ce lieu, ce qui en faisait un sanctuaire et lui a imposé le silence ce matin où le paysage déployé à nos pieds nous a accueillis dans une pagaille ailée. Il m'a fallu longtemps pour démêler tout à fait son histoire.
Je n'aime rien tant que cette histoire, la sienne, la nôtre, celle qui commence ici, le reste peut se précipiter dans le vide. Je ne tiens pas au monde, il ne m'a rien offert qui mérite d'être retenu. Mais ce carré de terre qui penche autour de sa rivière m'intéresse, car il porte tous mes souvenirs. Il est le décor de la fable que tu ne cesses de broder. Et peu m'importe que les fils de tes descriptions soient trop épais, leurs couleurs trop vives, les motifs presque vulgaires et les ciels surchargés. J'aime cette scène baroque avec ses monstres de carton et ses prés dévorés par les fleurs sauvages. J'aime jusqu'aux débordements que je déteste ailleurs. Et tu peux verser toutes les couleurs dans un seul crépuscule, ta rêverie me troublera encore. Les aubes que tu racontes sont les seules qui me touchent, toutes les autres grisaillent ou m’écœurent. Ton récit parvient à traverser la corne qui m'étouffe l'âme.
Tu arrives sur le seuil, mon Eau vive.
Il n'y aura bientôt plus de là-bas, plus d'au-delà, plus d'ailleurs, ni d'hier, il n'y aura plus pour toi qu'ici et maintenant. Et, outre chemin, bien après que ton regard s'est éteint, c'est toujours ici que tu reposes, ô mon enfance, que tu murmures tes souvenirs au présent. Oui, maintenant et ici, depuis ce jour de mai où ton père t'a conduite aux Murmures.
Carole Martinez La Terre qui penche, Paris, Gallimard, 2015, p.63-64
Augustin Leroy
08/05/2021
Une douce mélancolie enveloppe les voix qui résonnent dans ce texte. Elle me happe, dans sa monotone mélodie qui court au fil de l’eau et me rappelle les derniers vers de Recueillement de Baudelaire : « Et, comme un long linceul trainant à l’Orient,/ Entends, ma chère, entends, la douce Nuit qui marche ». Certes, une des voix repousse la lyrique des crépuscules, avec « leurs crachats de couleurs, spasmes sanglants » et résiste à l’épanchement romantique de la nuit tombante, pour lui préférer la transition du point du jour, que l’anaphore, langoureuse, répète, inlassable comme un jour sans fin : « le jour vient, quand la nuit va ».
Mais ce cri d’enfance, qui piétine le cycle solaire, il n’est qu’une des voix, intense « comme un coup de tonnerre », dans l’entremêlement énonciatif qui organise le texte. Aux antipodes de cette voix, intervient le poncif, l’opérateur lyrique rimbaldien, « ô mon enfance », qui figure la crypte du passé qu’il a fallu incruster dans l’ « ici et maintenant » d’une « scène baroque », afin de garantir la possibilité d’un reste, d’une rémanence, « bien après que ton regard s’est éteint »
J’aime moins le piétinement dans les boues archaïques de l’enfance, je préfère le bond d’un enfant qui invente le bord où il atterrit.
C’est vrai, il m’est arrivé de prendre le soleil en horreur et d’attendre qu’il s’arrête, tombe, se décroche du ciel comme un bouton qui sauterait d’un vieux tissu délavé. Mais je ne suis pas aussi retenu que l’auteure, « ma fin à moi » ne me suffirait pas. D’autres vers me viennent, de Nerval cette fois, dans son Christ aux Oliviers : « Car je me sens tout seul à pleurer et souffrir / Hélas, et si je meurs, c’est que tout va mourir ». Mon enfant intérieur, sans doute, ne connaît pas (encore?) de seuils et si la nuit n’enfante plus « les aubes de mon enfance », je les tisse dans mon coin, au fond d’un placard où vivent mes araignées folles.
Du reste, le style romantique de ce fragment que j’imagine autobiographique déploie ce paradoxe, au fond banal : l’enfance ne peut être ressaisie que dans la mesure où elle se perd. A l’endroit de cette vacance interne, d’un manque fondateur qui génère la pulsion d’anéantissement et le désir de « se précipiter dans le vide », jaillit en effet « le décor de la fable ». Je lis ce dernier comme ce désir de retrouver l’enfance à volonté par les jeux de l’imaginaire, la confection de « monstres en carton » qui peuplent de leur présence étonnamment rassurante, « les prés dévorés par les fleurs sauvages ».
Je trouve cette image d’une grande beauté, parce que la métaphore de la dévoration figure le désir de ponctuer une étendue plate d’éclairs d’intensité. L’enfance, ô plante carnivore !
Mais j’imagine un lecteur très prosaïque, ou même un autre qui ne lirait pas, me demander à quoi bon ressasser le temps qui passe, l’être-pour-la-mort, l’Ubi Sunt, et autres interrogations pataphysiques ? Il trouverait franchement ridicule, un tantinet impudique, ce dialogue intérieur et ses romantismes. Je crois que je lui répondrais que ce texte me touche, parce qu’il m’invite à plonger dans sa mélancolie tout en me laissant la possibilité de l’accompagner sans céder à ses soupirs. Il m’ouvre ainsi un espace que je peux investir sans m’y reconnaître intégralement, mais sans y perdre le sentiment d’un visage familier, qui me rendrait mon regard depuis « ce carré de terre qui penche autour de sa rivière ».
Lorsque la narratrice se demande comment « mourir tout à fait, quand je te sais fragile à mes côtés », mon désir habite, précisément, ce destinataire rêvé, « Mon Oiseleau , mon Chardon, ma Minute », et j’ai envie de retenir celle qui veut apprendre à mourir, de faire monde pour elle et de lui offrir au moins une main qui « mérite d’être retenu[e]».