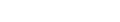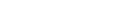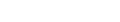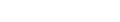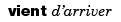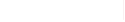Saynète n° 115.2.
Madame, la Comtesse de Champagne, veut que j’entreprenne de faire un nouveau roman. Elle m’a demandé, à moi Chrétien de Troyes, d’écrire un beau récit d’aventure et d’amour, qui puisse plaire aux dames et aux seigneurs de sa cour. Je mettrai donc tout mon art, ma sagesse et ma peine dans cet ouvrage, pour satisfaire cette noble dame, qui brille parmi les autres femmes, comme le diamant parmi les perles.
L’histoire que j’ai choisie ne se passe point aujourd’hui. De nos jours, en effet, personne ne sait plus ce que c’est que d’aimer : l’amour est un sujet de plaisanterie. Au temps du roi Arthur, le chevalier qui avait donné son cœur à une dame ne le reprenait jamais, et cet amour courtois durait toute sa vie.
Arthur, le noble roi de Bretagne, était si preux et courtois qu’il avait rassemblé à sa cour les meilleurs chevaliers. Ils parcouraient le monde en quête d’aventures et, aux grandes fêtes, ils se retrouvaient avec le roi autour de la Table ronde. Là, chacun racontait ce qu’il lui était arrivé : parfois des combats terribles, quand il fallait affronter des adversaires redoutables ou des monstres effrayants, parfois des histoires d’amour. Les dames et les demoiselles de la cour d’Arthur aimaient beaucoup ces récits, et chaque chevalier tentait, par ses brillants exploits, de conquérir le cœur de la dame dont il était amoureux.
Je vais donc vous raconter l’histoire d’un chevalier de la Table ronde, Yvain : vous apprendrez comment et dans quelles aventures il gagna le surnom de Chevalier au lion. Nobles seigneurs et charmantes dames, cette histoire vaut la peine d’être écoutée. Ouvrez donc bien grand vos oreilles et vos cœurs ! L’oreille ne suffit pas, car la parole y arrive comme le vent qui vole : elle ne peut y demeurer. Si le cœur n’est pas ouvert pour la saisir et s’en emparer, elle s’envolera, et ce sera grand dommage, car mon histoire est pleine d’enseignement. Elle vous apprendra beaucoup sur l’amour, comment on le gagne et comment on le perd, si l’on n’y prend point garde.
Chrétien de Troyes, Prologue d’Yvain, le chevalier au Lion, adapté par A.-M. Cadot-Colin, éd. Hatier, Paris, 2018, p. 14-15.
Guido Furci
05/12/2020
Depuis mon arrivée en France, Yvain, le chevalier au lion est indissociable de la lecture qu’en a proposé Eugène Green en 2003, dans une adaptation cinématographique qui n’en est pas une : Le monde vivant. Peuplé d’ogres et de fausses ogresses, de sorcières lacaniennes, de héros « en toile de Gêne à la mode de Nîmes » et d’esprits des bois, ce film est à la fois le rêve d’un enfant auquel on a raconté l’essentiel d’une histoire qu’il ne lira peut-être jamais, et l’hommage rendu par un réalisateur pour le moins atypique au pouvoir évocateur de la parole. Pour Green comme pour Chrétien de Troyes celle-ci arrive à l’oreille « comme le vent », mais « elle ne peut y demeurer », car « si le cœur n’est pas ouvert pour la saisir et s’en emparer, elle s’envolera ». D’une certaine manière, pour Green comme pour Chrétien de Troyes « perdre la parole » revient à se perdre soi-même – ou, du moins, à courir le risque que cela se produise.
Une fois de plus, c’est ce qui m’intéresse vraiment en relisant ce prologue, que j’avais dû commenter lors d’un examen de philologie romane à l’Université de Sienne, il y a environ dix-huit ans. Je ne peux m’empêcher de penser à tout ce que j’ai perdu, failli perdre ou gagné en dix-huit ans. Il y a dix-huit ans, j’avais dix-huit ans. Et toutes les histoires me semblaient pouvoir se passer « aujourd’hui », dans une espèce de présent éternel qui est sans doute à l’origine de ma tendance – certainement compensatrice et parfois un peu obsessionnelle – à vouloir toujours tout contextualiser. Restituer les narrations à un temps et à un espace bien précis – aussi artificielle que cette opération puisse paraître – a signifié pendant très longtemps le seul moyen de me donner l’impression de ne pas trahir les textes (au risque qu’ils me trahissent à leur tour). Et pourtant, en voulant trop être « à l’écoute » on finit par ne plus entendre – et surtout pas avec le « corps », qu’il faut souvent que je fasse l’effort de ne pas prononcer comme « cœur », même si chez Eugène Green et Chrétien de Troyes ces deux mots, tout en pouvant être profondément antinomiques, s’appellent l’un l’autre, jusqu’à se confondre.
« Au temps du roi Arthur, le chevalier qui avait donné son cœur à une dame ne le reprenait jamais, et cet amour courtois durait toute sa vie ». Comme dans une fable noire, l’idée de quelqu’un qui donne son cœur à quelqu’un d’autre m’inspire des représentations très concrètes : l’organe soustrait à la chair, les tremblements de la main qui le tend à l’être aimé, les spasmes d’un corps privé de ce qui l’anime, et pourtant là, figé dans un instant qui se veut éternel. Si j’ai été si sensible au travail d’Eugène Green c’est probablement parce que son cinéma nous encourage systématiquement à jouer avec les mots, à tester, pour ainsi dire, leur faculté de « faire image ». Dans son univers dépourvu d’anachronismes car la temporalité n’est jamais linéaire, la seule façon de procéder semble de « prendre les choses à la lettre », dans la mesure où saisir le sens d’une métaphore en l’absence d’un cadre de référence spécifique et historiquement déterminé ne serait pas tout à fait pertinent. Cela m’a semblé libérateur. Au point que, depuis la découverte du Monde vivant au Mk2 Beaubourg, je n’ai plus été capable de revenir à la littérature médiévale de la même manière qu’avant. Je m’en suis nourri de la façon dont on le fait parfois avec les poèmes – probablement dans le même but aussi. En ce qui me concerne, Chrétien de Troyes n’a pas trahi ses promesses (même si j’ai eu besoin de quelqu’un d’autre pour le comprendre pleinement) : en effet, si ses histoires se sont avérées riches « d’enseignement », c’est notamment parce qu’elles m’ont obligé à réfléchir d’une manière inédite et quelque peu décontractée aux notions de « méthode », « négociation » et « recevabilité » – plus encore que de « réception ».
« Madame, la Comtesse de Champagne, veut que j’entreprenne de faire un nouveau roman », nous explique le narrateur, en guise d’introduction. Ce à quoi il ajoute : « Je mettrai donc tout mon art, ma sagesse et ma peine dans cet ouvrage ». En ce qui me concerne, je sais que je suis désormais prêt à explorer une fois de plus ce que ces lignes préfigurent au prisme de ces trois termes – « art », « sagesse » et « peine » –, mais de ces trois termes tels que je les entends moi, dans une succession où chaque mot permet aux autres d’exister, autrement que d’ordinaire. Au fond, en me rappelant que l’histoire qu’on s’apprête à (me) raconter appartient à une époque révolue, qui n’est certainement pas celle du narrateur et probablement pas la mienne (que le narrateur n’a pourtant pas connue et qui, au fond, pourrait ressembler à son passé beaucoup plus qu’à son présent), on m’accorde la possibilité de voyager. Ce faisant, je m’interroge sur les différentes façons qu’ont les mots de voyager, et dans quels buts. En m’efforçant d’être « chambre d’écho » pour un discours qu’on ne peut pas toucher, mais prétend nous toucher, je me surprends à vouloir préciser le sens de concepts intimidants, et qui n’apparaissent jamais dans le texte, bien qu’ils le hantent : éternité, génération, postérité, réparation … Mixed feelings, diraient les anglophones : j’aimerais savoir m’en servir de manière plus désinvolte, et en même temps je ne peux m’empêcher de juger – parfois un peu trop rapidement, j’avoue – les personnes (et surtout les collègues) qui ont tendance à le faire.