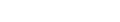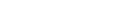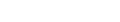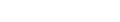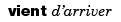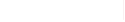Saynète n° 114.1.
En faisant ces réflexions je marchais en avant tout à loisir. Ce côté de l'île me parut beaucoup plus agréable que le mien ; les savanes étaient douces, verdoyantes, émaillées de fleurs et semées de bosquets charmants. Je vis une multitude de perroquets, et il me prit envie d'en attraper un s'il était possible, pour le garder, l'apprivoiser et lui apprendre à causer avec moi. Après m'être donné assez de peine, j'en surpris un jeune, je l'abattis d'un coup de bâton, et, l'ayant relevé, je l'emportai à la maison. Plusieurs années s'écoulèrent avant que je pusse le faire parler ; mais enfin je lui appris à m'appeler familièrement par mon nom. L'aventure qui en résulta, quoique ce ne soit qu'une bagatelle, pourra fort bien être, en son lieu, très divertissante.
Ce voyage me fut excessivement agréable : je trouvai dans les basses terres des animaux que je crus être des lièvres et des renards ; mais ils étaient très différents de toutes les autres espèces que j'avais vues jusque alors. Bien que j'en eusse tué plusieurs, je ne satisfis point mon envie d'en manger. À quoi bon m'aventurer ; je ne manquais pas d'aliments, et de très bons, surtout de trois sortes : des chèvres, des pigeons et des chélones ou tortues. Ajoutez à cela mes raisins, et le marché de Leadenhall n'aurait pu fournir une table mieux que moi, à proportion des convives. Malgré ma situation, en somme assez déplorable, j'avais pourtant grand sujet d'être reconnaissant ; car, bien loin d'être entraîné à aucune extrémité pour ma subsistance, je jouissais d'une abondance poussée même jusqu'à la délicatesse.
Dans ce voyage je ne marchais jamais plus de deux milles ou environ par jour ; mais je prenais tant de tours et de détours pour voir si je ne ferais point quelque découverte, que j'arrivais assez fatigué au lieu où je décidais de m'établir pour la nuit. Alors j'allais me loger dans un arbre, ou bien je m'entourais de pieux plantés en terre depuis un arbre jusqu'à un autre, pour que les bêtes farouches ne pussent venir à moi sans m'éveiller. En atteignant à la rive de la mer, je fus surpris de voir que le plus mauvais côté de l'île m'était échu : celle-ci était couverte de tortues, tandis que sur mon côté je n'en avais trouvé que trois en un an et demi. Il y avait aussi une foule d'oiseaux de différentes espèces dont quelques-unes m'étaient déjà connues, et pour la plupart fort bons à manger ; mais parmi ceux-là je n'en connaissais aucun de nom, excepté ceux qu'on appelle pingouins. J'en aurais pu tuer tout autant qu'il m'aurait plu, mais j'étais très ménager de ma poudre et de mon plomb ; j'eusse bien préféré tuer une chèvre s'il eût été possible, parce qu'il y aurait eu davantage à manger. Cependant, quoique les boucs fussent en plus grande abondance dans cette portion de l'île que dans l'autre, il était néanmoins beaucoup plus difficile de les approcher, parce que la campagne étant plate et rase, ils m'apercevaient de bien plus loin que lorsque j'étais sur les collines.
Daniel Defoe, Robinson Crusoe, https://beq.ebooksgratuits.com/vents/Defoe-Robinson-1.pdf, p. 131-132
Natacha Israël
06/11/2020
Des animaux. Beaucoup d’animaux.
Un homme dont l’existence quotidienne semble réduite à la recherche de nourriture, à la chasse notamment, manger figurant sa principale préoccupation.
Sa civilisation ?
Quelle civilité ?
Le narrateur n’est pas étranger à toute civilisation, on le sait. Mais il en est physiquement éloigné… Loin de toute cité, toute citoyenneté, toute règle de civilité écrite ou non écrite. Si on ne le surprend pas ici en flagrant délit de « violence » contre ses semblables (et pour cause), on le voit aux prises, tout autrement, avec la vie sauvage. Or, même si me glacent la perspective d’une vie réduite à la quête de nourriture et l’inquiétude de servir de nourriture aux bêtes, mon effroi vient au contraire d’abord de l’abondance de nourriture et j’y vois d’emblée un conflit de… civilisation. Ce qui enthousiasme ce narrateur civilisé suscite en moi une sorte de terreur elle-même… civilisée.
Le récit m’apparaît en effet comme l’énumération de créatures vivantes destinées à la consommation, donc vouées à la mort et à un processus de transformation en nourriture. Très vite, il me vient des images de « dodo », l’oiseau mauricien. L’enthousiasme du narrateur se retourne aussitôt pour moi en son contraire : il est aussitôt la promesse de l’épuisement plutôt que celle de se repaître infiniment. Je suis une lectrice des temps qui ne croient plus à la corne d’abondance ; des temps qui nous contraignent à une certaine frugalité, sans que nous manquions de rien en comparaison de Robinson ; des temps où l’on n’est pas loin de considérer celui qui chasse et mange si volontiers autant d’animaux de la même façon que Robinson, dans le roman, considère les cannibales. Mais un siècle où certains n’hésitent plus à dire aux mangeurs de viande que leur attitude est criminelle est très distant du siècle de Robinson, lequel trouvait plus civil de ne pas reprocher leurs coutumes aux cannibales, ces derniers ignorant simplement le common law anglais. Je devrais donc me retenir, sans doute, d’interpeller Robinson.
Ou bien ai-je quelques raisons de l’interpeller ?
Le cannibalisme n’aura pas inquiété l’Humanisme naissant de la même manière que la consommation de viande animale inquiète notre époque. La consommation de chair animale n’est pas un tabou ; nous pouvons faire société sans adopter le même régime alimentaire (n’étant pas végétarienne, je l’espère). Dans Robinson au contraire, la peur d’être mangé, que le nominalisme du narrateur ne peut dissiper, signale bien un obstacle majeur à la vie commune. Malgré le naufrage et l’isolement qui expose aux bêtes sauvages et aux cannibales, Robinson n’est pas seul. Entouré de créatures vivantes, il force un perroquet à lui tenir compagnie et vit en la compagnie du Livre. Vingt-huit ans sur l’île, à chasser, cultiver le blé, réaliser des poteries et enseigner la Bible à Vendredi, faisant apparemment œuvre de civilisation à défaut de pouvoir recréer la société dont il est séparé. Mais nommer un être humain d’après le jour de sa rencontre avec celui-ci, c’est pourtant à mes yeux faire preuve d’une pauvreté d’esprit qui m’évoque un isolement antérieur au naufrage, plus profond que celui du naufragé. On dirait un moyen mnémotechnique, bien qu’il s’agisse plutôt de l’expression caricaturale du pouvoir de nommer et de baptiser que s’arroge le « colon » du XVIIème siècle. De fait, tout être vivant me semble ici présenté comme une chose dans un grand magasin, attendant d’être rédimée. C’est la « société de consommation » sur l’île déserte d’O., les choses devant en quelque sorte être sauvées en devenant utiles à l’individu moderne – celui qui croit en la profusion des ressources naturelles, celui qui considère qu’elles lui ont été promises par Dieu ou qu’il en recevra d’autant plus qu'il saura les mériter par son travail et ses prières : car tout ce qu'il sait prendre attestera de son statut d'« élu » au jour du Jugement et, sur ce prétexte, il est en fait sur le point d'accomplir la plus grande œuvre de… destruction.
Robinson ou le fantasme de « mourir vivant » ; la puissance de destruction à l’œuvre dans le roman, à l’œuvre tout court (Derrida, La Bête et le souverain). Une force qui, jour après jour, n’œuvre pas à la vie, une force perceptible dans le récit même de la recherche de nourriture, dans le journal de survie. Un goût de mort là où m’est apparemment présenté le spectacle de la vie dans un puissant débordement, une profusion inquiétante. Sur l’île, on ne voit « ni couchers de soleil, ni levers de soleil », « ni solitude ni âme ». Pourtant, le récit est devenu un mythe. Ce que les lecteurs lui ont ajouté ne relève pas du textuel. Une communauté s’est mise à l’œuvre, fascinée par le fantasme de « mourir vivant », vouée au mouvement perpétuel qui est fuite en avant et à la consommation qui est consomption. Sortir du temps du séjour terrestre, faire défaut à la Terre en transcendant ses frontières, en dépassant toute limite, par le haut ou par le bas pourvu qu’on n’y soit pas ; pourvu qu’on ne soit plus rivé à l’île (d’O., l’Angleterre, l’angle de la Terre, le cercle des mers et nos ronds dans l’eau).
« Let’s go ».