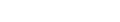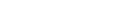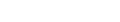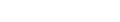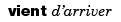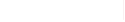n° 7 - H. Merlin-Kajman, Encore Chénier – Et au-delà
Littérarité n° 7
Préambule
Le texte d’Hélène Merlin-Kajman est tout d’abord une reprise patiente et exhaustive du long débat qui implique Transitions depuis plus d’un an maintenant autour de la représentation littéraire des violences sexuelles en particulier dans un poème de Chénier, « L’Oaristys ». L’attention minutieuse portée à l’échange des arguments rend particulièrement clair le mouvement polémique de cette conversation que compose aujourd’hui une dizaine de textes. Elle témoigne surtout d’une confiance dans le débat intellectuel, dans sa positivité et sa productivité et cela indépendamment du bonheur qui ou non l’accompagne (évoquant certains moments plus difficiles, Hélène Merlin-Kajman écrit ainsi : « on peut être enrichi par l’expérience de moments de tensions et de malentendus »).
Cette reprise n’est donc en aucun cas une manière de clôture. Au contraire : comme son titre l’indique, « Encore Chénier – et au-delà » continue le débat et davantage, le prolonge, le reformule, le déplace, le reformule encore et ne cesse de l’étendre à travers un jeu étourdissant de variations argumentatives. Le moteur théorique de ces variations, c’est la pensée du différend, terme emprunté à l’œuvre de Jean-François Lyotard. Il permet à Hélène Merlin-Kajman de déployer toutes les divergences interprétatives autour du poème de Chénier et d’en éclairer les enjeux. Chaque lecture est ainsi envisagée à partir de la scène de litige ou de différend qu’elle instaure avec celles qui l’ont précédée (ou qui lui succèdent) et à partir du tort ou du dommage qui s’y formule. Cette reconfiguration du débat, qui suspend (résolument) la question du sens du texte, facilite l’exploration des présupposés éthiques et politiques de chaque interprétation (quel idiome critique est choisi ? au détriment de quel autre ? quel sentiment est dédaigné ?). Le différend n’est jamais effacé : il devient au contraire le point d’origine de nouvelles lectures et de nouveaux déplacements – et de là, un des principes essentiels du discours critique sur la littérature.
Au terme d’un parcours dense mais virevoltant parmi les multiples interprétations du poème (et les différents arguments sociopolitiques qui les accompagnent), Hélène Merlin-Kajman parvient en effet à une redéfinition de la littérarité au sein de laquelle la figure du différend, par opposition au litige, occupe une place déterminante. Serait littéraire un objet « qui n’appelle pas à l’effectuation des contenus, mais maintient le désir dans l’inaccomplissement » et dont « les formes rendent indécidables ces « contenus » […] interdisant par là de les traduire en objets de litige (de savoir, de salut) ». On le voit : une telle définition qui fait une large place à la responsabilité du commentateur est avant tout un rappel éthique. Dans la mesure où elle articule étroitement l’irréductibilité de la différence et une confiance dans la conversation collective, elle constitue également, pour tous ceux qui interprètent, une reformulation profondément politique du travail critique.
Hélène Merlin-Kajman est professeure de littérature française du XVIIe siècle à l'université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, elle a fondé le mouvement Transitions et son site-revue. Elle a récemment écrit et publié Lire dans la gueule du loup. Essai sur une zone à défendre, la littérature (Gallimard, 2016) et L'Animal ensorcelé. Culture, Littérature, Transitionnalité (Ithaque, 2016).
Encore Chénier – et au-delà
Hélène Merlin-Kajman
12/01/2019
« Génocide, traumatisme. Depuis les trois dernières années, ces mots m’accompagnent partout où je vais. Ils parlent à ma place […]. Moi, je ne les comprends pas. Ils sont intraduisibles en kinyarwanda. » Annick Kayitesi-Jozan, rescapée tutsi
Les lignes qui suivent voudraient éclairer le mouvement qui m’a poussée à écrire une saynète consacrée à un poème d’André Chénier, « L’Oaristys », et publiée sur le site de Transitions[1]. Ce poème figurant au programme d’agrégation de lettres modernes et classiques 2017-2018[2] avait fait l’objet d’une lettre d’agrégatifs adressée, en octobre 2017, aux deux jurys d’agrégation pour leur demander de se prononcer sur ce dont il était la représentation, et avait été publiée peu de temps après sur le blog d’une association féministe de l’ENS de Lyon, « Les Salopettes[3] ». Pour les signataires, il s’agissait d’un viol sans l’ombre d’une hésitation, même si le texte ne le nommait pas, ne le donnait pas pour tel. Mais, expliquaient-ils, cette évidence avait été repoussée par certains enseignants-chercheurs préparant les agrégatifs au concours, notamment au motif de l’anachronisme de l’interprétation et de son irrecevabilité par un jury. Pour cette raison, ils interpellaient ces mêmes jurys et les sommaient d’autoriser cette qualification.
Je vais bien sûr revenir sur cette lettre, qu’il est difficile de résumer en deux phrases sans la trahir. Mais mon but, à l’occasion de cette controverse, est surtout de réfléchir aux enjeux d’une lecture littéraire et aux motivations, théoriques et non théoriques, qui peuvent la soutenir. Aussi voudrais-je surtout, enrichie par bien des discussions (qui ne sont pas toutes heureuses : on peut être enrichi par l’expérience de moments de tensions et de malentendus), reformuler aujourd’hui ma position, sans augurer des nouvelles perplexités qui pourraient m’amener ultérieurement à lui donner de nouvelles formulations.
Non que ma position soit indécise. Elle est perplexe, mais n’est ni confuse ni indécise. Simplement, en ce sujet plus qu’en tout autre, je ne prétends pas détenir la vérité. Mon discours est plutôt animé par l’obligation où je me sens d’enchaîner, c’est-à-dire moins de soutenir une position déterminée que d’ouvrir un lieu de discours, dans le but de susciter réflexion commune et débats. Il s’agit là d’éthique critique, comme le dit Brice Tabeling dans le texte remarquable qu’il a écrit sur cette même controverse [4].
Chronologie
De retour des États-Unis où j’étais visiting professor en septembre et octobre 2017, j’ai suscité une réunion du séminaire de Transitions pour discuter des débats dont je venais de prendre connaissance autour du trigger warning, notamment grâce à une intervention d’Anne E. Berger à l’issue d’une conférence que j’avais donnée devant le French Department de Rutgers University[5]. J’y présentais les raisons d’« enseigner avec civilité », civilité que je rattache à la transitionnalité théorisée dans mes deux derniers livres[6].
En fait, j’ai déjà défendu la valeur de la civilité dans La langue est-elle fasciste ?[7] , et ceci, déjà en rapport avec le souci de trouver ce que Patrice Loraux appelle « un bon dispositif », c’est-à-dire un dispositif mémoriel (artistique ou non) capable de sortir le public de la sidération traumatique collective causée par une disparition de masse telle que le génocide nazi. Je suis en effet convaincue, comme je l’explique dans ce livre et dans les deux derniers, que cette catastrophe historique nous hante depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, provoquant des effets en partie invisibles dans la transmission culturelle, notamment dans l’enseignement de la langue et de la littérature. Dans La langue est-elle fasciste ?, j’ai essayé de montrer comment la volonté de transmettre une sorte d’incivilité rebelle habitait l’enseignement de la langue, incivilité qu’il fallait selon moi comprendre comme la reconduction traumatique de la perte de confiance dans la culture occidentale occasionnée d’abord par la Première Guerre mondiale, puis démultipliée par la Seconde. Ce que j’essaie de suggérer, c’est que loin d’être une solution progressiste sinon révolutionnaire, cette prescription de méfiance et d’incivilité a pour effet de conduire à une anomie destructrice du lien social et des places symboliques démocratiques, donc d’augmenter la force disruptive des logiques de domination capitaliste et même de s’en rendre complice.
Ma réflexion sur ces questions est donc ancienne. Cependant, tant que j’ai mis en avant la valeur de la « civilité » (et malgré le renfort théorique que j’ai pu trouver plus tard auprès d’autorités intellectuelles incontestablement de gauche comme celle d’Étienne Balibar[8]), ma position a été peu écoutée. L’idée, le mot de « civilité », avaient un relent d’ethnocentrisme, de distinction bourgeoise et de conservatisme réactionnaire[9], ce qui parasitait la plupart des débats[10] : je me suis donc souvent vue accusée de faire le lit du lepénisme, de vouloir réintroduire dans l’enseignement littéraire des jugements moraux et esthétiques douteux, voire des censures, etc.
L’apport de la réflexion de Winnicott d’un côté, et le temps passé de l’autre, temps qui a vu s’aggraver les problèmes dits d’incivilités et en surgir de nouveaux, tout ceci pendant qu’une nouvelle génération arrivait à l’âge adulte, ont rendu mes propositions plus audibles. Mais elles le deviennent au risque de nouveaux malentendus.
Dans la discussion qui a suivi mon exposé, Anne E. Berger a ainsi souligné qu’il serait facile de confondre mes propositions avec la pratique pédagogique du trigger warning, et elle a dit pourquoi, selon elle, elles en différaient totalement. Je ne saurais trop la remercier d’avoir immédiatement saisi cette différence non moins que d’avoir attiré mon attention sur cette proximité problématique. En effet, en me penchant sur les débats américains portant sur le trigger warning, je me suis aperçue que sa pratique était souvent justifiée par une simple exigence de civilité (de courtesy). Avertir les étudiants des contenus de cours susceptibles de les blesser en leur rappelant un traumatisme ou une offense qu’ils pourraient avoir subis relève du simple tact, des égards, de la civilité, soutiennent les défenseurs du trigger warning, tandis que d’autres protagonistes des débats concluent que le problème n’existe pas quand on sait établir avec les étudiants un rapport de confiance et de contractualité respectée.
Tact, égards, civilité, confiance, respect, contrat : ce sont presque les termes que, l’année précédente, dans le cadre d’une session de formation permanente en direction des enseignants du secondaire de l’Académie de Créteil où nous présentions la « transitionnalité », Virginie Huguenin, Sylvie Cadinot et moi-même avions avancés, devant un public nettement divisé, pour définir le partage transitionnel des textes littéraires en contexte pédagogique. Mais des mots-clefs ne suffisent pas à résumer un raisonnement, un horizon, une pratique critique et pédagogique : la transitionnalité a peu à voir avec le trigger warning (du moins dans son acception la plus générale). Anne E. Berger a raison.
L’enjeu cependant est de taille. Convaincue de l’importance, et même de l’urgence, d’y réfléchir, j’ai donc proposé à Lise Forment, directrice de Transitions, de consacrer une séance de séminaire à débattre du trigger warning.
Cependant, ce débat s’est trouvé surdéterminé par d’autres débats, ceux qui avaient surgi du mouvement #MeToo, d’autant qu’un certain nombre des « traumatismes » évoqués dans les affaires de trigger warning concernent le viol.
À l’issue de cette séance où des désaccords et des tensions se sont fait jour, un membre de Transitions m’a alors appris l’existence de la lettre aux jurys d’agrégation évoquée plus haut.
Ayant pris connaissance de cette lettre, j’ai immédiatement pensé que les problèmes qu’elle soulevait étaient eux aussi d’une extrême importance pour notre mouvement Transitions. Il se trouve en effet qu’elle évoque en des termes semblables, c’est-à-dire comme une représentation de viol, à la fois « L’Oaristys » et le sonnet XX des Amoursde Ronsard[11] : la lettre ne porte donc pas seulement sur un texte accidentellement placé au programme du concours d’agrégation, mais le fait entrer dans une catégorie, celle des textes représentant des violences sexuelles non identifiées par l’histoire littéraire ni clairement commentées comme telles par la critique.
Il se trouve que le sonnet XX des Amours de Ronsard a fait l’objet d’un commentaire sur un autre blog féministe sous le titre : « Petit guide littéraire et mythologique pour violer mais pas trop violemment », commentaire que j’avais cité, et contesté en lui opposant une lecture transitionnelle, dès la conférence prononcée devant le Département de Rutgers[12]. Que le sonnet de Ronsard puisse, en tant que « représentation d’un viol », être mis sur le même plan que le poème de Chénier par tous les signataires de la lettre, au nombre desquels des chercheurs chevronnés (j’y reviendrai) m’a saisie : l’enjeu est bien celui d’un nouveau paradigme de lecture, une sorte de trigger warning militant voulant avertir des violences de genre dissimulées dans les textes littéraires pour dénoncer la « culture du viol » qui les habiterait et qu’ils transmettraient sans que quiconque s’en émeuve.
Enjeu politique, donc, très analogue aux enjeux sur lesquels Transitions se penche. Il y avait là pour nous une nouvelle occasion d’approfondir nos propres propositions théoriques et positions critiques, une chance à saisir pour en débattre. J’ai donc proposé une nouvelle réunion de séminaire pour discuter de cette lettre et du poème de Chénier, suscitant de nouveaux débats, nettement plus houleux et passionnés que lors de la séance sur le trigger warning.
C’est à l’issue de cette séance que j’ai décidé d’écrire une saynète. Je n’avais pas alors de temps disponible pour transformer mon exposé introductif, une présentation critique rapide et de la lettre et du poème, en un article mieux articulé. Mais la solution de la saynète me plaisait : le poème de Chénier se prêtait bien à l’écriture de ce que nous appelons « saynète », commentaire d’un texte mettant en jeu du « vivre-ensemble », et où nous sommes libres de combiner et faire dialoguer l’expression de nos sentiments personnels, de nos doutes et de nos émotions, et une réflexion plus académique. Bien sûr, le poème de Chénier était un peu long pour une saynète, d’autant que je ne voulais pas l’amputer des passages incriminés par la lettre des agrégatifs. Je l’ai coupé, mais très peu, ce qui m’a conduite à raccourcir d’autant mon propre commentaire. La saynète est une forme brève, je tiens à le souligner : cette contrainte du genre m’a imposé de supprimer certains des développements initialement prévus, afin de ne pas trahir la forme.
En choisissant de m’exprimer dans une saynète, j’avais aussi l’idée qu’il serait ainsi facile à d’autres de répondre par une autre saynète portant sur le même texte. Lise Forment a plutôt choisi de poursuivre le dialogue par une saynète, très longue pour le coup, portant sur un autre texte, un extrait de La Mère Coupable de Beaumarchais (« Plus qu’une saynète : Beaumarchais[13] »). Cependant, son commentaire porte aussi parfois sur le poème de Chénier et sur le commentaire que ma propre saynète en propose.
Entre temps, sept des signataires de la lettre des agrégatifs ont répondu à ma saynète « Chénier » dans un texte intitulé « Voir le viol. Retour sur un poème de Chénier[14] » : contestant l’expression de « quasi viol » que j’avais avancée dans ma saynète, ils développent les raisons pour lesquelles il faut selon eux identifier sans la moindre hésitation possible la représentation d’une scène de viol dans le poème de Chénier. Brice Tabeling a réagi à leur réponse par un texte, « Voir ou ne pas voir le viol. Éthique du métadiscours », publié dans la rubrique « Littérarités » du site de Transitions[15], dont je partage la perspective et la plupart des conclusions.
Le dossier s’est donc épaissi, et, surtout, complexifié en raison de sa structure conversationnelle et/ou polémique. Je voudrais essayer de le reprendre comme il se présente à moi aujourd’hui, pour autant qu’à l’exclusion de la lettre des agrégatifs, je me trouve interpellée plus ou moins directement par chacun des textes que je viens d’énumérer. Mon but, en le déployant pour moi-même, pour Transitions, est de contribuer à la réflexion commune concernant l’avenir de la littérature et de son enseignement – peut-être même l’avenir du lien social. J’insiste : il s’agit bien d’un essai, pas d’une clôture, d’un essai que j’espère patient, prudent, sans coquetterie ni faux-fuyant, dans la mesure de mes moyens. Les auteurs de « Voir le viol » jugent « ambiguë » ma « position d’autrice » dans ma saynète : « simple lectrice ou autorité institutionnelle ? ». À la vérité, comme je réfute l’antithèse (qui hérite d’un soupçon très bourdieusien selon lequel en mettant en avant ma qualité de simple lectrice je dissimulerais la violence symbolique de mon autorité de lector), je laisse le lecteur libre de répondre à cette question (ou de la refuser comme moi-même), en le renvoyant à ce que j’ai dit plus haut du genre de la saynète, par lequel nous cherchons explicitement à renouveler l’écriture critique ; j’ajouterais, anticipant sur ce qui suit : et témoigner du différend.
« L’Oaristys » : un texte sans grand intérêt (pour moi)
Pour écrire ce qui suit, je décide de relire une nouvelle fois le texte de Chénier sans relire la lettre des agrégatifs. Bien sûr, je n’ai pas la naïveté ou la mauvaise foi de croire que je peux relire Chénier comme si je ne l’avais jamais lue, elle. Mais je sais que quand je la relis, certains passages un peu oubliés fixent mon attention et conditionnent fortement mon regard porté sur « L’Oaristys ». Ne pas la relire, donc, c’est me tenir à distance de sa logique, afin qu’elle ne constitue pas le prisme principal, un peu aveuglant, au travers duquel lire le poème de Chénier. Ne pas la relire, c’est décider de me concentrer sur lui en me plaçant en imagination dans un contexte ou une situation où j’aurais pu me trouver seule avec lui, le découvrir par hasard, et de là, éventuellement envisager (ou non) de le partager avec une classe ; et ceci, non dans le cadre d’un cours d’agrégation, mais dans un cadre pédagogique plus libre parce qu’il ne viserait pas à faire réussir une dissertation, une leçon ou une explication de texte sur programme de l’agrégation de lettres modernes (ou classiques).
Mais d’abord, pour la bonne intelligence du dossier, je crois utile que, cette fois (je veux dire contrairement à la saynète que je lui ai consacrée), mes lecteurs en prennent connaissance dans son entier :
Daphnis
Hélène daigna suivre un berger ravisseur ;
Berger comme Pâris, j’embrasse mon Hélène.
Naïs
C’est trop t’enorgueillir d’une faveur si vaine.
Daphnis
Ah ! ces baisers si vains ne sont pas sans douceur.
Naïs
Tiens, ma bouche essuyée en a perdu la trace.
Daphnis
Eh bien ! d’autres baisers en vont prendre la place.
Naïs
Adresse ailleurs ces vœux dont l’ardeur me poursuit :
Va, respecte une vierge.
Daphnis
Imprudente bergère,
Ta jeunesse te flatte ; ah ! n’en sois point si fière :
Comme un songe insensible elle s’évanouit.
Naïs
Chaque âge a ses honneurs, et la saison dernière
Aux fleurs de l’oranger fait succéder son fruit.
Daphnis
Viens sous ces oliviers ; j’ai beaucoup à te dire.
Naïs
Non ; déjà tes discours ont voulu me tenter
Daphnis
Suis-moi sous ces ormeaux ; viens de grâce écouter
Les sons harmonieux que ma flûte respire :
J’ai fait pour toi des airs, je te les veux chanter ;
Déjà tout le vallon aime à les répéter.
Naïs
Va, tes airs langoureux ne sauraient me séduire.
Daphnis
Eh quoi ! seule à Vénus penses-tu résister ?
Naïs
Je suis chère à Diane ; elle me favorise.
Daphnis
Vénus a des liens qu’aucun pouvoir ne brise.
Naïs
Diane saura bien me les faire éviter.
Berger, retiens ta main… berger, crains ma colère.
Daphnis
Quoi ! tu veux fuir l’Amour ! l’Amour à qui jamais
Le cœur d’une beauté ne pourra se soustraire ?
Naïs
Oui, je veux le braver… Ah !… si je te suis chère…
Berger… retiens ta main… laisse mon voile en paix.
Daphnis
Toi-même, hélas ! bientôt livreras ces attraits
À quelque autre berger bien moins digne de plaire.
Naïs
Beaucoup m’ont demandée, et leurs désirs confus
N’obtinrent, avant toi, qu’un refus pour salaire.
Daphnis
Et je ne dois comme eux attendre qu’un refus ?
Naïs
Hélas ! l’hymen aussi n’est qu’une loi de peine ;
Il n’apporte, dit-on, qu’ennuis et que douleurs.
Daphnis
On ne te l’a dépeint que de fausses couleurs :
Les danses et les jeux, voilà ce qu’il amène.
Naïs
Une femme est esclave.
Daphnis
Ah ! plutôt elle est reine.
Naïs
Tremble près d’un époux et n’ose lui parler.
Daphnis
Eh ! devant qui ton sexe est-il fait pour trembler ?
Naïs
À des travaux affreux Lucine nous condamne.
Daphnis
Il est bien doux alors d’être chère à Diane.
Naïs
Quelle beauté survit à ces rudes combats ?
Daphnis
Une mère y recueille une beauté nouvelle :
Des enfants adorés feront tous tes appas ;
Tu brilleras en eux d’une splendeur plus belle.
Naïs
Mais, tes vœux écoutés, quel en serait le prix ?
Daphnis
Tout : mes troupeaux, mes bois et ma belle prairie ;
Un jardin grand et riche, une maison jolie,
Un bercail spacieux pour tes chères brebis ;
Enfin, tu me diras ce qui pourra te plaire ;
Je jure de quitter tout pour te satisfaire :
Tout pour toi sera fait aussitôt qu’entrepris.
Naïs
Mon père…
Daphnis
Oh ! s’il n’est plus que lui qui te retienne,
Il approuvera tout dès qu’il saura mon nom.
Naïs
Quelquefois il suffit que le nom seul prévienne :
Quel est ton nom ?
Daphnis
Daphnis ; mon père est Palémon.
Naïs
Il est vrai : ta famille est égale à la mienne.
Daphnis
Rien n’éloigne donc plus cette douce union.
Naïs
Montre-les moi, ces bois qui seront mon partage.
Daphnis
Viens ; c’est à ces cyprès de leurs fleurs couronnés.
Naïs
Restez, chères brebis, restez sous cet ombrage.
Daphnis
Taureaux, paissez en paix ; à celle qui m’engage
Je vais montrer les biens qui lui sont destinés.
Naïs
Satyre, que fais-tu ? Quoi ! ta main ose encore…
Daphnis
Eh ! laisse-moi toucher ces fruits délicieux…
Et ce jeune duvet…
Naïs
Berger… au nom des dieux…
Ah !… je tremble…
Daphnis
Et pourquoi ? que crains-tu ? Je t’adore.
Viens.
Naïs
Non ; arrête… Vois, cet humide gazon
Va souiller ma tunique, et je serais perdue ;
Mon père le verrait.
Daphnis
Sur la terre étendue
Saura te garantir cette épaisse toison.
Naïs
Dieux ! quel est ton dessein ? Tu m’ôtes ma ceinture.
Daphnis
C’est un don pour Vénus ; vois, son astre nous luit.
Naïs
Attends… si quelqu’un vient. Ah ! dieux ! j’entends du bruit.
Daphnis
C’est ce bois qui de joie et s’agite et murmure.
Naïs
Tu déchires mon voile !… Où me cacher ? Hélas !
Me voilà nue ! où fuir !
Daphnis
À ton amant unie,
De plus riches habits couvriront tes appas.
Naïs
Tu promets maintenant, tu préviens mon envie,
Bientôt à mes regrets tu m’abandonneras.
Daphnis
Oh ! non ! jamais. Pourquoi, grands dieux ! ne puis-je pas
Te donner et mon sang, et mon âme, et ma vie ?
Naïs
Ah !… Daphnis ! je me meurs… Apaise ton courroux, Diane.
Daphnis
Que crains-tu ? L’amour sera pour nous.
Naïs
Ah ! méchant, qu’as-tu fait ?
Daphnis
J’ai signé ma promesse.
Naïs
J’entrai fille en ce bois et chère à ma déesse.
Daphnis
Tu vas en sortir femme, et chère à ton époux[16].
Ce texte virtuose, rapide, alerte voire allègre, me laisse froide. Je le trouve d’abord, dans une prise de contact de premier degré, sans intérêt aucun. À mes yeux, l’évidence de ses références ne dépasse pas la connivence culturelle : « Hélène daigna suivre un berger ravisseur ; / Berger comme Pâris, j’embrasse mon Hélène ». Je ne lis dans son paysage buccolique que des stéréotypes :
D. : Viens sous ces oliviers [… ] Suis-moi sous ces ormeaux […] Tout : mes troupeaux, mes bois et ma belle prairie ; / Un jardin grand et riche, une maison jolie, / Un bercail spacieux pour tes chères brebis ; […] Viens ; c’est à ces cyprès de leurs fleurs couronnés./ N. : Restez, chères brebis, restez sous cet ombrage. D. : Taureaux, paissez en paix ; à celle qui m’engage / Je vais montrer les biens qui lui sont destinés.
Ses sentences, somme toute nombreuses, contredisent selon moi l’érotisme visé par le texte : « Chaque âge a ses honneurs, et la saison dernière / Aux fleurs de l’oranger fait succéder son fruit ». « Hélas ! l’hymen aussi n’est qu’une loi de peine ; » « À des travaux affreux Lucine nous condamne. » C’est Naïs qui énonce ces maximes. Mais Daphnis n’est pas en reste, il objecte : « Une mère y recueille une beauté nouvelle ». Plus haut il avait aussi affirmé : « Vénus a des liens qu’aucun pouvoir ne brise. »
Cette relative lourdeur didactique du poème encombre le jeu de la séduction censée s’y déployer. Elle l’insère dans un ordre moral et social parfaitement respecté : seule l’ardeur juvénile qui anime la parole de Daphnis (« Vénus ») fait événement en bouleversant les étapes instituées du temps du mariage ; mais si peu, et si unilatéralement. Bref, ce poème ne me semble pas, ne m’est pas beau : rien en lui ne me touche a priori.
Et ce n’est pas un détail à mes yeux. Même si c’est un jugement de valeur devenu suspect (en tout cas, parmi les intellectuels de gauche, dont je suis), et même s’il est de fait assez difficile à justifier, je l’assume. Mais comment définir un peu pourquoi un texte nous semble beau[17] ? Cette subjectivité de l’effet esthétique peut-elle être précisée de façon partageable ?
Quand un texte littéraire me donne envie de dire « c’est beau ! », c’est que quelque chose s’y passe, qui ne concerne certes pas que son « représenté », mais sa « forme-sens ». Quelque chose se passe dans l’écriture, dans cette langue cherchée qui caractérise toute écriture selon Gérald Sfez[18], dans ses flexions, son rythme, le choix de ses mots, sa syntaxe, qui me saisit avec une évidence et une intensité heureuses, quand bien même il y aurait du malheur ou de la souffrance en jeu. « Évidence », parce que je reconnais ; et pourtant ce quelque chose me surprend, me méduse même : car l’évidence d’un texte beau ne s’anticipe pas. D’où aussi, mais en un autre sens, un sentiment immédiat de reconnaissance : de gratitude, d’émotion, parce que quelqu’un est là, intensément là, dans une singularité qui m’est adressée au bord de l’abîme, c’est-à-dire de là où elle aurait pu ne jamais être adressée[19].
C’est cela : un texte beau me saisit par la singularité de ce qu’il me transmet : non pas une singularité qui s’adresserait à ma curiosité, à ma sagacité critique, à mon ignorance dont elle repousserait les bornes en me présentant un nouveau cas, un cas inconnu de moi jusque-là, mais une singularité adressée de justesse et avec justesse. Il ne s’agit pas d’agrandir mon savoir. La singularité en question me touche esthétiquement dans un sentiment de commune humanité au bord du gouffre de son énigme[20] : commune et pourtant me transportant ailleurs (non sans rapport avec ce que dès 1925, le critique russe Viktor Chklovski avait nommé « estrangement »[21]). Un beau texte me donne à ressentir le caractère irremplaçable d’une présence affectée, et qui se bat dans la langue avec ce qui l’affecte, quel que soit le choix esthétique de sa manière de se battre, d’habiter la langue, de la rendre accueillante à sa singularité, de l’en pénétrer. Présence d’un regard, d’un corps, d’une écriture, grâce à quoi le texte suscite, (r)éveille, (r)allume, agite, des zones de ma personne qui me font me sentir en vie, m’assurent que la vie vaut la peine d’être vécue, même jusqu’à l’angoisse ou au désespoir : car dans ce dernier cas, la présence qui habite un texte beau, et, l’habitant, me le donne, arrête ce désespoir juste avant le stade où il pourrait m’effondrer, me rendre cruelle, voyeuse, complice ou seulement indifférente à lui, me donner envie de mourir, ou me faire perdre le goût d’être née.
Là, rien. J’éprouve beaucoup d’ennui à ces sentences, ces prosaïsmes versifiés, ces dieux grecs de convention. J’éprouve aussi une nette irritation et révolte à voir le poncif misogyne pointer son nez : les femmes ne peuvent pas dire oui sans dire non, il faut toujours les violenter un peu pour éveiller leur désir, c’est tellement plus excitant pour un homme (non, soyons juste : pour beaucoup d’hommes[22]). Peut-être est-ce la raison pour laquelle ce texte ne me paraît pas beau : il est organisé autour d’une hétérosexualité masculine assez plate, naïve en un sens, d’une hétérosocialité qui se suffit à elle-même ou quasiment, et écrase tout tremblé, tout trouble dans le jeu des identifications. Même si le texte ne veut pas représenter un viol, ce qu’il nous montre y ressemble dès que je me déplace du côté de la jeune fille : c’est un passage à l’acte qui repose sur un forçage, une violence faite à l’énigme anxieuse du désir féminin. Le rythme érotique de l’échange n’est pas un rythme accordé ; ce n’est pas non plus un rythme désaccordé (car la discordance me ferait alternativement sentir avec le jeune homme et avec la jeune fille) ; c’est, plus simplement, un rythme solipsiste qui épouse l’impatience érotique du berger, sans rien me faire ressentir de l’ambivalence craintive et pudique de la bergère en principe présentée (surgissement du désir, attirance et résistance, surprise et trouble, dont le motif est annoncé par le verbe « trembler »[23]).
C’est en somme, pour moi, un texte écrit dans un rapport de connivence strictement masculine et fondamentalement misogyne, connivence qui déborde de très loin le champ de la sexualité et qui n’imagine pas vraiment que les femmes soient des sujets : voici l’évidence qui s’impose immédiatement et péniblement à moi à sa lecture. « Masculin », cela signifie un texte qui ne me vise pas comme lectrice, mais comme miroir. Un texte qui ne me fait pas place. Il ne me donne pas accès au vertige de la différence : ici, par hypothèse, la différence d’un homme par rapport à une femme, la différence de la structure de leur désir. Il ne me conduit à rien de l’homme en sa différence possible. Pourquoi ? tout simplement parce qu’il ne s’en préoccupe pas : dans ce texte, la position d’homme prend toute la place sans s’en apercevoir. Il sature l’espace du possible en mettant même en scène une parole de femme : car il la met en scène sans écouter, sans faire pleinement entendre ce qu’elle dit (« Berger… retiens ta main… laisse mon voile en paix. »), plaçant ainsi l’altérité dans l’orbite d’un seul désir, d’un seul scénario fantasmatique. Et quand il cesse de monologuer, quand le dialogue délibératif est crédible en tant que dialogue, l’horizon que les deux amants partagent (l’évocation du mariage, de la famille, du consentement du père, l’énumération des biens et l’autoprésentation du prétendant, par quoi on comprend que les statuts des jeunes gens sont accordés, que le mariage va avoir lieu) est tellement conforme et conformiste que rien de mon plaisir ne s’y accroche.
Enseignement transitionnel
J’essaie de suivre jusqu’au bout la piste de cette impression de lecture désagréable.
La littérature regorge de textes mauvais ou médiocres, ce dont on ne parle pas assez quand on réfléchit sur la littérature. Au contraire, une tendance critique, qui commence à dater et à devenir un poncif comme un autre, veut que les textes « mineurs » ne doivent cette qualité inférieure qu’au fait qu’ils ont perdu la bataille de la reconnaissance légitime. Ils auraient été écartés par les institutions littéraires, malgré leur valeur, égale à celle des textes « majeurs ». Du coup, les programmes universitaires actuels regorgent de textes qui peuvent avoir de l’intérêt mais sont esthétiquement médiocres, parce qu’on a systématiquement voulu les réhabiliter.
Comment renverser cette tendance sans retomber dans le culte « bourgeois » des grandes œuvres ou dans la définition quasi religieuse de l’art ?
Une proposition théorique de Jérôme David fournit un outil éthique et critique important. Plutôt que de penser le texte littéraire en termes de représentation, de référentialité ou de sens, il propose de considérer qu’un texte littéraire présente un engagement ontologique particulier[24] : « il dit ce qu’il y a ». Il institue un monde par le biais de l’imagination, faculté par laquelle est récusée l’opposition entre ce qui est réellement réel, et le monde de la fiction. Et Jérôme David ajoute une conséquence très importante, car elle réintroduit dans la démarche critique l’autorisation de juger un texte littéraire : « Un engagement ontologique appelle un assentiment[25]. »
Je ne donne pas mon assentiment à ce poème de Chénier : son engagement ontologique ne me concerne pas, me déplaît même. Il ne m’intéresse que comme symptôme ou document. Aussi ne présenterais-je pas ce poème à une classe. Il y a tant de textes auquel donner son assentiment avec transport, ferveur, conviction, espoir, inquiétude, etc., que ce choix n’aurait à mes yeux aucune justification possible. Enseigner la littérature n’a pas pour but, selon moi, de transmettre un message, fût-il critique, mais d’agrandir l’imagination pour faire grandir en subjectivité, comme je l’explique dans mon article sur le trigger warning en m’appuyant à la fois sur une définition de la subjectivité donnée par Monique David-Ménard, psychanalyste et philosophe[26], et sur la définition de la civilité de Balibar évoquée plus haut.
Mais évidemment, toute carrière d’enseignant comprend des moments où on fait cours sur des textes qu’on n’a pas, et n’aurait pas, choisis. Si un programme décidé sans moi me faisait l’obligation de commenter « L’Oaristys », j’essaierais de faire sentir aux élèves ou aux étudiants pourquoi il est selon moi médiocre. Je leur présenterais donc mes réflexions précédentes ; et je leur ferais notamment sentir ce que la position de désir de l’homme a de violent et d’injustifiable.
Mais comme l’écrit encore Jérôme David, « Toute œuvre est passible de plusieurs formes d’assentiment », ce qui signifie aussi que les « communautés » suscitées par les œuvres « n’instaurent pas les mêmes liens avec ou entre les lecteurs ». Le moment où l’on présente un texte à une classe est un moment d’instauration d’une forme de communauté et d’assentiment, fût-ce de façon éphémère. Je ne crois pas que le rôle d’un enseignant soit d’instaurer un assentiment militant, ni qu’un texte vraiment littéraire soit un support pour une conviction militante. Donc, surtout face à une classe, on peut décider de donner sa chance à un texte, d’accueillir son engagement ontologique en le présumant moins univoque que l’impression qu’on a pu en recevoir à la première lecture, dans l’espoir de ne pas heurter de front une réaction de lecture inconnue, de rester en contact avec les lecteurs que ce texte aura pu toucher favorablement. La transitionnalité est dans le partage, lequel s’invente dans la rencontre entre un assentiment premier (ou une absence d’assentiment, ici), et le genre d’assentiment que l’on désire faire naître : jamais de façon extorquée, intrusive, abusive.
Deux aspects du texte retiendraient alors mon attention.
D’abord, l’évidence : ce texte n’est pas un texte exactement mimétique. Il n’est pas fait pour être lu littéralement, ou pas seulement. Il repose sur des figures : il n’y a aucune vraisemblance à ce que Naïs garde des brebis (pas des moutons, des brebis), et que Daphnis en revanche garde des taureaux : la sexualité gagne le décor de la pastorale. L’allusion érotique de ces vers est donc manifeste :
Naïs
Non ; arrête… Vois, cet humide gazon
Va souiller ma tunique, et je serais perdue ;
Mon père le verrait.
Daphnis
Sur la terre étendue
Saura te garantir cette épaisse toison[27].
De même, le « voile » déchiré peut être entendu comme la métaphore de l’hymen de Naïs. À la différence des « fruits délicieux » et du « jeune duvet », la métaphore conserve un sens littéral, créant ainsi, comme pour l’« humide gazon », une équivoque.
À la vérité, je ne suis pas vraiment certaine que ces figures cachées ne confirment pas la connivence tyranniquement masculine établie par le poème. Mais les présenter (prudemment, avec des arguments appuyés sur l’exemple d’autres textes où des équivoques analogues sont plus évidentes), en sourire sinon en rire, aurait le mérite de desserrer cette connivence : on peut enchaîner, parler, blâmer, s’étonner, dire son plaisir, s’indigner... On peut comprendre ce que sont des équivoques, en citer d’autres, réfléchir sur leurs fonctions, etc.
Quoiqu’il soit lié au précédent, le second aspect me paraît plus intéressant. J’ai dit plus haut que la convention mythologique du texte n’évoquait rien pour moi. Ce n’est pas une raison pour la négliger. Nous avons largement perdu contact avec l’imaginaire païen, la liberté que la mythologie permettait d’introduire dans le monde chrétien : notre culture, délestée du poids moral d’un christianisme hostile au plaisir, n’en a plus (eu) besoin. C’est pourtant, dans notre monde où la question du plaisir divise pour de nouvelles raisons (consumérisme vs intégrismes, pour faire vite), une ressource qui n’est pas sans promesse, parce qu’elle dépayse. Ce qui est certain, c’est que « L’Oaristys » célèbre la victoire de Vénus sur Diane. Or, Daphnis ne cherche pas à séduire Naïs pour l’abandonner : il l’épousera. Mais il ne veut pas seulement l’épouser : il la convie aux plaisirs de la sexualité en l’arrachant à sa consécration à Diane, c’est-à-dire à la survalorisation de sa virginité. Il paraît probable que le poème conteste la sacralité de la virginité, peut-être même de la chasteté ; qu’il veut en libérer les jeunes gens, peut-être même surtout les jeunes filles (c’est impossible à déterminer de façon certaine). Ici, faire l’amour ne dépend ni du consentement des dieux ni de celui des parents. En « sign[ant] sa promesse », Daphnis a placé le lien conjugal non sous le signe du devoir, mais sous celui de l’amour et du désir.
De nombreuses objections peuvent être opposées à cette piste, et je les ai faites par avance : Naïs désirait-elle vraiment Daphnis ? Ne l’a-t-il pas forcée ? Mais cette piste a un intérêt : elle permet, avec prudence, dans l’implicite, de ne pas être prisonniers d’un présupposé invisible, mais culturellement violent (selon une connivence socio-culturelle en quelque sorte inverse à celle du texte) : la question de la virginité des filles serait un archaïsme que l’on devrait combattre de façon militante. C’est oublier que, pour tous ceux, filles et garçons, hommes et femmes, pour qui la virginité des filles est un enjeu, cette conviction produit des affects croisés très complexes, tout en creusant démesurément la différence sexuelle : la sacralisation de la virginité des filles renforce le différend des genres en le redoublant d’une zone d’inconnu ou de méconnaissance réciproque vertigineuse.
Or, si le poème de Chénier peut avoir un intérêt pédagogique, c’est peut-être parce qu’il se prête remarquablement au parcours de ce différend. Et c’est ainsi, par hypothèse, qu’il peut devenir littérairement partageable.
Mais n’anticipons pas : je ne me suis rendue sensible à cette dimension du poème que grâce à la suite du dossier : la lettre des agrégatifs (et accessoirement l’article « Voir le viol ») et les débats qui ont eu lieu lors des séminaires de Transitions ou de mes discussions avec certains de ses membres.
La lettre des agrégatifs
Avec la lettre des agrégatifs, quelque chose change d’échelle immédiatement :
Étudiant⋅e⋅s en préparation du concours des agrégations externes de Lettres modernes et classiques, nous sommes nombreux⋅ses à avoir été interpellé⋅e⋅s et dérangé⋅e⋅s par un poème figurant dans le recueil des Poésiesd’André Chénier. En effet, nous nous sommes rendu compte que le poème « L’Oaristys », que nous avions immédiatement identifié comme la représentation d’une scène de viol, était couramment interprété au prisme d’une « convention littéraire » qui évacue cet aspect et, par-là, toute interrogation sur le sujet. Après l’avoir évoqué et commenté en classe, il nous a semblé indispensable de bénéficier d’une clarification concernant ce type de textes mettant en scène des violences sexuelles, notamment dans le cadre de l’exercice de l’explication de texte. Ce questionnement peut également être élargi aux nombreux textes présentant des discours idéologiques oppressifs (racisme, antisémitisme, sexisme, homophobie, etc.) dans le cadre d’une réception contemporaine. C’est pourquoi nous nous tournons vers vous : nous souhaiterions une réponse claire et définitive sur l’attitude à adopter et le vocabulaire à utiliser pour décrire ces textes.
La lettre des agrégatifs ouvre une scène qui, à des fins de « clarification », fins plusieurs fois répétées dans le cours de la lettre[28], se veut elle-même la plus claire possible. Adressée aux deux jurys des agrégations concernées par le poème de Chénier, elle a été signée par 52 agrégatifs dont 22 normaliens (16 de l’ENS de Lyon et 6 de l’ENS de Paris[29]) et « soutenue » en outre par une liste d’autres signataires : 9 enseignants à l’Université dont deux professeurs en titre préparant à l’agrégation pour le programme « Chénier » ; des normaliens, des doctorants, des agrégatifs d’autres disciplines et enfin, d’assez nombreux enseignants du secondaire, agrégés ou non. La lettre veut donc réunir autour d’un « questionnement » portant sur « ce type de textes mettant en scène des violences sexuelles » tous les spécialistes de littérature concernés directement par lui : chercheurs, enseignants et candidats à un concours d’enseignement de littérature. On remarquera au passage que la question fait plus qu’amorcer la réponse, puisqu’elle impose la qualification du poéme de Chénier comme texte mettant en scène une violence sexuelle.
Puisque je suis enseignante-chercheuse, ancienne agrégative moi-même (en 1979-1980), préparant très souvent des étudiants à l’agrégation (j’ai commencé avant même de devenir universitaire, et je l’ai fait presque tous les ans depuis plus de 30 ans), je devrais pouvoir sans peine déterminer ma position, c’est-à-dire d’abord reconnaître la scène.
Or, ce n’est pas le cas. Cette lettre me cause même une certaine stupeur parce que je n’y reconnais rien, ou pas grand chose. Elle fait pourtant appel à des évidences :
Nous avons conscience de la dissociation traditionnellement exigée dans le cadre d’exercices littéraires académiques entre une posture critique vis-à-vis du texte en question et des représentations qui le caractérisent, et une posture de stricte analyse littéraire, qui cherche à éviter tout anachronisme (cet argument a ainsi été avancé lors d’un cours d’agrégation sur Chénier pour refuser le terme « viol »).
Qu’est-ce que c’est donc que cette « dissociation traditionnellement exigée dans le cadre d’exercices littéraires académiques » ? Je ne la connais pas. Qui donc oppose « une posture critique vis-à-vis du texte en question et des représentations qui le caractérisent, et une posture de stricte analyse littéraire, qui cherche à éviter tout anachronisme » ? Certains chercheurs sans doute, mais certainement pas tous ; et même les chercheurs pour qui cette opposition fait sens n’ignorent pas que tout le monde n’est pas d’accord avec eux : la théorie littéraire n’est pas unifiée, elle vit des différents débats qui, comme toute discipline, la renouvellent. Étrange antithèse donc ! Elle semble dater de la querelle « Barthes-Picard[30] ».
Je ne me suis jamais représenté que la préparation à l’agrégation (quand je l’ai passée, quand je fais cours) exigeait de renoncer à « une posture critique vis-à-vis du texte en question et des représentations qui le caractérisent [31] ». Formée au structuralisme, aux divers courants de la Nouvelle Critique, qui tendaient tous, à travers diverses méthodes et divers partis pris théoriques, à repérer l’« impensé » des textes littéraires, je n’ai jamais cru que la « stricte analyse littéraire » cherchait « à éviter tout anachronisme ».
D’abord, parce nommer l’impensé d’un texte implique de mobiliser un lexique largement « anachronique » : pour ne prendre que quelques exemples politiques, puisque c’est dans ce champ de la politique que se situe la lettre des agrégatifs, je pense avoir librement « dénoncé », dès mes années d’étude et sans m’arrêter par la suite, à l’aide d’outils critiques précis (relevé de sentences, repérages de champs sémantiques, de structures actancielles, etc.), l’idéologie misogyne, ou bourgeoise, ou colonialiste, ou la violence de classe, d’un texte ancien ou récent. Pertinents ou non (c’est une autre question), ces syntagmes introduisent bel et bien dans l’analyse littéraire des termes aussi anachronisques que le terme de « viol » pourrait l’être à propos d’un poème de Chénier.
Ensuite, parce qu’autant il est possible (mais non simple) de circonscrire un peu la définition de l’anachronisme en histoire, autant la chose se complique pour la littérature : quel est en effet le régime d’historicité de la littérature, si l’on accorde de l’importance ne serait-ce qu’à son intertextualité ? Si, pour certains chercheurs en littérature, l’anachronisme est un péché majeur, c’est parce qu’ils font de la discipline littéraire une région de l’histoire (« l’histoire littéraire », la « philologie »), parce qu’ils pensent que le sens d’un texte dépend exclusivement de son contexte. Mais encore une fois, cette position fait débat au sein de la discipline[32].
Litige ou différend ?
Le moins qu’on puisse dire est que le dispositif de cette lettre est compliqué. Son destinataire le plus évident est le jury d’agrégation. Mais sa publication sur le blog d’une association féministe de l’ENS de Lyon, « Les Salopettes », en réorganise l’adresse :
Nous partageons sur ce blog une lettre ouverte adressée par des agrégatifs⋅ves de Lettres classiques et des Lettres modernes aux jurys des concours. Nous soutenons cette initiative, qui rejoint les réflexions partagées l’an dernier lors de l’atelier co-organisé par les Salopettes sur l’enseignement des textes représentant des violences sexuelles.
En concentrant l’attention sur l’exemplarité du poème de Chénier, ce préambule fait de lui l’objet d’un enjeu militant au-delà de la question de l’agrégation[33]. De fait, comme je l’ai mentionné, le sonnet XX des Amours de Ronsard sera cité comme exemple du même type, ainsi que La Mère coupable de Beaumarchais[34], sans qu’une attention soit prêtée aux différences non seulement des situations diégétiques, mais encore de leurs énonciations, des genres littéraires auxquels ils appartiennent, de leur valeur, ou de leurs ressources esthétiques. Un paradigme général est institué à partir du concept de « représentation » : « la représentation des violences sexuelles ». L’enjeu moral et politique est précisé par une phrase de la lettre :
L’agrégation est un concours qui recrute des professeur⋅e⋅s pour l’enseignement secondaire. En dehors de la question de l’anachronisme, il nous semble important d’être préparé⋅e⋅s à commenter ce genre de textes devant un public jeune et non averti. Il sera de notre responsabilité, en tant que futur⋅e⋅s professeur⋅e⋅s, de ne pas perpétuer implicitement une culture du viol[35].
Mais pourquoi des jurys d’agrégation se retrouvent-ils destinataires d’une demande de clarification concernant une « responsabilité » pourtant énoncée avec une conviction si certaine de son objet ? On peut supposer que les signataires de la lettre sont tout à fait capables de prendre leurs responsabilités sans l’aide de quiconque. Et ce qui est vrai d’agrégatifs devient criant quand on regarde la liste des co-signataires de la lettre : chercheurs ou enseignants déjà confirmés, et certains même si confirmés qu’ils pourraient tout à fait appartenir à un jury d’agrégation. Ils n’ont donc nul besoin d’être « préparé⋅e⋅s à commenter ce genre de textes devant un public jeune et non averti » (« non averti » de quoi, au reste ? la demande présuppose la clarification qu’elle demande…). Il est donc difficile de ne pas entendre que la lettre constitue une mise en accusation tout autant, sinon plus, qu’une demande de clarification.
L’adresse aux jurys d’agrégation institue en fait une scène de type judiciaire[36]. Certes, une première phrase fait état d’une interprétation courante du poème en termes de « convention littéraire » plutôt que de « représentation d’une scène de viol[37] ». Mais la seconde mentionne que l’objection de l’« anachronisme » a été opposée à certains agrégatifs « lors d’un cours d’agrégation sur Chénier ». Plus loin, il est spécifié que
certainement dans le souci de les préparer au mieux au concours de l’agrégation, plusieurs enseignant⋅e⋅s, à propos de différents textes, ont recommandé aux étudiant⋅e⋅s qui soulevaient la question de ne pas utiliser un terme aussi tranché et fort que « viol » lors de leur explication.
Les agrégatifs demandent donc aux jurys de se prononcer, parce que certains enseignants préparant au concours d’agrégation leur ont opposé l’autorité de ces mêmes jurys pour leur interdire d’interpréter « L’Oaristys » comme la « représentation d’une scène de viol ». Il y a litige.
Litige, ou différend ?
La distinction faite par Jean-François Lyotard se révèle ici très utile. Si le différend provoque un tort, le litige selon Lyotard provoque un simple dommage : « Un dommage résulte d’une injure faite aux règles d’un genre de discours, il est réparable selon ces règles. »
Au premier regard, la lettre se donne pour une plainte, « demande de réparation d’un dommage, adressé à un tiers (le juge) par le plaignant (destinateur[38] ». Il y a litige entre deux parties : d’un côté, les agrégatifs destinateurs de la lettre, qui sont les plaignants ; de l’autre, des enseignants chargés de préparer les agrégatifs au concours de l’agrégation, qui sont donc la partie adverse. « Litige », car les uns et les autres se réfèrent au même genre de discours, qui est celui d’une compétence : l’explication de texte. L’objet du litige est alors le suivant : le plaignant a « identifié » la « représentation d’une scène de viol » dans « L’Oaristys » de Chénier (« représentation » : le terme appartient bien au lexique critique) ; la partie adverse lui a contesté cette identification, et la lui a même interdite, au nom de la « convention littéraire » et de l’« anachronisme ». La partie adverse cause un dommage au plaignant en le privant d’une dénomination à laquelle le plaignant pense avoir droit, dans l’usage d’un méta-langage commun dont il demande que son extension véritable soit reconnue :
Dans quelle mesure l’usage d’un vocabulaire descriptif communément admis aujourd’hui contreviendrait-il à la tenue d’une explication qui replacerait le texte dans son contexte esthétique et idéologique ? En d’autres mots, en quoi parler de « viol » relèverait de l’anachronisme si l’explication en question replace le texte dans son contexte tout en assumant une terminologie et des outils propres à sa réception contemporaine ?
Litige, donc, s’il est vrai qu’un litige se signifie dans un genre de discours unique : le plaignant affirme ici qu’il respecte ses règles en proposant de voir dans « L’Oaristys » la représentation d’une scène de viol.
Mais à la vérité, l’exposé du cas par les agrégatifs est plus compliqué, comme je l’ai déjà suggéré. Reprenons-le à partir d’une petite fiction plaisante que Lyotard donne dans Moralités postmodernes pour définir le différend :
Admettons maintenant que vous commencez à jouer avec des balles de tennis en compagnie de quelqu’un. Vous êtes surpris d’observer qu’il n’a pas l’air de jouer au tennis, comme vous le pensiez, avec ses balles, mais qu’il les traite plutôt comme des pions d’échecs. L’un ou l’autre de vous deux se plaint que « ça n’est pas de jeu ». Il y a différend[39].
Au départ, forte de son expertise dans l’idiome « anlayse littéraire », la partie adverse aurait fait remarquer au plaignant qu’il prétendait jouer au tennis (un texte littéraire : poème, mots, forme, intertextualité, contexte historique…) en se servant de pions d’échec (un récit référentiel actuel dont le référent est « une scène de viol »). La partie adverse a voulu signifier au plaignant que « ça n’était pas de jeu », et que s’il persévérait dans son erreur, il serait exclu de ce jeu en ratant son concours.
Mais le plaignant insiste : « nous sommes nombreux⋅ses à avoir été interpellé⋅e⋅s et dérangé⋅e⋅s par un poème figurant dans le recueil des Poésies d’André Chénier ». « Interpellé⋅e⋅s et dérangé⋅e⋅s ». Sa plainte fait état d’un « sentiment », indice certain d’un différend pour Jean-François Lyotard :
Le différend est l’état instable et l’instant du langage où quelque chose qui doit pouvoir être mis en phrases ne peut pas l’être encore. Cet état comprend le silence qui est une phrase négative, mais il en appelle aussi à des phrases possibles en principe. Ce que l’on nomme ordinairement le sentiment signale cet état. « On ne trouve pas ses mots », etc. Il faut beaucoup chercher pour trouver les nouvelles règles de formation et d’enchaînement de phrases capables d’exprimer le différend que trahit le sentiment, si l’on ne veut pas que ce différend soit aussitôt étouffé en un litige, et que l’alerte donnée par le sentiment ait été inutile. C’est l’enjeu d’une littérature, d’une philosophie, peut-être d’une politique, de témoigner des différends en leur trouvant des idiomes[40].
La plainte des agrégatifs se trouve introduite par la mention d’un trouble, d’une double perturbation née de la lecture du poème et du refus des spécialistes d’y reconnaître la représentation d’un viol. Il ne s’agit plus d’un simple dommage subi par le plaignant, mais d’un véritable tort, conséquence d’un différend : car les balles de tennis et les pièces de jeu d’échec sont irréconciliables, ne peuvent pas appartenir au même jeu de langage (point de vue du plaignant). Il y a deux idiomes : le discours actuel de l’analyse littéraire, lequel induit une violence complice puisque, pour justifier leur rejet du mot « viol », certains enseignants « ont pu alors développer, sans aucun doute par manque d’anticipation de ces interrogations, un argumentaire qui reprenait sans distance des idées reçues sur le viol, particulièrement violentes pour les étudiant⋅e⋅s. » ; et l’idiome politique actuel qui permet de repérer, nommer et dénoncer des « représentation » de « violences sexuelles[41].
Je le dis avec force : ce différend-là m’interpelle, me touche, me concerne. Comment en témoigner, toute la question est là : le mot « viol » (ou « violences sexuelles ») plaqué sur les textes convient-il, témoigne-t-il avec justesse ?
Mon trouble, de fait, rebondit : car à la vérité, litige ou différend, la chose n’est pas si claire, et c’est pourquoi Lyotard est ici si utile. Car pour Lyotard, aucun différend ne peut être traduit sur une scène judiciaire, sauf à être immédiatement trahi, « étouffé » : pour ne pas l’étouffer, il faut lui inventer un idiome. C’est ce que nos saynètes essaient de faire, et Transitions en général. Mais que se passe-t-il ici ?
D’un côté, on l’a vu, le plaignant estime qu’il a subi un dommage et fournit des preuves selon lesquelles repérer une représentation de viol dans un texte n’est pas jouer aux échecs, mais bel et bien jouer excellement au tennis : c’est un litige. Mais de l’autre, il fait état de son émotion, et affirme que les balles de tennis de l’un font tort en quelque sorte aux pions d’échec de l’autre. Si le plaignant, d’un côté, concède son idiome à la partie adverse, de l’autre, il demande que cet idiome tolère désormais la co-présence d’un deuxième idiome, un idiome fondé sur la réception actuelle et la transmission des textes littéraires, de façon à accueillir un jugement « critique » (politique) portant sur ce dont ces textes littéraires nous parlent aujourd’hui. Le poème de Chénier représente ce qu’on appelle aujourd’hui un « viol ». Amputé de cette possibilité de le dire, l’idiome de la partie adverse constituerait donc un tort en interdisant cette perspective politique.
Or dans ce passage du dommage au tort, du litige au différend, il est évident que l’objet du conflit a bougé.
D’une part, en demandant une « clarification », le plaignant transfère à un tiers une autorité bien étrange : celle d’arrêter le sens d’un texte littéraire, de déterminer ce qu’on est autorisé à en dire et à ne pas en dire. Et dans la mesure où le plaignant espère que ce tiers autorisé lui donnera raison, ceci signifie qu’après avoir témoigné que le litige auquel la partie adverse voulait réduire le conflit était en fait un différend, il retraduit le différend, dont il cherchait à témoigner, en un nouveau litige, dont il exige le règlement. Il considère donc que la pratique du commentaire littéraire peut toujours faire l’objet de litiges, tous susceptibles de trouver une solution tranchée et définitive. Pire : il déclare les jurys des concours d’agrégation de lettres modernes et de lettres classiques gardiens légitimes de cet idiome autorisé. Il enrôle la littérature pour la mettre au service de la conversion d’un différend (politique) en litige littéraire (il faut statuer sur un texte). Si l’on suit Lyotard cependant (on verra jusqu’où il convient de le suivre), la littérature est au contraire ce qui a pour rôle de témoigner du différend sans jamais l’étouffer en litige. Ou même surtout pour ne pas l’étouffer en litige.
La lettre fait donc tort à la recherche littéraire elle-même, sinon à la littérature[42]. Outre qu’on n’aura pas entendu la partie adverse, dont la liberté académique est, il convient de le souligner fermement, menacée par la conversion du différend en litige et l’appel à l’autorité d’un jury pour le trancher, outre que cette lettre dessine une responsabilité militante étrange dont l’exercice semble dépendre d’une autorisation institutionnelle, la lettre fait tort plus particulièrement à tous les chercheurs qui ne peuvent se reconnaître dans aucun des idiomes présentés.
Pour ce qui me concerne (et c’est en quoi je partage sans réserve la position de Brice Tabeling), je ne crois pas qu’on puisse prononcer un arrêt portant sur le sens d’un texte littéraire, sauf à trahir la finalité de la littérature et des études littéraires (ou ce qui fait sens pour moi dans les études littéraires). Certes, on peut aborder un texte dans une perspective philologique, c’est-à-dire à partir de l’établissement du sens historique des signes linguistiques ; cette opération est d’une extrême importance et valeur à mes yeux puisque il est bien vrai que diachronie et synchronie désajustent le sens et qu’il est toujours positif d’apprendre à saisir des écarts, à essayer d’entrer en contact avec l’altérité : un autre état de la langue, une autre langue, une autre culture, un autre temps. Je n’en suis pas moins fermement convaincue que la philologie n’a le dernier mot que de façon relative, pour autant que le langage n’est pas un. Le langage est traversé d’équivocités qui ne sont pas qu’accidentelles (dues à l’éloignement d’un texte dans le temps ou dans l’espace social, culturel, géographique) : elles sont au contraire consubstantielles à la parole humaine (le lapsus ou le malentendu illustrant ceci de façon spectaculaire).
Nous disposons de plusieurs cadres théoriques pour décrire ce drame, ces disjonctions. La théorie du différend en offre un. Car pour Lyotard, les différends hantent le langage lui-même, notamment en raison d’une sorte de différend originaire existant entre la phrase articulée et ce qu’il appelle la phrase-affect[43] : voix, ou phoné de l’enfant qui, n’ayant pas encore le langage, se trouve cependant environné du bruit d’un logos encore incompréhensible pour lui. Ce différend originaire est une énigme qui marque définitivement quoique silencieusement le logos lui-même. On peut soupçonner qu’il peut couvrir un spectre très large, de l’extase à la terreur, selon les enfances, ou selon les moments d’une même enfance et les traces qui en restent ; que les textes littéraires, pour ne parler que d’eux, en investissent certaines traces et pas d’autres selon les genres auxquels ils appartiennent, selon les scénarios qu’ils investissent, selon les styles qu’ils mobilisent, etc ; enfin, que les « beaux textes » sont ceux qui réussissent cet investissement (ce témoignage) avec le maximum d’intensité tout en conjurant le risque de disruption pure et simple entre ces deux bords. Tout l’enjeu de la recherche autour de la transitionnalité se joue là.
Cependant, j’ai dit plus haut que pour moi « L’Oaristys » était un texte médiocre auquel je ne donnais pas mon assentiment. Vais-je me dédire ?
Pas exactement. Au long de ce trajet, « L’Oaristys » a changé de nature. J’ai déjà avancé l’idée que, dans la perspective de son partage, par exemple avec une classe, il permettait de parcourir un différend. À présent, il se présente accompagné d’un commentaire qui n’est pas le mien : il n’est plus seulement l’objet d’une lecture privée et d’une réflexion personnelle. La question « qu’en dire ? » que je me posais avant que je ne relise la lettre des agrégatifs a trouvé une réponse tranchée dans leur proposition d’y reconnaître, sous la forme d’une évidence, la représentation d’une scène de viol.
Alors qu'en dire ?
Encore « L’Oaristys » : ou comment ne pas étouffer le différend
Reprenons une fois encore la lecture de « L’Oaristys ».
Première lecture : premier différend
Le poème est un dialogue entre Naïs et Daphnis. Il n’a rien d’un dialogue théâtral malgré la tentation que l’on pourrait avoir d’interpréter certaines répliques comme des sortes de disdascalies internes : « D. : Berger comme Pâris, j’embrasse mon Hélène. […] N. : Tiens, ma bouche essuyée en a perdu la trace. » Certes, par la fiction de simples mots échangés en discours direct, le texte fait surgir des corps. Mais ils se déplacent dans le temps comme dans l’espace de façon très peu vraisemblable : contrairement à une scène théâtrale, les mouvements et les gestes, y compris l’acte sexuel final, sont impossibles à effectuer dans le temps réel des vers prononcés. Le poème n’a décidément pas de valeur mimétique, ce qui rend bien problématique ou obscur l’usage du terme « représentation » dans le syntagme « représentation d’une scène de viol ».
Le dialogue n’en réussit pas moins à nous faire entendre[44], à un rythme étourdissant, non seulement la demande érotique pressante de Daphnis invitant Naïs à faire l’amour avec lui et à l’épouser, mais encore l’accomplissement ou la consommation de l’acte sexuel, prélude à un mariage imminent. Il nous montre ainsi la transformation accélérée de la relation, sur fond d’une évidente dissymétrie. Car c’est le jeune homme qui conduit le rythme, c’est lui qui attire, qui entraîne, qui sé-duit ; lui qui entreprend et conclut. Ce sont sa voix et son corps qui communiquent son désir à la jeune fille, la captivent, la capturent : sa voix, car il la persuade ; son corps, car il la prend. Pas une seule fois la jeune bergère ne dit « oui ». Il est même tout à fait évident qu’elle dit plutôt « non », et que le jeune homme n’en a cure : c’est bien lui qui veut, et passe à l’acte.
« Plutôt “non” », comme je l’écris dans ma saynète, et comme je le réécris ici malgré les objections de l’article « Voir le viol » auquel je vais venir bientôt[45]. Je sais lire bien sûr, je sais entendre que Naïs dit « non » deux fois, et qu’elle ordonne plusieurs fois à Daphnis de ne pas faire le geste qu’il est en train de faire, dont celui, violent, de « déchire[r] [s]on voile ».
Mais il me paraît impossible de lire ces refus de Naïs comme des refus répétés à l’identique. Et c’est pourquoi mon expression « plutôt non » n’est pas une « concession[46] » : puisque le « non » de Naïs évolue, il est permis d’hésiter pour le caractériser. La modalité « plutôt » traduit mon hésitation ou ma perplexité, sentiments que les signataires de la lettre ne connaissent manifestement pas (pas plus que les auteurs de « Voir le viol »).
En effet, les refus de Naïs n’interrompent pas le dialogue. Si l’on accepte de saisir le texte dans son déroulement syntagmatique, on voit que Naïs s’informe sur la famille du berger et sur ses biens, car elle s’inquiète de l’assentiment de son père : après l’avoir écartée, elle accepte d’envisager l’hypothèse du mariage : les refus formulés à cet égard sont donc levés. C’est encore la figure du père qui justifie son refus de se coucher sur l’herbe avec Daphnis : « Non ; arrête… Vois, cet humide gazon / Va souiller ma tunique, et je serais perdue. / Mon père le verrait. » De même, c’est moins Daphnis qu’elle repousse que l’amour, comme elle l’explique : « D. : Quoi ! tu veux fuir l’Amour ! l’Amour à qui jamais / Le cœur d’une beauté ne pourra se soustraire ? / N. : Oui, je veux le braver… ».
Naïs nous est montrée occupée par un conflit qui oppose Diane et son père d’un côté, Vénus et son prétendant de l’autre. Inlassablement réécrite dans la littérature ancienne, cette configuration met en scène une sorte de lutte entre la jeunesse et la vieillesse, le changement et l’ordre, l’insubordination du désir et l’obéissance. Convention littéraire ? Oui. Mais elle est vitale : le mot « convention » n’a ici d’intérêt que de permettre de souligner, une fois encore, que le poème n’attache aucune vraisemblance réaliste aux personnages. Il les charge plutôt de figurer ce que le texte donne comme une vérité vivante, joyeuse, à défendre. Et voici un premier différend dont le poème témoigne ainsi, le différend en quelque sorte anthropologique entre les intérêts de la vieillesse (privilégier la logique des alliances, garder la jeunesse pour soi, en bâton de vieillesse, garder la société dans l’état où la vieillesse l’a toujours connue – immobilisme que Naïs figure quand elle exprime son angoisse face au devenir), et les intérêts rebelles de la jeunesse, au service du mouvement, de la génération et de la vie.
De fait, Naïs va suivre Daphnis alors même que sa parole montre qu’elle comprend tout à fait l’enjeu de sa demande érotique pressante : contrairement aux jeunes filles du romantisme ou de la littérature réaliste du XIXe siècle, elle ne confond pas Vénus et Diane, elle sait que Daphnis l’appelle à renoncer à Diane pour suivre Vénus, elle sait que l’union des corps fait venir des enfants et redoute autant le statut de femme mariée que l’accouchement. Dans le dialogue délibératif, Naïs ne se contente pas de refuser : elle argumente contre Daphnis. Au cours de la discussion, elle change progressivement de position ; et le dénouement s’avance à travers la dispute, Naïs se rendant aux arguments de Daphnis. Les « preuves » de ce dernier sont les plus fortes : preuves dans la techné, elles-mêmes de deux sortes : pathos (Daphnis déclare son amour), et logos (Daphnis fait valoir non seulement son nom et ses biens, mais aussi les joies du mariage) ; et preuves hors de la techné (érotisme persuasif, passage à l’acte).
Cette lecture (car c’est évidemment une lecture) peut s’étayer de plusieurs manières. J’en ai fourni les linéaments. L’une d’elles s’appuierait sur une contextualisation qui insisterait sur l’ordre patriarcal faisant dépendre les jeunes gens des pères. L’autre pourrait mobiliser le schéma actanciel, le complexe d’Œdipe et la topique freudienne ; et placer Amour en destinateur, le père en opposant oedipien et Diane-et-le-père en opposant « Sur-moi », Vénus-et-Daphnis-amant en adjuvant « Ça », et Naïs et Daphnis, tour à tour sujet et objet, en « Moi », tout ceci avec le Mariage (richesse, enfants) en destinataire[47].
Deuxième lecture, ou le deuxième différend menacé d’être étouffé
Mais cette première lecture a un défaut majeur. Quoique elle mette en valeur un différend dont témoignerait le poème, elle passe sous silence celui qui se figure dans le rapport entre Daphnis et Naïs, différend dont le « tremblement » est le signe en son équivocité même : « Eh ! devant qui ton sexe est-il fait pour trembler ? », objecte Daphnis, réunissant sous un même tremblement la soumission sociale au mari et la soumission au désir érotique. La convention littéraire a beau jeu de célébrer la victoire de la jeunesse sur la vieillesse : elle n’en fixe pas moins, comme une autre « vérité », l’inégalité de genre entre l’amant et l’amante, la dépendance de la femme qui passe de l’obéissance au père à l’obéissance du mari. Passivité et activité sont, dans le dialogue de Naïs et de Daphnis, bien inégalement distribuées (c’est le moins qu’on puisse dire) ; et le beau rôle (la belle figure, la parole efficace) revient à Daphnis, je l’ai déjà souligné dès ma première lecture. Ici se loge ce qu’à ma génération on dénonçait comme le pallologocentrisme. Ma première lecture l’ignore et unifie le texte : elle produit un récit lisse, faisant du mariage le dénouement quasi dialectique d’une progression dramatique qui passerait par un nécessaire moment négatif (la résistance de Naïs). Fin morale « bourgeoise » : Daphnis convainc Naïs, érotiquement et socialement. Désir, mariage, enfants.
Mais il y a un reste : que faire du courroux de Diane ? Naïs, que Diane « favorise » au début du poème, est-elle encore « chère à la déesse » au dénouement ? Daphnis l’affirme par anticipation[48], mais les dernières répliques des deux amants jettent le doute sur cette protection continuée[49]. Naïs est coupable devant la déesse, laquelle figurait aussi une forme d’indépendance, donc de liberté. Ne faut-il pas alors donner tout son poids au forçage de Naïs, que sa défloration par Daphnis place devant la nécessité de l’épouser ?
Cette autre lecture fait ainsi droit à une rupture dans la linéarité fluide du déroulement syntagmatique. On peut la défendre en termes lyotardiens. Elle se concentre sur le « non » de Naïs. Elle entend le « sentiment » exprimé par la bergère, l’expression de sa détresse, son tremblement, que ce soit un tremblement de désir ou non, comme les signaux du tort. Cette lecture repère ainsi dans le poème un dispositif textuel chargé d’étouffer ce second différend en litige, c’est-à-dire chargé de le traduire dans l’idiome social du mariage, le dispositif de sexualité de la conjugalité hétérosexuelle moderne, dirait Foucault. Et c’est l’idiome de Daphnis. Il convainc peut-être Naïs (mais il est légitime d’en douter) : mais quoi qu’il en soit, il y a un reste, audible à travers le nom de Diane dont rien ne dit que sa colère sera apaisée : c’est le tort fait au « non » de Naïs.
Ce tort, certains aujourd’hui l’appellent « viol », inventant un idiome actuel pour témoigner de ce différend, en grand danger d’être étouffé par le poème. L’hypothèse est ici que sans ce mot « militant », ce différend, ce tort, seraient étouffés définitivement.
Troisième lecture, qui n’est en rien une solution ni une synthèse des deux précédentes
C’est ici que, personnellement, ma pensée se bloque et mon « sentiment » proteste. Et il ne proteste pas que pour Daphnis, mais aussi pour Naïs, pour les lectrices, à qui cette lecture veut certes fournir un idiome, mais un idiome qui, en hyperbolisant le différend, fige aussi, en Naïs, la négation : qu’elle suive Daphnis devient un signe de soumission ou de manipulation, pas l’éveil d’une décision. Cette lecture fait de Naïs une pure victime, la victime d’un crime, rien moins. Elle décide que Naïs est une jeune fille violée, et Daphnis un violeur : les voilà radicalement disjoints. Naïs perd toute la consistance réflexive qui la fait dialoguer avec Daphnis et progressivement s’engager ; et Daphnis, toute l’ardeur qui lui fait déclarer à Naïs son amour, son désir et sa promesse de l’épouser, l’ardeur qui traduit sa volonté de placer leur union sous le signe de Vénus plutôt que de l’institution conjugale. Cette lecture nous rend sourds à l’énigme du trouble qui surgit quand être deux signifie cesser de s’appartenir en propre. Elle réduit ainsi à néant ce qui, au travers de ce dialogue poétique non vraisemblable, se joue entre.
Car le poème me donne autre chose à entendre que les deux différends précédents, cet autre chose qui fait trembler l’air entre les deux amants :
Naïs
Dieux ! quel est ton dessein ? Tu m’ôtes ma ceinture.
Daphnis
C’est un don pour Vénus ; vois, son astre nous luit.
Naïs
Attends… si quelqu’un vient. Ah ! dieux ! j’entends du bruit.
Daphnis
C’est ce bois qui de joie et s’agite et murmure.
Ce vers, C’est ce bois qui de joie et s’agite et murmure, concentre une dimension du texte, une dimension pour moi vraiment amoureuse, qui surgit de sa mélodie – pas de sa signification, pas de son sémantisme général, pas de son enchaînement dramatique, pas de l’allégation de l’autorité de Vénus, mais de moments où son rythme, en se faisant vif et caressant, quitte l’horizon didactique où Vénus est un argument pour la rendre textuellement présente. Dans le poème court parfois un frémissement joyeux extraordinairement juvénile. Un certain vertige érotique y circule, une sorte d’allégresse plutôt délicate, auxquels je ne peux pas accrocher le mot « viol », tout simplement parce que la voix présente dans l’écriture ne fait pas violence à l’altérité, mais en accueille le trouble.
Derrière le litige des arguments, derrière le différend des idiomes « Diane » vs « Vénus », la phrase-affect se fait entendre, aussi timidement que ce soit. C’est ce bois qui de joie et s’agite et murmure : phrase un peu égarée, sans lien très certain avec le plan dialectique du mariage, mais qui proteste contre l’idiome « viol ». Elle fait entendre le différend de la différence des sexes, qui est aussi le différend intime de chacun : et Gérald Sfez évoque, en une formule troublante pour ce qui nous occupe, la nécessité, pour que le différend de la différence des sexes soit heureux, de « mon consentement à cette passibilité d’avant » (à ce différend originaire et intime entre phoné et logos[50]).
La protestation de mon sentiment contre le mot « viol » en tant que dernier mot sur « L’Oaristys » n’annule pas ma seconde lecture : oui, il y a bien un tort fait à Naïs. Je remarque seulement que le poème ne l’écrase pas totalement. Il présente les deux idiomes, « Diane » et « Vénus », et les présente comme deux idiomes inconvertibles en un seul genre de discours : le poème n’élimine pas les traces de l’absence de solution malgré l’approbation générale du résultat. Le poème montre qu’il y a un reste.
Ma protestation se contente de faire naître une troisième lecture, au nom d’un vers, un seul vers, que j’aime vraiment, et qui m’invite à écouter dans le poème la phrase-affect, c’est-à-dire le différend entre logos et phoné, signifié et signifiant, « homme » et « femme » (sans que ces termes forment paradigmes). Et c’est pourquoi je ne vois pas le viol : parce qu’avec son absence explicite de vraisemblance mimétique, la scène, qui ne peint rien, qui ne demande pas mon assentiment réaliste, a une dimension onirique[51]. Comme toutes les pastorales ou toutes les idylles, « L’Oaristys » est explicitement une fantaisie : pas très fantaisiste, certes ; pas très réussie ; fortement genrée, oui ; ouvrant du coup, pour certains lecteurs, sur un possible cauchemar, une vision traumatique, oui encore[52]. Mais cette dimension onirique, aussi fragile qu’elle se présente, sans cesse submergée par les sentences, par la banalité du dénouement conjugal, par la dissymétrie misogyne qui écrase le dialogue, par la violence du tort fait à Naïs, me laisse tout de même libre d’engager de la rêverie – c’est-à-dire, d’en déplacer les significations, puisqu’aussi bien, la « lettre » du poème est explicitement doublée de sens figurés, d’équivoques, de symboles. Bref, l’onirisme du poème me laisse libre de transposer.
Cependant, « L’Oaristys » n’est pas un texte qui m’a saisie immédiatement par cette disponibilité, laquelle m’avait été au contraire inaudible à ma première lecture. C’est paradoxalement le point de vue critique résumé dans le syntagme « représentation d’une scène de viol » qui, en provoquant mon émotion, m’a conduite à écouter ce différend typiquement littéraire pour lequel le poème témoigne, même faiblement. La lecture de « Voir le viol » me conforte dans ce sentiment.
« Voir le viol. Retour sur un poème de Chénier » : ou l’augmentation du différend
Écrit par sept des signataires de la lettre des agrégatifs[53], l’article « Voir le viol » réagit à ma saynète, je l’ai dit. Il dessine en creux quelque chose comme mon portrait : pas très rigoureuse, voire pas rigoureuse du tout ; pas très honnête, voire pas honnête du tout ; et pas très féministe, voire pas féministe du tout.
Pas très rigoureuse :
En revanche, nous reconnaissons avoir du mal à comprendre précisément cette argumentation, notamment en raison de la position ambiguë de son autrice (simple lectrice ou autorité institutionnelle ?), de la complexité et de l’ampleur de la réflexion théorique dans laquelle elle se situe (l’ajustement des « boussoles » dans la réception, la réflexion sur le partage) attachée à des notions qui lui sont propres et dont nous n’avons qu’une connaissance partielle sans pouvoir aisément nous y situer, et des procédés rhétoriques de ce texte qui prêtent à ses contradicteurs⋅rices des objections parfois obscures (« Mais […] le consentement, c’est le grand alibi des violeurs, vous ne l’ignorez pas ! »).
Obscurité[54], « position ambiguë », « notions qui me sont propres », « procédés rhétoriques » : face à ces défauts majeurs, les auteurs de l’article m’opposent sans cesse la « précision » de leur description (« Il s’agit de décrire avec précision ce qui y est raconté. De poser un mot sur une réalité ») et exigent de moi « un minimum de réflexivité[55]».
Pas très honnête : les notions de partage et de transitionnalité que, dit l’article, j’avance pour justifier ma position « semblent ici fonctionner en dernière instance au détriment de la lettre du texte, voire d’une honnêteté de lecture (lire les refus de Naïs et les gestes de Daphnis)[56] ».
Pas très féministe enfin : les auteurs de « Voir le viol » précisent leur position en insistant beaucoup sur leur « savoir » militant qui leur permet de reconnaître le viol de Naïs « depuis une position féministe, informée et sensibilisée à la question des violences sexuelles et de la culture du viol » :
[L]e viol répond à une définition bien précise, sur laquelle nous reviendrons, et mobilise des savoirs spécifiques tout aussi importants que nos compétences littéraires. […] [C]ette question, notamment lorsqu’elle s’est posée dans la lettre ouverte, ne s’inscrit pas simplement dans l’actualité que veulent bien relayer les médias mais dans la continuité d’une réflexion ancienne et ininterrompue dans la sphère féministe.
« Bref, compliqué » écrit Hélène Merlin-Kajman en guise d’introduction, faisant allusion à ce contexte et au problème soulevé dans le cadre de l’agrégation. Mais il n’est pourtant pas compliqué d’identifier un viol si l’on a un regard informé sur la question.
Mais, manifestement, mon féminisme défaillant me laisse une chance pour me rattraper : sans doute étais-je insuffisamment sensibilisée à ces problèmes, sans doute manquais-je simplement de ce savoir militant pour dissiper mes réticences à reconnaître dans la scène de « L’Oaristys » la représentation d’un viol. Désormais, ce n’est plus le cas. Il ne me reste plus qu’à céder ; si je ne le fais pas, il me faudra avouer que je suis malhonnête.
Eh bien, non.
Non, je ne vois pas le viol, comme je viens de m’en expliquer. Les auteurs de « Voir le viol » ont une étrange façon de chercher à convaincre, ou plutôt de vouloir acculer à l’aveu du viol : étrange recours à « ce rituel de discours », dont Foucault a montré l’importance dans l’ordre du discours occidental précisément à propos de la sexualité ; étrange insistance venant de la part de féministes, et sur ce thème-là du viol.
Il est bien vrai que ce mot me cause une sorte de déplaisir. Mais, contrairement à ce que laisse entendre « Voir le viol » quand les auteurs s’interrogent sur une « question passionnante » (« pourquoi ce terme [de viol] met […] l’autrice mal à l’aise alors qu’il désigne très exactement ce dont il est question dans le texte »), mon déplaisir n’est pas un malaise, mais le signal d’un différend, qui éclate dans la phrase que je viens de citer. Car ce terme ne « désigne très exactement ce dont il est question dans le texte » que pour les auteurs de « Voir le viol » (et pour d’autres lecteurs, je ne l’ignore pas) : pas pour moi. Je n’ai pas consenti, je continue à ne pas consentir, à ne rien reconnaître ni avouer. Je récuse donc la corrélation établie entre mon déplaisir et la désignation exacte que réclament les auteurs de « Voir le viol ». La question « passionante » ne risque pas de me passionner : elle fait violence à mon idiome en le traduisant de force dans l’idiome essentiellement « juridico-judiciaire[57] » de « Voir le viol ». Ce n’est pas celui que je retiens pour commenter un texte littéraire, ce n’est pas non plus celui que je retiens pour me conduire ordinairement dans la vie (j’y viens bientôt). D’où mon « sentiment ».
Je ne peux évidemment pas démontrer que mon sentiment n’est pas un haut-le cœur devant la vérité du mot « viol » et devant la révélation de la vérité de mon plaisir. Un sentiment ne se démontre pas, il cherche un idiome. C’est ce que ma saynète essayait de faire. C’est ce que je continue ici.
Mais que les auteurs de « Voir le viol » fassent ainsi appel répétitivement à mon honnêteté n’est peut-être au fond que leur manière à eux de se défendre de notre différend, tout en mesurant son ampleur (et son inconfort). Cet aspect-là de l’article ne nous fait pourtant pas beaucoup progresser. En revanche, je voudrais saisir la chance que me fournissent certaines de leurs assertions pour mener plus loin ma réflexion (c’est-à-dire pour phraser encore le différend et mieux le comprendre).
Et de ceci, je les remercie très sincèrement.
Quelques réflexions adjacentes
Sur le viol et le « quasi viol »
Les auteurs de l’article contestent l’expression de « quasi viol » que j’ai avancée dans ma saynète au nom d’une « définition minimale » du viol (« un viol est un acte sexuel non-consenti[58] ») qui leur permet d’affirmer que Naïs est effectivement violée dans le poème de Chénier. De là, ils avancent que toute autre interprétation « met en cause soit cette première lecture très littérale, soit la définition extra-littéraire du viol ». Et comme il leur semble impossible qu’on puisse contester « cette première lecture très littérale », il concluent « que l’enjeu soulevé par cette Saynète est bien la possibilité ou non de négocier ou de remettre en cause cette définition extra-littéraire du viol dans notre lecture » :
le problème est qu’en réalité, Hélène Merlin-Kajman défend une autre définition du viol et refuse de lire les refus et la résistance de Naïs comme des éléments qui viennent caractériser de manière définitive un viol. Et d’autres conceptions du viol existent en effet […]
« D’autres », « en effet ». Elles ne seront pourtant pas présentées. Il ne s’agira pas de les discuter, mais de les évoquer ici pour jeter un discrédit implicite sur elles. Le mot « viol » n’a qu’une définition légitime possible : celle que donnent les auteurs de « Voir le viol ».
En évoquant un « quasi viol », je n’ai pas éprouvé le besoin de définir le mot « viol ». Cette expression est prise dans le mouvement dialogique de ma saynète :
Alors, je préfère une autre formulation, qui resterait comme une objection importante faite au texte, pas comme sa vérité définitive, pas comme une interdiction : « ce dialogue ne représente-t-il pas une scène de séduction qui n’est pas sans violence du côté du berger, et même, n’est-on pas en droit de se demander s’il ne s’agit pas, en un certain sens, d’un quasi viol ? ».
On remarquera que j’ai, volontairement, multiplier les modalisations (ce que souligne ironiquement mon contradicteur fictif : « Pourquoi avez-vous peur de trancher, de vous engager ? »). Que signifient-elles ?
Le mot « viol » comprend pour moi une évidence, que je formulerais à partir de la définition avancée par les auteurs de « Voir le viol » : « un viol est un acte sexuel non-consenti ». Qu’il soit non consenti signifie à mes yeux que le sujet du non-consentement a été contraint de l’accomplir, c’est-à-dire placé dans une situation où il ne pouvait pleinement exercer sa qualité de « sujet ». D’où l’évidence dont il s’entoure pour moi, une évidence qui coïncide avec la façon dont je me vis comme sujet, sujet d’un consentement.
De cette évidence du viol, je fais l’épreuve a contrario. Si une amie avec qui je dois passer la soirée veut aller au théâtre alors que je désire aller au restaurant, si elle insiste, si je finis par céder (soit que je dise « d’accord », soit que je me laisse entraîner quand elle me saisit par le bras en brandissant deux places de théâtre), j’ai consenti. Cela signifie que j’ai placé quelque chose au-dessus de mon premier désir d’aller au restaurant (par exemple, le plaisir d’être avec elle, car sinon, elle rentrait chez elle ; ou bien le plaisir de lui faire plaisir) ou que l’intensité de son désir de théâtre m’a gagnée et m’a finalement communiqué le même désir qu’elle d’aller au théâtre. Bref, que la nature de notre lien a déterminé les remous au travers desquels s’est acheminée notre décision, et notre action.
Tout le monde connaît ce type de situations. Sauf ceux qui gagnent toujours (s’ils existent) ? Mais faut-il le leur imputer ? C’est une énorme question, qui touche aux difficultés à définir le sujet dès qu’on sort de sa zone de définition juridique. Le droit repose sur des fictions : la « personne » en est une ; le sujet juridique aussi. D’où la possibilité de débattre, juridiquement parlant, d’un « droit de ne pas naître[59] » : des sujets ont pu avancer un non consentement a posteriori à naître dans un état de handicap indésirable. Pour ceux qui sont contre l’avortement, il faut affirmer que le fœtus est déjà une personne, etc. Ce sont des fictions très sophistiquées (même si on ne s’en rend pas compte au quotidien des petits délits ou face à l’évidence des très grands crimes) et de la plus haute importance historiquement parlant, dont je soutiens la pertinence. Mais ce sont des fictions quand même.
Comme sujet de consentement, et sans que le droit et mon sentiment soient ici en désaccord, je sais ce qu’est un viol, je le sais intimement : je sais que c’est être forcée par une personne qui n’est pas moi (et non pas forcée par une force interne, laquelle peut être tout à fait indésirable et me conduire à vouloir ce que « je » ne veux pas, à consentir à ce à quoi, la minute d’avant, je ne consentais pas – désaccord intime pénible dont le signe serait, par exemple, ma colère, le lendemain de ma soirée au théâtre avec mon amie, de ne pas avoir réussi à l’entraîner au restaurant). Un viol est l’acte sexuel auquel un sujet analogue à moi a été soumis de force, soit malgré son refus explicite, soit parce que son état – évanouissement, coma … – ne lui permettait pas d’opposer quoi que ce soit à cette violence : c’est la raison pour laquelle les enfants sont toujours réputés non consentants dans une relation sexuelle avec un sujet majeur sexuellement, parce qu’ils sont supposés être dans l’incapacité morale et physiologique de consentir à l’acte sexuel en question.
Je ne considère pas les propositions que je viens d’avancer comme des vérités scientifiquement vérifiables : au reste, puisqu’il est question de consentement, c’est la subjectivité du sujet qui est engagée, non un objet. C’est pourquoi je choisis de parler à la première personne du singulier. Ces propositions sont ce qu’à propos du mot « viol » le langage me donne comme expérience, faite en personne ou reçue d’autrui, peu importe. Elle me suffisent pour affirmer sans hésiter que grâce au savoir qu’elles me donnent, grâce à la connaissance où je suis que le viol est puni par la loi, je saurais aussi quand, pourquoi, porter plainte pour viol contre « mon » violeur ou « mes » violeurs : j’aurais reconnu l’évidence de la violence subie. Je pourrais aussi conseiller une amie ou un ami qui me raconterait avoir été violé(e) à partir du même sentiment d’évidence. Enfin, je reconnaîtrais sans hésitation un viol dans une scène à laquelle j’assisterais et où je verrais et entendrais, de l’extérieur, des signes manifestes, non équivoques, de violence sexuelle d’un individu sur un autre, corroborés par des signes manifestes, non équivoques, de terreur et de refus de la personne que, de ce fait, je n’aurais aucune hésitation à appeler une victime[60].
D’où ma préférence pour la formule « quasi viol », surgie dans un dialogue avec des interlocuteurs qui se demandent si les gestes de Daphnis, les refus de Naïs, permettent de conclure « c’est un viol ». Réticence autant que concession, manière d’entériner le tort fait à Naïs, ma formule où le « quasi » vaut comme un « dialogue cristallisé[61] » maintient le viol à l’état de présomption. Ma formule accueille la question, elle fait réagir et parler, elle refuse de trancher, en effet : elle la maintient à l’état de question.
Dans son article, Brice Tabeling dit ses réserves à l’égard du terme de « quasi-viol », qui lui « semble suggérer l’existence d’un entre-deux, une manière de scène intermédiaire entre le socio-politique et le littéraire (dont relèverait le « quasi-viol »). Il veut au contraire « conserver côte à côte les deux formulations contraires “ceci est un viol” et “ceci n’est pas un viol”, le caractère insoluble de l’hésitation, son aporie, [lui] paraissant essentiels pour qualifier la “littérature”, textes et commentaires mêlés. »
Mais, même si on maintient une hésitation et son « caractère insoluble », les deux formulations n’en acceptent pas moins toutes deux qu’il y ait litige sur la question de savoir si, oui ou non, « viol » il y a : elles acceptent l’introduction de ce terme, l’alternative binaire, en demandant seulement qu’elle ne soit pas tranchée. Pas moi : ce litige cache selon moi un différend, et même plus d’un différend, comme j’ai essayé de le montrer[62] ; il empêche même de les entendre.
Prise dans une lecture dialogique, mon expression « quasi viol » accueille le sentiment de mon interlocuteur (qui est aussi un objecteur interne) mais prêche pour la disponibilité du texte à une lecture qui ne s’obnubilerait pas de ce terme, « viol » (avec « quasi », on est bien obligé de s’en encombrer un peu, du reste, il a été lancé dans la discussion, et il signale un embarras légitime, un tort. Mais on peut le garder en mémoire et continuer sans l’effacer : « quasi ») ; et pour une prudence qui n’est pas seulement une prudence littéraire, comme je vais le montrer dans un instant.
Oui, il y a pour moi « une manière de scène intermédiaire entre le socio-politique et le littéraire (dont relèverait le « quasi-viol ») » : ou plus exactement, il me semble impossible de maintenir le littéraire dans une totale séparation d’avec le socio-politique. Ou pour le dire encore autrement : pour que la littérature produise ses effets sur ce que Winnicott appelle « l’aire intermédiaire d’existence » ou « aire transitionnelle », il me paraît important de reconnaître qu’elle se joint à l’extériorité du monde, à sa réalité. Mais comment ? C’est l’enjeu du débat.
Et il est complexe (comme Brice Tabeling le souligne en passant par le détour de la question du méta-langage). Car il ne suffit pas d’avoir une définition d’un mot pour savoir comment l’attribuer à un référent.
En disant cela, je ne veux certes pas conclure que tout n’est que représentation. Je veux souligner que les procédures d’attribution d’un mot à un référent, les procédures de subsomption d’un morceau de réalité sous un mot, sont variables : les unes sont habituelles et sereines, « mettre des verres sur la table » par exemple ; les autres dépendent de déclarations, d’institutions, de politique (qu’on place la politique sous le signe de la mésentente ou du différend), etc.
Revenons alors à l’alternative suggérée par les auteurs de « Voir le viol » lorsqu’ils condamnent ma volonté d’ouvrir l’interprétation du poème de Chénier : « cela met en cause soit cette première lecture très littérale, soit la définition extra-littéraire du viol ». J’ai des doutes sur la pertinence de l’alternative, car l’assurance concernant « la définition extra-littéraire du viol » me paraît de même nature que l’assurance concernant la possibilité « d’une lecture très littérale » du poème. Être en désaccord avec la façon qu’ont les auteurs de « Voir le viol » de commenter un texte littéraire et être en désaccord avec leur façon de croire qu’il est facile et même évident de raccorder un objet du monde extra-littéraire au mot « viol », une fois qu’on tient sa définition, n’est en réalité, selon moi, qu’un seul et même désaccord.
Je l’ai dit, la lecture « très littérale » du poème conduit en principe à l’impossibilité de lui assigner un sens référentiel très sûr : ce qui, pour de nombreux critiques, est vrai en général de la littérature l’est particulièrement ici. À l’instar d’un positivisme que les théories de la littérature, et bien des historiens, récusent pour des raisons épistémologiques, les auteurs de « Voir le viol » mobilisent une définition implicite de la littérature très spéciale : le poème de Chénier est lu par leurs soins comme une pièce à conviction, un texte qui pourrait documenter un fait réel[63].
Eh bien, soit. J’accepte de suivre les auteurs de « Voir le viol » dans cette fiction critique selon laquelle le poème de Chénier pourrait être lu comme une pièce à conviction dans une enquête portant sur la question de savoir si oui ou non Naïs a été violée par Daphnis. J’accepte donc de « lire le poème de Chénier à la lettre », c’est-à-dire de le tenir pour la transcription écrite d’un enregistrement. En somme, j’accepte de faire comme si, entre les auteurs de « Voir le viol » et moi-même, il s’agissait, non d’un différend, mais d’un litige.
Transcription écrite d’un enregistrement : aucun effet littéraire particulier, donc ; pas d’autre « auteur » que le réel lui-même. Daphnis et Naïs ne sont pas des figures, mais des personnes, et même des personnes placées dans la réalité contemporaine. Je ne les connais pas, je ne sais rien d’autre d’elles que ce que leurs échanges transcrits me font connaître. Rien d’autre : et comme c’est un texte écrit que je lis, je dois me souvenir que je n’entends pas les voix. Puisque nous sommes face à la réalité, la première de ces réalités, c’est la nature du texte lui-même : ce n’est pas une bande-son. Est-ce qu’alors, pour paraphraser les auteurs de « Voir le viol », il devient facile de « décrire avec précision ce qui y est raconté », et de là, « de poser un mot sur une réalité » ?
Il me faudra d’abord protester : ce script ne raconte rien. Ce n’est pas une affaire de littérature, cette fois, mais bien de « réalité ». C’est dans la réalité ordinaire qu’on doit distinguer un récit d’un dialogue : le récit qu’un élève fera chez lui d’un cours auquel il a assisté n’est pas la même chose que la transcription écrite d’un enregistrement de ce même cours. Un récit suppose que ce qui est raconté est passé, puis re-présenté par un narrateur ; une transcription est la présentation de ce qui s’est passé (présentation lacunaire puisque manquent le son des voix, les gestes, etc.) au moment où cela s’est passé, comme cela a été enregistré puis transcrit.
J’ai accepté donc cette fiction : « L’Oaristys » transcrit les paroles « réelles » de deux jeunes gens. Rien n’est raconté. Certes, ce qui a lieu (car on tombera d’accord que le dialogue permet d’affirmer que quelque chose a lieu) peut devenir la matière d’un récit si une instance narratrice s’en empare : soit Daphnis, soit Naïs, soit un tiers (par exemple, les auteurs de « Voir le viol », qui racontent que Naïs a été violée).
Cependant, puisque l’enjeu du litige est l’établissement du référent, de son nom exact, de sa vérité, si Naïs raconte, il faudra aussi entendre Daphnis – et vice versa ; et si c’est un tiers, il faudra qu’il dise quelle autorité il a pour le faire – et bien sûr, il faudra là encore entendre Daphnis et Naïs.
Pour ce qui me concerne, à partir de la lecture de ce script (« lecture » : je suis privée du son des voix, je ne peux pas savoir si elles sont caressantes, brutales, terrifiées, etc.), suis-je dans la situation de me rendre à l’évidence que Naïs est violée ?
Eh bien, non. C’est encore non. Indépendamment de tout enjeu littéraire : commentaire critique, enseignement, partage transitionnel… Non.
Si je disais le contraire, je m’exposerais au danger évident de commettre une erreur sur la « réalité extra-littéraire ».
« Viol » n’est pas un mot descriptif : c’est un mot qui accuse. Il a besoin que le « non consentement » de la victime, c’est-à-dire la contrainte violente où elle a été d’accomplir l’acte sexuel qu’elle refusait d’accomplir, soit établi. J’ai suggéré plus haut que ce non consentement, fiction juridique d’une très grande importance, n’en comprend pas moins bien des obscurités quand on le met à l’épreuve de situations où « je » ne suis pas réductible au sujet de droit. Seule Naïs, qui n’est ni évanouie, ni dans le coma, ni une enfant, que l’événement n’a pas tuée (donc, elle peut parler), seule Naïs peut dire si elle a consenti ou non, si elle a été contrainte par Daphnis ou non, si ses mots, lisibles dans le script, traduisaient l’entièreté de sa volonté, si les termes qui désignaient ses émotions signifiaient uniquement sa terreur, sans l’ombre d’un doute possible. Elle seule peut citer ses propres paroles pour écarter les ambiguïtés, combler les ellipses et les lacunes, les organiser dans un récit de viol, etc.
Pour poser le mot « viol » sur l’acte de Daphnis présenté par ce script, je manque d’abord de la plainte de Naïs.
Mais pas seulement : je manque aussi de la défense de Daphnis. Et pour établir « avec précision » la « vérité » du viol, la parole de Naïs ne peut pas suffire : il me faudra d’autres preuves…
La définition « minimale » du viol de ces militants féministes, et encore plus leur façon de subsumer un morceau de réalité par un mot (à moins que ce ne soit une seule et même logique), promettent une justice expéditive qui risque de conduire à une erreur judiciaire : c’est-à-dire, très concrètement, qui risque de disjoindre violemment, en les déclarant « violé(e)s » et « violeurs », en intervenant de l’extérieur sur leur lien, des personnes extra-littéraires pour lesquels ces termes seraient pourtant inadéquats[64].
Plaisir littéraire et transitionnalité
Revenons à la littérature.
Avec une belle magnanimité, les auteurs de « Voir le viol » m’accordent le droit d’éprouver du plaisir à ce texte. Ils me réconfortent même en m’assurant que ce plaisir « n’a rien d’inédit ni de particulièrement pervers ou monstrueux » – à condition bien sûr que je reconnaisse, « honnêtement », qu’il met en scène un viol :
Hélène Merlin-Kajman défend le maintien d’une double-lecture au nom de son « droit d’accrocher [à ce texte] des souvenirs, ou des témoignages, ou des fantaisies, homme ou femme, d’un désir partagé, mais par surprise, par capture, par rapt violent même ». Mais est-ce de notre faute si le mot « viol » gêne son appréciation du texte ? Investir subjectivement et érotiquement un récit de viol n’a rien d’inédit ni de particulièrement pervers ou monstrueux, que l’on s’identifie à l’agresseur ou à la victime.
Ma saynète disait assez clairement que je ne m’identifie ni à Naïs ni à Daphnis.
Cette absence d’identification présente cependant deux versants.
Le premier, le plus long dans les commentaires successifs que je viens de faire du poème, accompagne mon déplaisir à le lire. Je le répète, je ne l’aime pas, il me laisse froide et m’irrite : mon premier geste est de lui retirer mon assentiment, de protester contre son engagement ontologique. Cependant, conduite à le commenter longuement, interpellée par la lettre des agrégatifs mettant sur le même plan le sonnet XX des Amours de Ronsard (que j’aime beaucoup), la pièce de théâtre La Mère coupable de Beaumarchais (que je trouve passionnante), et lui, je me suis mise à l’écouter d’une manière plus fine pour comprendre pourquoi lire dans le poème de Chénier la « représentation d’une scène de viol » me révoltait. C’est alors que j’ai repéré qu’un vers me faisait un plaisir sans réserve : « C’est ce bois qui de joie et s’agite et murmure. » Et ce vers habité d’un érotisme non violeur est aussi celui qui me fait entendre ce que j’ai appelé l’onirisme du poème.
D’où l’autre façon de ne m’identifier ni à Naïs ni à Daphnis. Cet érotisme qui se diffuse dans la signifiance du poème, et que j’ai interprété à travers le concept lyotardien de « phrase-affect », me grise légèrement ; il me fait écouter/regarder Naïs et Daphnis comme dans un rêve heureux : comme dans un rêve où l’on peut glisser d’une figure à l’autre, être l’un, être l’autre, osciller quelque part entre.
Mais à la vérité, le différend entre moi et les auteurs de « Voir le viol » rebondit :
Ainsi, le fait de reconnaître dans le tremblement de Naïs un signe ambivalent qui est fait pour être lu à la fois comme l’expression d’une crainte et celle d’un désir, et à ce titre comme un élément d’érotisation de la coercition sexuelle, n’en retire nullement la saveur littéraire. On peut même s’étonner de ce tour de force et y prendre plaisir.
Eh bien, non…
Le plaisir que je prends à un texte littéraire n’est pas de cette nature. La « saveur littéraire » me déplait : elle n’a rien de « littéraire » à mes yeux. Aucun « tour de force » ne pourrait réussir à me faire trouver du plaisir à ce qui m’est moralement insoutenable. Contrairement à ce qu’affirment les auteurs de « Voir le viol », pour qui « ce poème de Chénier n’est absolument pas le seul à produire un plaisir associé à un érotisme fondé sur le viol », pour qui « de tels récits sont bien souvent faits pour être lus de la sorte et s’inscrivent contextuellement dans une culture où le viol est érotisé », raison pour laquelle ils « respect[ent] entièrement le droit d’éprouver ce plaisir de lecture pour chacun⋅e », ce n’est précisément pas la « culture du viol » qui me fait aimer ce vers, « C’est ce bois qui de joie et s’agite et murmure ».
Je ne peux fournir aucune preuve à ce sujet – pas plus qu’eux-mêmes à propos d’une corrélation automatique entre le plaisir pris au poème de Chénier et la « culture du viol » qu’il illustrerait. Mais raisonnons.
À supposer même qu’une telle « culture » existe et soit présente dans le poème, il ne s’ensuivrait pas fatalement que le plaisir qu’on y prend soit indissociable de ladite culture. Pour moi, tout dépend de sa « beauté » – de sa façon de faire entendre du différend, de nous mettre à côté de l’abîme ou de l’extase sans nous y faire tomber, etc. Ce n’est pas la culture du duel et de l’honneur, ni ce qu’aujourd’hui on pourrait identifier anachroniquement (mais de façon compréhensible, et en un sens incontournable) comme son islamophobie, qui me font aimer Le Cid (que j’aime au contraire parce qu’il les trouble) ; ce n’est pas son antisémitisme qui soutient mon plaisir à La Marianne de Tristan l’Hermitte (et pourtant, il hante la pièce) ; enfin ce n’est pas ce que Benjamin appelle le « culte de la blague » (pratique d’extrême droite) qui explique que « Le Mauvais vitrier » de Baudelaire me saisisse et que je l’identifie comme un grand texte.
Ce poème en prose est un cas intéressant du reste, si on le confronte rapidement à « L’Oaristys ». Le vitrier et le poète ne se connaissaient pas avant leur rencontre dans l’appartement du dernier, ils ne se reverront jamais : séparés avant l’épisode raconté dans le texte, ils le seront aussi après. Ils n’ont aucun lien, ce qui facilite vraiment l’identification de l’agression, de l’agresseur et de la victime. L’interaction entre eux est quasiment nulle, et personne ne songerait à dire que le vitrier a peut-être désiré que le poète jette un pot de fleur sur ses vitres. Le rapport de pouvoir entre les deux est explicite ; le tort subi par le vitrier et la violence du poète à son égard, non moins évidents. Et pourtant, si la cruauté gratuite du geste saisit (mais est donnée pour telle), et peut dégoûter le lecteur, en retour, son énigme, le subtile échange des positions, la subtile osmose engendrée par la littérarité du poème, permettent de l’aimer, parce qu’il nous procure le vertige de pouvoir être, imaginairement, tour à tour le poète et le vitrier : « être tour à tour » en un lieu de soi-même qui n’est pas référentiellement représenté dans le poème, mais métaphoriquement, allégoriquement, traduit par lui.
Je crois qu’un texte qui voudrait établir ses effets (qui établirait la totalité de ses effets) sur un plaisir tiré d’un tort commis et entretenu (pour le cas qui nous occupe, un plaisir analogue au plaisir du violeur – à moins que les auteurs de « Voir le viol » n’imaginent un plaisir de la personne violée ?), et qu’aucun commentaire ne pourrait empêcher de produire ces effets, cesserait d’être pour moi un texte littéraire.
Et c’est pourquoi selon moi, la catégorie des « textes représentant des violences sexuelles » ne peut en aucun cas constituer un paradigme pertinent, tel qu’il est envisagé par la lettre des agrégatifs ou par les auteurs de « Voir le viol ». Pour deux raisons conjointes.
La première relève de l’évidence épistémologique : un texte n’est pas suffisamment défini si on se contente de le définir à partir de ce qu’il « représente », évidence illusoire qui obscurcit la réflexion plus qu’elle ne l’éclaire.
La seconde ressort de ce parcours que je viens de proposer. Un texte « littéraire » n’est vraiment littéraire pour moi que s’il est beau, conformément à la définition que j’ai esquissée ci-dessus, ou à tout le moins s’il peut être partagé sur un mode transitionnel – qui, selon la définition que j’en donne, est aussi un mode qui n’étouffe pas le(s) différend(s).
C’est la raison pour laquelle il n’y a pas pour moi « d’absolutisation de la transitionnalité », contrairement au soupçon des auteurs de « Voir le viol » :
Une première réserve que nous avançons face à cet argument porte sur une forme d’absolutisation de la transitionnalité, horizon privilégié du commentaire. Bien que ces mêmes notions conduisent ponctuellement Hélène Merlin-Kajman à écarter certains textes dans Lire dans la gueule du loup, elles semblent ici fonctionner en dernière instance au détriment de la lettre du texte, voire d’une honnêteté de lecture (lire les refus de Naïs et les gestes de Daphnis), pour en préserver le partage. Or pourquoi faudrait-il à tout prix « partager » ce texte au sens que donne Hélène Merlin-Kajman à ce terme ?
Ce soupçon est un soupçon important : les auteurs ont raison de l’avoir et de le formuler. Car le danger ne m’échappe pas. Je me contenterai d’une remarque pour conclure.
La première, c’est une phrase de ma saynète : « Ai-je pour autant envie de partager ce texte ? Pas beaucoup. » Comme je l’ai longuement expliqué plus haut, je suis loin de croire qu’il « fa[ille] à tout prix “partager” ce texte au sens que [je] donne […] à ce terme » – au contraire. Mais s’il le faut, je commencerais à essayer un partage transitionnel, puisque le poème est donné comme un texte « littéraire ». Un partage transitionnel, pour moi, est un partage qui essaie de maintenir co-présentes plusieurs lectures.
Mais il se pourrait que je conclue à l’impossibilité d’un tel partage, compte tenu du texte (ou que je propose un partage de ce type d’un texte a priori non littéraire).
C’est seulement au terme d’un constat d’impossibilité que j’écarterais un texte.
Dans Discours, Figure Jean-François Lyotard fait une remarque puissante :
L’œuvre est vraie pour autant qu’elle se donne effectivement comme œuvre de Phantasie, et que, même lorsque l’artiste réalise son fantasme, il ne le donne pas comme savoir et salut. Le discours ou le rituel religieux ne procèdent pas moins de l’accomplissement de désir que l’épopée ou le roman, le théâtre ou la danse ; seulement ils accomplissent effectivement le désir, c’est-à-dire qu’ils l’anéantissent dans les représentations qu’ils suscitent ; ils font croire. Les expressions plastiques, littéraires, chorégraphiques en appellent assurément à des mouvements d’identification de l’amateur au contenu exhibé par le moyen des formes ; mais ces formes interdisent que le désir s’accomplisse, qu’il s’hallucine et se décharge dans le leurre de l’effectuation des contenus, simplement parce que ces formes ne se laissent pas ignorer, que leur présence manifeste fait barrage à la compulsion à traverser le tableau, l’écran, la scène italienne ou la page du livre, qu’elles maintiennent ainsi le désir dans l’inaccomplissement. Ce caractère de « jeu » que Freud reconnaît à l’art tient, je pense, à ce statut propre de la forme dans les œuvres[65].
Transposons brutalement la question soulevée par Lyotard : le poème « L’Oaristys » appelle-t-il à « l’effectuation des contenus » (supposons même que ce soit un « viol »), ou maintient-il le désir (quel qu’il soit) dans l’inaccomplissement[66] ?
Mes lectures précédentes répondent sans hésiter : « L’Oaristys » n’appelle pas à l’effectuation des contenus, mais maintient le désir dans l’inaccomplissement, parce que sa forme ne donne pas les « contenus » du poème comme « savoir et salut ». En ne se laissant pas ignorer, les formes rendent indécidables ces « contenus » qu’elles font miroiter avec plus ou moins de bonheur esthétique, interdisant par là de les traduire en objets de litige (de savoir, de salut).
Et peu importe alors si, spontanément, j’avais exclu ce texte du partage littéraire, en raison de sa médiocrité (pour moi). Mes lectures successives créent les conditions d’un partage transitionnel qui n’absolutise rien, car l’une ne chasse pas l’autre : elles exagèrent le jeu de la forme, afin d’empêcher que le désir ne « s’hallucine » (par exemple en désir-de-viol, ou en terreur-de-viol) – au contraire. Mais elles n’évacuent pas la conflictualité des différends – au contraire.
[1] http://www.mouvement-transitions.fr/index.php/exergues/saynetes/sommaire-des-saynetes-deja-publiees/1502-saynete-n-73-a-chenier-h-merlin-kajman.
[2] Il s’agit d’un poème figurant dans l’œuvre de littérature française du XVIIIe siècle au programme : André Chénier, « Le Jeu de Paume » et « Hymne », pp. XCIII à CXXIII ; « Poésies antiques », p. 3 à 145 ; « Hymnes et odes » et « Dernières poésies », p. 439 à 472, in Poésies, édition Louis Becq de Fouquières, Paris, Gallimard, collection « Poésie/Gallimard », n° 276.
[3] https://lessalopettes.wordpress.com/2017/11/03/2540/.
[4] Voir http://www.mouvement-transitions.fr/index.php/litterarite/articles/n-5-b-tabeling-voir-ou-ne-pas-voir-le-viol-l-ethique-du-metadiscours.
[5] Une partie de cette conférence a été reprise dans mon article portant sur le trigger warningparu sur le site de Transitions : http://www.mouvement-transitions.fr/index.php/litterarite/articles/n-4-h-merlin-kajman-enseigner-avec-civilite-trigger-warning-et-problemes-de-partage-de-la-litterature.
[6] Lire dans la gueule du loup. Essai sur une zone à défendre, la littérature, Gallimard, 2016 ; L’Animal ensorcelé. Traumatismes, littérature, transitionnalité, Ithaque, 2016.
[7] La Langue est-elle fasciste. Langue, pouvoir, enseignement ?, Seuil, 2003.
[8] Étienne Balibar, « Trois concepts du politique », dans La Crainte des masses, Galilée, Paris, 1997.
[9] Ce n’est évidemment pas faux : une radio d’extrême-droite a ainsi pu prendre pour nom « Radio Courtoisie » : « Sans elle, la pensée libre, attachée à la patrie et aux traditions, serait asphyxiée par la gauche », peut-on lire sur Google. Mais en langue française, la courtoisie n’est pas du tout la civilité.
[10] Voir la réponse que Marcel Hénaff, Gérald Sfez et moi-même avions faite à un article de Luc Boltanski et Arnaud Esquerre, « Front national : de quel peuple parle-t-on ? » (Libération, 30 mai 2014), où les deux auteurs faisaient de la défense de la civilité un propos sympathisant avec l’extrême-droite : Hélène Merlin-Kajman, Marcel Hénaff, Gérald Sfez, « Gauche : de quelle civilité ne parle-t-on pas ? » (Libération, 9 juin 2014) (https://www.liberation.fr/france/2014/06/09/gauche-de-quelle-civilite-ne-parle-t-on-pas_1036980).
[11] La lettre des agrégatifs commente le rapport du jury de 2016 qui « n’évoque jamais l’attitude des étudiant⋅e⋅s face aux violences sexuelles présentes dans les œuvres au programme cette année-là » et « préfère au terme “viol” une série d’euphémismes pour décrire le sonnet 20 des Amours de Ronsard (longuement commenté) dans la partie consacrée à l’épreuve écrite de littérature française […] ».
[12] Passage repris dans mon article sur le trigger warning (http://www.mouvement-transitions.fr/index.php/litterarite/articles/n-4-h-merlin-kajman-enseigner-avec-civilite-trigger-warning-et-problemes-de-partage-de-la-litterature).
[13] http://www.mouvement-transitions.fr/index.php/exergues/saynetes/plus-qu-une-saynete-beaumarchais-l-forment.
[14] https://malaises.hypotheses.org/242.
[15] http://www.mouvement-transitions.fr/index.php/litterarite/articles/n-5-b-tabeling-voir-ou-ne-pas-voir-le-viol-l-ethique-du-metadiscours.
[16] André Chénier, « L’oaristys – imitée de Théocrite », I, Les Bucoliques, dans Œuvres poétiques, Garnier, 1889, Vol. 1 (p. 22-28). https://fr.wikisource.org/wiki/Œuvres_poétiques_de_Chénier/Moland,_1889/L’Oaristys.
[17] J’ai essayé de le faire dans Lire dans la gueule du loup.
[18] Gérald Sfez, La Langue cherchée, Éditions Hermann, 2011.
[19] Voir les belles analyses de Gérald Sfez dans La langue cherchée, op. cit..
[20] Voir les travaux de Jean-Luc Nancy, notamment La Comparution, écrit avec Jean-Christophe Bailly.
[21] Voir Viktor Chklovski, « L’Art comme procédé », O teorii prozy, Moscou, 1929 (1e édition, 1925), dans Théorie de la littérature. Textes des Formalistes russes, présentés et traduits par Tzvetan Todorov (Préface de Roman Jakobson), Paris, Seuil, 1965. Tzvetan Todorov a traduit ostranienie, traduit ici par « estrangement », par « singularisation » (cf. index p. 315, « Procédé de singularisation » ; et note du traducteur Pierre-Antoine Fabre, dans Carlo Ginzburg, À Distance, op. cit., p. 15). On rencontre aussi « étrangisation » et « défamiliarisation ».
[22] Je suis ici tout à fait d’accord avec « Voir le viol » :
[23] « N. : Une femme est esclave. D. : Ah ! plutôt elle est reine. / N. : Tremble près d’un époux et n’ose lui parler. / D. : Eh ! devant qui ton sexe est-il fait pour trembler ? » ; et plus loin : « D. : Eh ! laisse-moi toucher ces fruits délicieux… / Et ce jeune duvet… N. : Berger… au nom des dieux… / Ah !… je tremble… D. : Et pourquoi ? que crains-tu ? Je t’adore. »
[24] Voir http://www.mouvement-transitions.fr/index.php/intensites/le-contresens/sommaire-des-articles-deja-publies/909-n-15-j-david-fatiguer-l-hermeneutique-pour-jean-kaempfer.
[25] Jérôme David, « Engagement (ontologique) » dans Emmanuel Bouju (dir.), Fragments d’un discours théorique. Nouveaux éléments de lexique littéraire, Paris, éditions Cécile Defaut, 2015, p . 86.
[26] Je me permets de citer ce passage, d’autant qu’il évoque la lecture que je fais du sonnet XX des Amours de Ronsard : « Si je lis La Chèvre de M. Seguin en étant tour à tour la chèvre et le loup, le sonnet de Ronsard en étant tour à tour Ronsard et Cassandre, et le récit d’Ovide en étant tour à tour Proserpine et Hadès, la lecture me procure l’espace d’une transformation grâce à laquelle je ne suis plus engloutie dans « la fixité des places qui figeaient l’existence », pour reprendre l’expression de Monique David-Ménard, qui précise « qu’on nomme habituellement subjectivité » cette « capacité de jouer avec les points de souffrance ». (Monique David-Ménard, Tout le plaisir est pour moi, Paris, Hachette, 2000, p. 28-32)
[27] Lors du séminaire consacré au poème, certains membres de Transitions ont lu également une allusion grivoise dans ces vers prononcés par Daphnis : « viens de grâce écouter / Les sons harmonieux que ma flûte respire:/ J’ai fait pour toi des airs, je te les veux chanter […] ».
[28] Voici notamment la dernière phrase : « C’est pourquoi une définition claire des attentes des jurys de concours nous semble importante, afin de permettre aux étudiant⋅e⋅s comme aux enseignant⋅e⋅s d’appréhender les exercices d’une manière à la fois plus précise et plus apaisée. »
[29] Il y avait plus de 1300 inscrits à l’agrégation de lettres modernes pour 2018, et 119 postes ouverts au concours : on peut présumer que la totalité, ou la quasi totalité des 22 normaliens signataires de cette lettre a obtenu l’agrégation, et qu’une majorité d’entre eux poursuivra ses études supérieures en doctorat et obtiendra tôt ou tard un poste à l’université.
[30] La lettre, il est vrai, cite des passages de deux rapports de jury, manifestement discordants dans leurs attentes, mais qui tous deux appellent à ne pas perdre de vue le caractère littéraire de l’exercice demandé aux agrégatifs. Les signataires voient dans ce rappel une preuve de cet antagonisme selon eux propre aux études littéraires entre « posture critique » et « posture de stricte analyse littéraire ». Je ne lis pas ces rapports de la même manière qu’eux, indépendamment de la question de mon accord ou de mon désaccord avec la perspective critique qui s’y exprime. Les passages cités me paraissent se contenter de rappeler, d’une part qu’un texte littéraire est une mise en forme particulière, jamais l’énoncé direct et littéral d’un message, jamais un simple discours ; d’autre part, qu’un commentaire littéraire porte sur cette mise en forme, jamais directement sur ce dont parle un texte littéraire en oubliant sa textualité. Si je commente Bagatelles pour un massacre de Céline, je dois non pas m’indigner de son antisémitisme, ni de l’antisémitisme en général, non pas non plus raconter l’usage qui en a été fait pour prouver son antisémitisme, mais analyser comment cet antisémitisme est représenté, produit et agi textuellement, discursivement, rhétoriquement. Nul antagonisme entre la mention de son antisémitisme et l’analyse « littéraire » de sa mobilisation pamphlétaire. Les signataires de la lettre ne se font sans doute pas une idée très exacte du type de commentaire d’agrégatifs, écrit ou oral, visé par ces rapports.
[31] À la vérité, je ne sais pas bien ce que c’est qu’une « posture », qu’elle soit « critique » ou « de stricte analyse littéraire » : ce mot a envahi le lexique critique depuis une dizaine ou une quinzaine d’années, et il s’incruste. Je n’ai pas le sentiment d’obéir à une posture quand je fais de la recherche : j’essaie même plutôt de ne pas en adopter une. Les saynètes de Transitions ont précisément pour but de permettre à leurs auteurs de risquer une parole sans posture.
[32] La lettre des agrégatifs aussi veut faire entendre un « impensé » – « l’impensé des études littéraires » : « Enfin, nous précisons qu’il ne s’agit pas pour nous de faire de ces questions le fondement d’un rapport au texte mais qu’il nous semble important de clarifier ce qui nous apparaît comme un impensé des exercices littéraires académiques. » Personnellement, cela fait tant d’années que je « pense » cet « impensé » non moins que la question de savoir s’il s’agit là du « fondement d’un rapport au texte » ou non (et je ne suis évidemment pas la seule : cette pensée m’a été transmise et s’alimente sans cesse à des lectures), que je ne reconnais rien de cette description de l’état de la discipline présentée dans cette lettre. Que des agrégatifs prennent quelques cours d’agrégation pour la norme de la profession me paraît compréhensible et éminemment excusable. En revanche, que des doctorants, des enseignants du secondaire et surtout des universitaires approuvent et confirment cette description de notre discipline et de son enseignement en co-signant ce texte m’étonne profondément. Cet étonnement a été, et est encore, ce qui m’invite à continuer la réflexion.
[33] « Voir le viol » s’ouvre sur cette remarque : « Dans cette lettre ouverte qui ne portait pas directement sur la lecture du poème de Chénier, mais sur le positionnement attendu lors d’une épreuve d’agrégation […] ». Il me paraît très clair que la lettre porte sur le « positionnement » des études littéraires, prises dans leur extension la plus grande.
[34] Cf. la note 4 de la « Lettre ».
[35] Note du texte cité : « Rappelons qu’en France 3,25% des femmes et 0,5% des hommes ont subi au moins un viol au cours de leur vie (sans même tenir compte des tentatives de viol et autres agressions sexuelles beaucoup plus répandues), dans la moitié des cas environ lorsqu’ils ou elles étaient mineur⋅e⋅s. Il est donc impossible qu’un⋅e enseignant⋅e ne soit pas régulièrement confronté⋅e en classe à des élèves victimes de violences sexuelles. »
[36] Le texte « Voir le viol » inscrit le débat critique dans le même type de scénario, comme le relève Brice Tabeling : « Car le modèle qui, très explicitement, détermine leur conception du métalangage n’est ni littéraire, ni politique : il est juridico-judiciaire. »
[37] Cf. citation plus haut : « En effet, nous nous sommes rendu compte que le poème “L’Oaristys”, que nous avions immédiatement identifié comme la représentation d’une scène de viol, était couramment interprété au prisme d’une “convention littéraire” qui évacue cet aspect et, par-là, toute interrogation sur le sujet. »
[38] Le Différend, p. 52-53, §42
[39] Ibid., p. 127
[40] §22, p. 29-30
[41] Plus loin, la frontière des deux idiomes bougera un peu, le premier étant décrit comme capable de « relever les discours racistes et antisémites », mais ayant pour point aveugle « le sexisme et les violences sexuelles ».
[42] Elle interdit pas exemple la liberté revendiquée par Roland Barthes dans Critique et Vérité :
[44] Je prends ici le verbe en son double sens concret et intellectuel : « faire entendre », c’est donner à entendre pour faire comprendre. Comme je le dis plus bas, le poème est peu visuel : les détails concrets comme le voile ou le gazon, qui ont aussi un sens figuré, ou à tout le moins fonctionne comme des métonymies, ne dessinent pas un tableau. Il n’y a nulle description dans ce poème, encore moins d’hypotypose.
[45] « Or que lisons-nous dans ce texte ? Hélène Merlin-Kajman concède que le personnage féminin “dit plutôt non” avant d’argumenter en faveur de l’inadéquation du terme. Pourquoi “plutôt” ? Naïs dit très clairement “non”, et ses “non” sont systématiquement ignorés.
Plus précisément, Naïs formule trois refus à une invitation verbale à poursuivre une interaction sexuelle après le premier baisé accordé : “Adresse ailleurs ces vœux dont l’ardeur me poursuit”, “Non ; déjà tes discours ont voulu me tenter”, “Va, tes airs langoureux ne sauraient me séduire”.
On lit également dans le dialogue cinq ordres d’arrêter des gestes déjà initiés […] ».
[46] Cf. citation de la note précédente.
[47] Je lance cette lecture plus par jeu que par conviction, et de mémoire : je n’ai pas vérifié sa possible pertinence psychanalytique (ce n’est en effet pas cet aspect de la psychanalyse, qui a été un passage obligé du commentaire dans les belles années de la « psychocritique », qui m’intéresse quand je mobilise son savoir pour réfléchir sur la littérature).
[48] « N. : À des travaux affreux Lucine nous condamne. / D. : Il est bien doux alors d’être chère à Diane. »
[49] « N. : J’entrai fille en ce bois et chère à ma déesse. / D. : Tu vas en sortir femme, et chère à ton époux. »
[50] Pour Lyotard, le différend phoné/logosmarque l’expérience de la différence sexuelle. Gérald Sfez résume sa position : « La phrase-affect, récalcitrante à l’adulte, se maintient comme ce qui transit le sujet de part en part toujours avec autant de force, sans qu’il y ait d’osmose ou de réunion entre elle et la phrase articulée, entre le présent décliné selon l’absence de tout “un” et de tout “propre”, de tout “même” et de tout “autre”, et le temps chronologique, affine avec l’articulation. Aussi, la différence des sexes est ressentie comme heureuse du fait de la présence de mon consentement à cette passibilité d’avant, originaire, mais sans confondre les ordres : “il n’y a d’amour qu’autant que les adultes s’acceptent enfants” ». (Gérald Sfez, Logiques du vif. Lyotard en éclaireur, Paris Hermann, 2016, p. 303)
[51] La saynète de Lise Forment portant sur Mère Couragese termine sur une question qui m’est adressée : « Dans le texte de Chénier, […] “ce bois qui de joie et s’agite et murmure” suffisait-il à sauver le lecteur-voyeur que le texte enfantait ? Je n’en suis pas si sûre… ». Il ne me paraît pas fatal que le poème enfante un lecteur-voyeur : la pulsion scopique me paraît au contraire très peu excitée par ce poème. Il n’empêche que sa fantaisie se doublant de pauvreté, elle peut facilement verser dans le cauchemar, je viens de le dire.
[52] Je ne fais pas ici allusion aux signataires de la lettre des agrégatifs ni aux auteurs de « Voir le viol ». Lorsque ces derniers identifient dans le poème la représentation d’une scène de viol, ils ne veulent pas suggérer par là que le poème a un effet traumatique : au contraire, ils avancent que le plaisir en quelque sorte « doux » qu’on peut tirer de ce poème repose sur un « paradoxe central dans la culture du viol » : sa « violence [n’est] pas perçue comme un viol mais comme un jeu érotique où une femme céderait à son propre désir grâce à un rapport contraint », sans trauma, donc : sans trauma représenté dans le texte (d’où la possibilité que le viol soit rendu invisible), ni trauma ressenti par le lecteur, reconduisant ainsi, par cette absence de douleur en somme, la « culture du viol ».
En reconnaissant que l’espèce d’onirisme du poème peut faire surgir du cauchemar traumatique, j’avance donc ici une hypothèse différente, dont la possibilité m’a été fournie par mes discussions avec des membres de Transitions. Mais ma réflexion sur la transmission traumatique me permet aussi de penser, en m’appuyant sur certaines définitions du trauma qui insistent sur l’effet d’anesthésie qu’il produit sur celui ou celle qui en a été le siège, que la lecture du poème en termes de « représentation d’une scène de viol » sur la base d’une croyance herméneutique dans la « lettre » du texte et d’une réduction positiviste de la réalité humaine à un ensemble de faits constatables (cf. plus bas sur cette question ; et l’article de Brice Tabeling) constitue une lecture traumatisante, sinon traumatisée, du poème.
[53] Les signatures sont suivies de cette précision : « Enseignantes ou futur·es enseignant·es, nous étions tou·te·s signataires de la lettre ouverte adressée au jury de l’agrégation de Lettres, que plusieurs d’entre nous ont rédigée. Nous avons tou·te·s participé à des réflexions antérieures sur la représentation des violences sexuelles en littérature, que ce soit à l’occasion de l’atelier de novembre 2016 à l’ENS de Lyon, d’un mémoire de recherche, d’événements scientifiques ou du carnet Malaises dans la lecture. »
[54] Je suis désolée que le genre de la saynète, et le souci de faire place à mes contradicteurs malgré la brièveté de la forme, d’autant plus brève que le poème de Chénier cité était long comme je l’ai expliqué plus haut, ait rendu mon propos obscur. Je restitue ici le passage incriminé dans son entier :« Mais ce viol ? — Je ne le vois pas, je ne le sens pas. Je vois une séduction très dissymétrique, et tristement pauvre. Mais Naïs consent. — Elle consent ? Vous vous rendez compte de ce que vous osez affirmer ? —D’accord, elle ne consent pas : elle cède. Voilà, elle cède. Mais outre qu’elle ne cède pas sans rien savoir de ce qu’elle fait – le dialogue est très clair sur ce point, car “Diane” signifie “virginité” –, elle cède aussi à son désir : “Ah !… je tremble…”. — Comment, vous prétendez qu’elle ne tremble pas de peur ? — Je prétends que c’est ce que veut signifier le texte. — Mais c’est un texte d’homme ! Et le consentement, c’est le grand alibi des violeurs, vous ne l’ignorez pas ! — Oui, oui, je l’admets. Ma question sera alors celle-ci : quel gain (théorique, sensible, sentimental, esthétique, etc.) nous apporte l’étiquette de viol pour résumer l’histoire ? » Ma saynète met en scène un dialogue fictif entre « moi », et un contradicteur ou une contradictrice qui réfute que Naïs « consente ». Ce contradicteur fait remarquer que les violeurs prétendent toujours que leur victime était en fait consentante. C’est une objection majeure, et « moi » dit aussitôt « Oui, oui, je l’admets ». En relisant ce passage de ma saynète, je me rends compte que l’objection va tellement de soi à mes yeux que je n’ai probablement pas assez insisté sur son évidence, et que la réplique « Oui, oui, je l’admets » pouvait sembler, était même, trop désinvolte. Je suis donc presque entièrement d’accord avec la manière dont « Voir le viol » résume plus loin la position des violeurs et de ceux qui manifestent de l’indulgence à leur égard : « si les femmes sont violées, c’est qu’elles en avaient un peu envie malgré leurs refus, et la contrainte est nécessaire pour leur faire prendre conscience du désir qu’elles éprouvaient sans le dire.[…] Les féministes ont souvent relevé, par l’absurde, que pour qu’on ne reproche pas à une victime de viol d’avoir “cédé”, elle doit soit être morte, soit ne pas avoir été violée. »
[55] « Nous […] affirmons la nécessité d’enseigner, de commenter et de partager ces textes avec un minimum de réflexivité sur ce dont il est question […] »
[56] Et plus loin : « On peut (heureusement !) apprécier un texte en étant conscient⋅e du caractère problématique de ce qu’il met en scène, on peut admirer la maîtrise, la finesse avec laquelle un·e auteur·e raconte un épisode dérangeant. Mais il n’en importe pas moins de lire honnêtement les textes, et de mettre en lumière leurs enjeux principaux. »
[57] Voir l’article de Brice Tabeling pour la mise en lumière de cette dimension de « Voir le viol ».
[58] Cette définition minimale sera développée par la suite : « Céder face à quelqu’un qui ne respecte pas votre refus explicite d’avoir une relation sexuelle, c’est être violée. Céder face à des agressions sexuelles répétées et des gestes violents qui vous placent dans une situation de complète vulnérabilité (Naïs ne peut pas fuir parce qu’elle est nue), c’est être violée. Céder dans ces conditions, ce n’est pas « céder à son propre désir », c’est céder sous la contrainte d’autrui. »
[59] Voir Olivier Cayla et Yan Thomas, Du droit de ne pas naître. À propos de l’affaire Perruche, Paris, Gallimard, 2002.
[60] Ces réflexions doivent beaucoup à Patrice Loraux, « Consentir », dans Le Consensus, nouvel opium ?, Le Genre humain, novembre 1990.
[61] Comme le linguiste Oswald Ducrot définit la négation.
[62] Je pense que c’est ce que veut dire Brice Tabeling en demandant le maintien de l’hésitation.
[63] Comme l’écrit Brice Tabeling : « Dans “Voir le viol”, c’est d’abord l’aspect juridique du commentaire qui est le plus saisissant : leur lecture est en fait la traduction dans un idiome absolument fonctionnel (sans contradiction, sans profondeurs) d’un événement textuel ; il faut redire la scène amoureuse (ou sexuelle, ou conjugale, ou économique) de “L’Oaristys” à travers un récit légal, apte à produire un jugement binaire (condamnation ou non-lieu) ».
[64] Je cite à nouveau Brice Tabeling : « Pour la qualité (épistémologique) de l’instruction, on aurait pu souhaiter des enquêteurs plus soucieux de la complexité des signes qu’ils analysent ». En revanche, pour nourrir le dialogue, pour garder en mémoire le spectre des différends, je me sens fondée à évoquer un « quasi viol », mi-concession, mi-réticence…
[65] Jean-François Lyotard, Discours, Figure, Paris, Editions Klincksieck, 1978, p. 356.
[66] Cette question n’est absolument pas la même que celle dont j’ai accepté la fiction pour faire l’épreuve de la question posée par les auteurs de « Voir le viol » : si le poème de Chénier était un script (s’il se donnait comme document, pré-savoir, pourrait-on dire en utilisant le lexique de Lyotard), devrais-je conclure que Naïs avait été réellement violée ? Ma réponse était : « non ». On remarque cependant au passage que la question posée par les auteurs de « Voir le viol » au poème de Chénier balaie d’emblée la question de la forme, c’est-à-dire fait d’emblée sortir le poème de sa littérarité possible, sans examen.