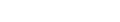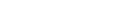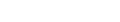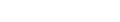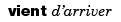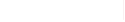Juste une fable n° 72
La Force du métier
Coline Fournout
15/04/2017
« Chaque matin, comme chaque matin,
Je fais des plans.
Des plans, oui, oui, oui – magnifiques, ambitieux.
Des cités immenses qui tournent à plein régime.
Ou bien,
Des infiltrations, des attentats, des proclamations. Cela dépend.
Tout, définitif.
Tout, en même temps.
Il suffit qu’au saut du lit j’accroche ma tête
Bien en place.
Sept heures et l’ennemi n’a qu’à se tenir prêt.
Au porte-manteau tête point n’est restée.
Les fondations sont solides, les dédales certains,
Et les pièges ! Les pièges !
Est-il besoin de parler des pièges ?
Les rues sont admirables.
Il y a de beaux magasins et des marchés à n’en plus finir.
Odorants, bruyants, parfaits, les voilà, mes marchés.
Le chou déborde sur les marches des lieux dits.
On ne peut plus monter les escaliers.
La ville est extrêmement vivante, vrai.
Elle a bureaux, salles, quartiers ; bureaux, usines, musées ; et même, un fleuve gros, sale et vigoureux.
Dix déjà.
J’ai prévu des agrandissements, j’ai même tracé déjà de futures fondations.
Toutes les fenêtres s’ouvrent et les chantiers ne cessent.
– Agrandissement, mais élargissement, mais édification toujours plus haute, saugrenue.
J’ai lancé des armées en conquête, autant que d’espions chenus.
Des souterrains se creusent.
L’air est frais, le ciel, large.
« Rénovez la peur ! Rénovez la peur ! »
Hurle-t-on parfois dans les quartiers que j’accable et qui parfois résistent.
Et moi-même, j’hurle :
« Ne te cache pas ! Ne te cache pas !
« Brise le cœur à tous ! »
La tête sciée par les bruits des travaux
Je fais vite reboucher l’ébauche du métro,
Délecté de présages d’effondrement.
Dans les yeux, la sciure des planches que j’ai utilisées.
On ne peut être à la fois arpenteur et charpentier.
Avec ça, d’habitude, on éponge le sang.
C’est midi, la promenade sur les remparts.
J’observe qu’à mon insu la superficie de la ville a diminué de moitié.
Je vois fourmiller dans la ville une rumeur.
Je la vois qui colporte, cloporte.
Ma réputation est décriée, c’est écrit sur les murs.
Mes rapporteurs l’assurent.
J’entends ce qui court sur toutes les lèvres :
Toute part reçue est part de mort !
La mienne, de mort, arriverai-je à faire ce qu’elle commande ?
Quand je regarde au loin, les éoliennes ont été décapitées par le brouillard.
À l’entrée de la ville, un mourant.
Je l’avais vu venir pourtant.
Il est à plat ventre devant la porte de la ville.
Et à la porte, voici gravé :
“ Faire que tout cède et rien ne tienne ;
Faire que ce qui tient, cède ;
Faites que ce qui ne cède pas, cède ”
Je frissonne : fatigue.
Je crains les acouphènes que donne la faim,
Et garde toujours les oreilles cachées,
Et laisse toujours au loin l’horizon s’effaroucher.
À peine quatorze heures et j’ai trouvé solution au froid.
Un coin de rue sur deux, ordonner autodafé.
Lancer des fusées vers le soleil, l’incendier.
Cela retombe et incendie.
Le feu pépie.
C’est ravissant, je bats des mains, je fais une ronde avec des enfants.
Revigoré !
Revigoré !
Je lance de longs cris aigus qui brisent toutes les vitres dans un claquement délicieux.
Le roulis des briques qui s’effondrent est bien trempé.
Je me permets d’être tendre.
Pendant ce temps
Les magistrats se demandent pour qui il est naturel de vider l’autre de son sang,
Amour à bout portant.
À dix-huit heures, la haine est claire, déclarée.
Je défais pierre par pierre.
C’est un long travail, d’autant qu’il ne faut pas oublier de couler du béton.
Peur des glissements de terrain.
Je passe soigneusement mes amours au feu, présents et anciens.
J’en ai plein partout, du sel après la mer.
Il n’y a plus d’amis, il n’y a donc plus d’ennemis, et les pleurs peuvent couler.
J’en arpente aussi les rives.
J’en ai ridées, des eaux planes, des os plantés.
Je travaille d’arrache-pied.
Cela m’absorbe.
Je ne dîne pas.
A minuit, je me couche la tête dégagée.
C’est nécessaire.
Demain matin, il y aura beaucoup à bâtir. »
*
Quand sa vie fut passée à apprêter la fin,
Un tyran fit sécession avec lui-même.
D’on ne sait où, une lance alors l’atteignit dans le dos.
Et lorsqu’il se tourna pour voir “qui”, la lance se déplaça et entra, un peu plus profondément, vers le cœur de la cage.
La torsion n’était pas achevée que le tyran était mort.