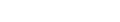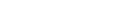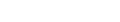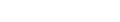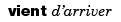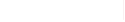Inédit
Trauma(s), conversion(s), œuvre(s) à faire : le grand incendie de londres de Jacques Roubaud
Préambule
Les 13, 14 et 15 décembre 2018 s’est tenu un colloque international sous l’égide de Transitions consacré à « Littérature et trauma ». Il a rassemblé trente-six communiquants réunis en sessions, elles-mêmes réunies en journées. Adrien Chassain est intervenu vendredi 14 décembre (« Des équivoques à éclaircir »), lors de la session « Figures de l’autre ».
Adrien Chassain, dans cette contribution consacrée au grand incendie de londres de Jacques Roubaud, se penche sur la façon dont un projet d’écriture, véritable conversion littéraire surgie pour échapper au halo traumatique laissé par le suicide du frère de l’écrivain, devient pour lui, à travers ses reprises quasi spectrales, non seulement la figure projetée, ou le témoin anticipé d’une vita nova (et le cas de Barthes est également convoqué) après un deuil, mais aussi un texte qui, écrit dans un présent de bribes, en devient véritablement partageable comme tel, au bord de l’abîme, par le lecteur, répondant ainsi, par hypothèse, à la formule de Jean-Max Gaudillière citée par Patrice Loraux : « le trauma parle au trauma »...
H. M.-K. et T. P.
Adrien Chassain est ATER en littérature française des XXe et XXIe siècles à l’ENS de Lyon. Il a soutenu une thèse de doctorat à l’université Paris VIII intitulée : « Fragments d’avenir. Le livre à venir et son annonce aux seuils du régime moderne d’historicité (XVIe/ XXe siècle). Une poétique sociale du projet ». Membre de Transitions.
Trauma(s), conversion(s), œuvre(s) à faire : le grand incendie de londres de Jacques Roubaud
Adrien Chassain
04/05/2019
En 1961, année du suicide de son frère Jean-René, Jacques Roubaud s’est lancé dans une grande entreprise décidée à la suite d’un rêve « prophétique[1] » intervenu dans la nuit du 4 au 5 décembre, jour de son anniversaire. Elle-même présentée comme une « alternative à la disparition volontaire[2] », comme un moyen d’échapper au « démon » de l’« à quoi bon[3] » qui avait emporté son frère, cette entreprise répond à une ambition unifiante et totalisante : celle de conjoindre les deux activités principales de l’auteur que sont la poésie, reconnue comme objet d’une vocation depuis les années 1940, et les mathématiques, pratiquées en tant qu’enseignant-chercheur depuis la fin des années 1950 à l’université. Projet double, donc, et même triple, puisqu’un roman annoncé par le rêve devait, « sous le vêtement d’une transposition dans l’imaginaire d’événements inextricablement mélangés de réel, en […] marqu[er] les étapes, dévoil[er] ou au besoin dissimul[er] les énigmes, éclair[er] la signification[4] ». Un tel Projet, au moins sous sa forme plénière, a été abandonné autour de 1978, après avoir été plusieurs fois délaissé puis relancé, au gré d’« illuminations » rejouant celle de 1961, dans un même élan de « mégalomanie intellectuelle prospective[5] ». En 1978, donc, le 24 octobre, lors d’une « autre illumination nocturne, réellement noire celle-là », Roubaud constate « l’échec du Projet, et du Roman[6] ». Il jette alors sur le papier les quelques lignes d’un « Avertissement » qui, prenant acte de l’échec, inaugure le nouveau (grand) projet d’en faire le récit : là où Le Grand Incendie de Londres, titre du roman formulé à l’issue du rêve, devait rapporter la genèse du Projet, le grand incendie de londres en racontera les atermoiements et la ruinification. « Mais l’ironie générale de mon existence redouble alors, raconte Roubaud. Car, ayant immédiatement entrepris le récit de mon échec, fort de l’illumination (noire) et de la décision, j’ai été incapable de continuer[7] ». En 1980, à la faveur d’une relation amoureuse et d’un mariage avec Alix Cléo Blanchette, le projet du ‘grand incendie de londres’ est réengagé, placé sous le signe d’un « biipsisme[8] » associant spéculairement le projet littéraire de l’auteur au projet photographique de son épouse[9] – nouveau départ rendu caduc par la mort prématurée de celle-ci en 1983. Il faut attendre 1985 pour que, sortant d’une longue aphasie dans laquelle l’avait jeté le deuil, commence pour de bon la composition du récit projeté en 1978, dont six « branches » ont paru entre 1989 et 2008, passant les deux mille cinq cents pages.
Voici donc, rappelées à grand traits, les principales étapes de la genèse du ‘grand incendie de londres’, dont les premiers mois de rédaction sont aussi ceux de Quelque chose noir, tombeau poétique d’Alix, où l’entrée en écriture est explicitement corrélée à cette double expérience du deuil :
J’avais commencé à parler, en poésie, vingt-deux ans avant.
C’était après une autre mort.
Avant cette autre mort je ne savais comme dire. J’étais comme silencieux. Ainsi, pris entre deux « bords » de mort[10].
Une telle démarche, on le voit, interroge la façon dont l’expérience traumatique peut, en régime littéraire, imposer l’urgence en même temps qu’inquiéter la possibilité d’une œuvre à venir, et d’un avenir tout court pour celui qui écrit. Cet avenir est placé par Roubaud sous le signe d’une vita nova[11], formule dantesque mise en avant dans les mêmes années par Roland Barthes, lequel la mobilise lui aussi au lendemain d’un deuil[12]. Sous des modalités distinctes, Barthes et Roubaud se confrontent chacun de façon extrêmement sérieuse, mais aussi bien problématique et inquiète, aux pouvoirs instaurateurs, réparateurs ou consolants associés à la conversion littéraire[13]. De cette dernière, Proust fournit ici et là le modèle recteur : modèle inaccessible chez Barthes, qui publie ses efforts inaboutis pour franchir le cap du « ça prend[14] » et en reste au stade d’un piétinement préparatoire bientôt interrompu par la mort ; modèle épuisé chez Roubaud qui, dévoilant la répétition ironique de ces moments de révélation où le plan de l’œuvre à venir se décide et dessine dans l’esprit du sujet, fait pour ainsi dire de « l’Adoration perpétuelle » proustienne l’expression quintessenciée du temps perdu, l’amorce du désœuvrement à venir.
Dans ces conditions, ce dont le récit prosaïque du ‘grand incendie de londres’ réalise le deuil, ce n’est pas seulement ni même directement cette « mort double » qui imprime à l’existence de Roubaud une tonalité « démoniaque », comme dit Freud dans Au-delà du principe de plaisir pour parler de ces personnes poursuivies inexplicablement par le malheur[15]. Il en va aussi bien du premier mode de « contre-investissement[16] » qu’avait adopté le sujet devant la mort de son jeune frère, en direction d’un projet démesuré, d’un fantasme grandiose qui, bien loin d’être mis de côté par l’auteur du ‘grand incendie de londres’, est alors pris pour objet de récit, historicisé, humilié dans ses prétentions conquérantes et réparatrices (fantasme qui, en définitive, se découvre comme une marque antiphrastique, un effet du traumatique lui-même). Car le grand incendie de londres n’a pas de prétention directement autobiographique, étant la biographie d’un projet, d’une œuvre non advenue. « Aujourd’hui je réfléchis des illuminations antérieures, pour lesquelles ma vie ne joue pas, n’agit pas (du moins je n’ai rien à en dire) ; il n’y a aucune exaltation en moi, mais peut-être ai-je plus de chance d’aboutir, puisque mon ambition, cette fois, est minimale[17]. » C’est dire le changement de régime qui s’opère, du Projet majuscule au projet petit p, dans le rapport affectif à l’écriture et dans le type de crédit attachée à celle-ci. Si Roubaud, au sortir de son mutisme, choisit de se lancer dans la rédaction le 11 juin 1985, jour anniversaire de son mariage, sa démarche est étrangère au projet testimonial de Barthes dans son propre deuil, consistant à dire ceux qu’on aime[18]. Du deuil, la prose roubaldienne porte trace en se constituant comme un « lieu d’absolue neutralité qui n’a, et pour longtemps, besoin ni des yeux d’un lecteur ni des oreilles d’un auditoire[19]. » Dans ce dispositif solitaire, privé de l’adresse amoureuse qu’offrait la poésie[20], l’œuvre n’est plus synonyme de « vraie vie » (Proust) ou de « Souverain Bien[21] » (Barthes). Composée de « moments of non-being[22] », elle relèverait plutôt d’un imaginaire de la survie : « “le grand incendie de londres” devient indispensable à ma survie de solitaire[23] », écrit ainsi Roubaud.
Comme aux lendemains de 1961, le sujet est bien engagé dans une ascèse, soumet sa vie à une règle, mais nul salut ou sublimation n’est ici à l’horizon. Siège d’un « exercice spirituel[24] », l’écriture « est liée à la conquête, incertaine, d’un état approchant le plus possible de l’indifférence, du renoncement, de l’absence d’espoir, de croyance, de passion, voisin de ce que j’imagine naïvement être l’ ataraxie, chère à Sextus Empiricus[25]. » C’est ramener le projet à une occupation du présent, presque comme on parle d’occupation militaire : comme si le projet n’était plus défini par une protension, par un état de choses à faire advenir, mais en venait à loucher sur la situation immédiate du sujet :
Il n’y a pas dans ces conditions de labeur d’écrivain possible comme, j’imagine, celui qui fait le romancier que je ne serai pas, mais seulement l’extrême concentration sans interstices des mots notés à mesure, favorisant ainsi, mécaniquement, mon effort d’écrire sans ratures, sans repentirs, sans impatience, aux mêmes heures toujours, le plus près possible de la continuité myope du présent irréversible et détesté[26].
À la grande construction anticipée qui « fait le romancier[27] », au futurisme de son ancienne entreprise dont il veut raconter la ruine, Roubaud substitue un projet d’écriture foncièrement présentiste : une succession de brefs « moments de prose » numérotés, composés chaque matin avant le lever du soleil.
Tout projet, particulièrement un projet formel d’écritures, comme le mien aujourd’hui, qui a survécu à toute valeur (au Projet, je donnais de la valeur, et il s’opposait, alors, à l’à-quoi-bon), occupe le temps, l’ordonne, gomme ses vides. Chaque heure en détermine une autre, la pousse, l’avale, l’annule[28].
Au premier Projet affecté d’une valeur (littéraire, éthique), se substitue un nouveau contrat d’écriture, qui vaut à la fois comme un adieu au futurisme velléitaire de 1961-1978, et comme une fin de non-recevoir adressée à la possibilité, pour la littérature, de sublimer l’expérience traumatique du sujet. Pour le dire dans les mots de Patrice Loraux, Roubaud s’applique à la narration de ses vains efforts pour résorber le traumatique dans un « processus spirituel[29] », optant désormais pour un dispositif où le traumatique est « intact, mais néanmoins actif, c’est-à-dire précisément capable de se déplacer[30] ». Simplement, là où Loraux, dans son article « Les Disparus », compare plusieurs dispositifs de représentation qu’il pèse au trébuchet – une installation de Christian Boltanski, le Chimpanzé de Francis Bacon, le monument de la Shoah à Berlin –, Roubaud montre comment ce choix est lui-même travaillé et traversé par du traumatique. Et c’est cette difficulté, ce frayage, cette délibération qu’il prend pour sujet et choisit de montrer. Les quelques citations que je viens de donner en donnent l’idée, le protocole rédactionnel du ‘grand incendie de londres’ nous situe bien « au-delà du principe de plaisir » : abandonnant l’imaginaire et la méthode planistes, l’écriture s’installe dans un régime de répétition : chaque matin, c’est le même protocole d’écriture qui revient, dans les lieux mêmes de la vie commune avec Alix, aux heures qui était déjà celles alors dévolues au travail d’écriture du poète. Une écriture qui, au moins au départ, est réputée sans promesses, sans leçons, sans adresse, d’autant que son destin livresque est lui-même difficilement pensable, le livre étant longtemps envisagé « comme manuscrit avant tout, plus que comme livre imprimé[31] ».
Qu’est-ce qui, dans ces conditions, prête au dispositif du ‘grand incendie de londres’ ce caractère actif, cette aptitude au déplacement dont parle Loraux ? Trois choses, peut-être, que je me contenterai d’évoquer rapidement pour finir.
1) Dès les premières pages de la première « branche » et malgré le protocole présentiste que j’ai décrit, on observe la persistance d’une temporalisation prospective du sujet et de son œuvre en train[32] De fait, dès les premières lignes du projet roubaldien, un ordre émerge, progressivement et précairement, du présent de l’écriture. Ne serait-ce qu’à travers l’énoncé de cette contrainte minimale d’une composition journalière impréparée, conservée dans son premier jet. À preuve la profusion des commentaires méta-énonciatifs qui évoquent l’œuvre à venir, l’organisation et la qualification de ses parties etc. L’écriture au présent n’a pas pour enjeu d’annuler l’investissement du sujet dans un avenir volontaire, mais plutôt de permettre à cet investissement de s’inscrire dans le présent et d’y laisser une trace, de s’ajouter à l’œuvre plutôt que d’en ajourner toujours l’avènement. Parmi les dix registres fondamentaux de sa grande prose, cette forme d’anticipation relève du « Muss es sein[33] ! » (« il faut que cela soit comme ça ! ») : autant dire que si nul salut n’est attendu de l’écriture, tout se passe comme si l’on pouvait tout de même attendre quelque chose du fait qu’il y ait écriture, et du fait d’inscrire, de textualiser cette attente elle-même.
2) À la faveur de ce mouvement protensif, le grand incendie de londres donne à lire un retour de l’adresse : en produisant la délibération du livre en train de s’écrire, Roubaud noue un contrat de lecture, qui implique une part d’énigme, engageant la nature même du projet :
je pourrais dès aujourd’hui écrire, en une phrase de dix mots exactement : « ‘le grand incendie de londres’ sera……………… », mais en même temps il est clair que ‘le grand incendie de londres’ ne sera ce qu’il sera qu’une fois achevé (s’il l’est jamais : cette affirmation étant tautologique, certes, mais pas seulement), c’est-à-dire s’il va assez loin pour pouvoir être dit être (auquel cas, étant donné ce qu’il doit être, il sera, je peux le dire, quoi qu’il arrive ensuite, nécessairement achevé) ; il s’ensuit que je n’écrirai la fin de cette phrase programmatique, de cette définition (avec ses quatre mots ici manquants) qu’à la presque fin du livre, en admettant que j’aie l’occasion de l’écrire du tout (et il se trouve que, même dans l’hypothèse d’existence atteinte, cela n’est pas certain[34]).
Comparés aux prophéties de Merlin déchiffrables seulement après coup, cet avenir réservé, ce secret maintenu au départ de l’œuvre me semble produire un vide qui ménage une place pour le lecteur, et articule la délibération inquiète de l’écrivain à l’expérience de la lecture. Dès les premières lignes de la prose, à un moment où Roubaud n’est pas encore sûr que son entreprise parviendra jusqu’à la publication, est figuré le mouvement par lequel le livre, en s’énonçant prospectivement dans un mixte entre exposition et rétention, vient ou plutôt revient à un lecteur.
3) Le dispositif choisi par Roubaud se signale par son ampleur, alléguée dès la première ligne de l’Avertissement qui évoque les suivantes et « les imagine nombreuses ». Substituant au grand commencement de la vita nova la succession indéfinie de recommencements journaliers, dont le cours relève de ce que Barthes a pu appeler un « protensif absolu », où la fin comme visée opératoire s’identifie à la fin comme terme, interruption, perte de moyens, le régime de répétition adopté dans le ‘grand incendie de londres’ a néanmoins pour effet de vectoriser le présent, de passer d’un « j’écris » à un « j’écrirai », comme fait exemplairement le premier moment de prose daté du 11 juin 1985[35]. Ce faisant, s’instaure un dispositif dont la caractéristique foncière est d’être déplaçable, transposable, caractéristique qui travaille le texte dès ses premières pages. Le contraste est net, à cet égard, avec Quelque chose noir, dont le régime de répétition est de bout en bout associé au retour « à neuf [36] » de l’image traumatique de la défunte. À l’horizon de ce recueil, qui est moins un espace de remédiation ou de réparation que de description et de traitement (comme on dit d’un thème ou d’un sujet, pas d’une maladie), rien d’autre à espérer qu’un « second silence » du traumatique : « le futur proche où je me tairai de ces poèmes avec absolu incompréhension[37] ». Tout différemment, le grand incendie de londres, lui aussi arqué autour de ces deux morts du frère et de la femme aimée, constitue un dispositif certes marqué par la logique répétitive de la pulsion de mort, mais il a ceci de particulier qu’il peut dériver, dire autre chose, évoluer dans ses objets, dans sa tonalité, dans l’investissement projectif dont il est à la fois le cadre et la trace. En témoigne, très concrètement, le déménagement de l’écrivain, puisque celui-ci, au moment d’achever la première branche, choisit de quitter l’ancien domicile conjugal pour continuer d’écrire ailleurs. En déplaçant le site de l’écriture tout en conservant son protocole, Roubaud ne répare pas le trauma, mais il le territorialise, l’inscrit dans le temps et dans l’espace, et se réserve la possibilité de parler de lui depuis un autre lieu et un autre temps. Le présent, dès lors, n’est plus le temps arrêté, fasciné par le traumatique, il s’offre à une indétermination propre à faire que « le trauma parle au trauma[38] », comme l’écrit Jean-Max Gaudillière cité par Loraux. Car parler depuis un autre lieu n’est pas exactement changer de sujet, possibilité, à tout prendre, qu’offrirait plus facilement le journal. À la différence du genre diaristique avec lequel il partage la contrainte de l’écriture au jour le jour, le ‘grand incendie de londres’ demeure porté par un projet narratif finalisé (orienté) qui, par delà le deuil d’Alix, restaure et maintient le lien avec l’expérience traumatique de 1961 ainsi qu’avec le premier contre-investissement du Projet. C’est bien avec lui et avec son énergie problématique qu’il s’agit, tout du long, de ruser et de renouer, sur un mode mineur :
[…] même affaiblie, abâtardie, ridiculisée et combattue consciemment, la même impulsion, commune à toutes les versions mégalomanes antérieures du Projet et du Grand Incendie de Londres (les deux en intention), demeure en moi et ruse avec l’aveu d’échec ; essayant malgré tout de survivre, ne serait-ce que par ces moyens détournés. Elle m’accompagnera vraisemblablement, de plus en plus dérisoire, jusqu’à la mort[39].
Est-ce là ce que Loraux appellerait un « bon dispositif » ? Je ne sais pas, mais c’est à coup sûr un dispositif qui ménage une large place à tout ce qui grève, humilie, conditionne et finalement favorise et exploite le choix du bon dispositif, et désigne en creux ce choix comme l’affaire irrésolue de chacune et chacun.
[1] Jacques Roubaud, Impératif catégorique. Récit, Paris, Seuil, « Fiction & Cie », 2008, repris dans le grand incendie de londres, Paris, Seuil, « Fiction & Cie », 2009 (désormais abrégé gril), § 54, p. 1210.
[2] Id. , « Avertissement »,Le grand incendie de Londres. Récit, avec incises et bifurcations. Branche un : La Destruction, Paris, Seuil, « Fiction & Cie », 1989, repris dans gril, p. 13.
[3] Ibid. , La Destruction, § 57, p. 143.
[4] Ibid. , « Avertissement », p. 13.
[5] Id. Mathématique Paris, Seuil, « Fiction & Cie », 1997, § 18, repris dans gril, p. 928.
[6] Id. , La Destruction, op. cit., § 16, p. 53.
[7] Ibid.
[8] « Le monde d’un seul, mais qui aurait été deux, un double : pas un solipsisme, un biipsisme », voir le poème « Une logique », dansQuelque chose noir, Paris, Gallimard, 1986, p. 49-50, repris dans La
[9] Alix Cléo Roubaud, née Blanchette, est une artiste photographe d’origine canadienne, auteure de textes théoriques sur la photographie inspirés de Wittgenstein. Jacques Roubaud a édité son Journal en 1984. Nous savons peu de choses sur cette articulation des projets de Jacques et Alix Cléo Roubaud au début des années 1980. Voici ce que l’écrivain en dit dans La Destruction : « Dans ce monde la double langue, palindrome de la pensée et du miroir, la même langue comprise doublement, et nous, toujours, traduisant, / Dans ce monde ses images ; mes mots. Le biipsisme des images et de la langue. Montrer, dire », ibid., p. 184.
[10] Id. , Quelque chose noir, op. cit., p. 131-132.
[11] Roubaud reprend la formule latine de l’incipit de la Vita nova de Dante (Incipit vita nova) en guise de titre du premier chapitre de Mathématique :.
[12] Voir sur ce point « “Longtemps, je me suis couché de bonne heure” », conférence au Collège de France, 19 octobre 1978, publiée dans « Les inédits du collège de France », 1982, repris dans Œuvres complètes , Paris, Seuil, 2002, t. V, p. 459-470.
[13] Sur la conversion littéraire et le statut paradigmatique de la « vita nova » barthésienne pour la modernité, voir Dominique Rabaté, « Une conversion intérieure », dans Marie Gil et Frédéric Worms (dir.), La Vita nova. La Vie comme texte, l’écriture comme vie, Paris, Hermann, « Des morales et des œuvres », 2016, p. 131-147.
[14] Cette question occupe Barthes depuis « Proust et les noms » et fait encore l’objet d’un court article en 1979. Voir « Proust et les noms », dansTo Honor Roman Jakobson, Paris-La Haye, Mouton, «Janua linguarum. Series maior », 1967, repris dans Œuvres complètes, op. cit., t. IV, 66-78 ; et « Ça prend », Le Magazine littéraire, no 144, janvier 1979, repris dans Œuvres complètes, op. cit., t. V, p. 654-656.
[15] Voir Sigmund Freud, Au-delà du principe de plaisir [1920], trad. de l’all. Jean Laplanche et Jean-Baptiste Pontalis, Paris, Payot et Rivages, « Petite bibliothèque Payot Classiques », p. 66-67.
[16] Ibid. , p. 82-83.
[17] Jacques Roubaud, La Destruction, op. cit., § 56, gril, p. 141.
[18] Voir sur ce point la conférence au Collège de France déjà citée, « Longtemps, je me suis couché de bonne heure », et ce passage du Journal de deuil : « En un sens, aussi, c’est comme si il [sic] me fallait faire reconnaître mam. Ceci est le thème du “monument” ; mais : / Pour moi, le Monument n’est pas le durable, l’éternel (ma doctrine est trop profondément le Tout passe : les tombes meurent aussi), il est un acte, un actif qui fait reconnaître. » Roland Barthes, Journal de deuil, op. cit., 5 juin 1978,p. 145.
[19] Jacques Roubaud, La Destruction, op. cit., § 16, gril, p. 54.
[20] « La poésie, parce que j’avais pris l’habitude de la dire à haute voix, de lire en public, et pour elle, avec qui je vivais, s’est arrêtée pour moi. » Ibid.
[21] Roland Barthes, La Préparation du roman. Cours au Collège de France, 1978-1979 et 1979-1980 , Paris, Seuil, « Les cours et les séminaires au Collège de France de Roland Barthes », 2015, p. 40.
[22] Jacques Roubaud, Poétique. Remarques. Poésie, mémoire, nombre, temps, rythme, contrainte, forme etc. , Paris, Seuil, « Librairie du xxie siècle », 2016, § 361. Sous la plume de l’auteur, les « moments of non-being » (illustrés entre autres par la prose du ‘grand incendie’) s’opposent aux « moments of being » (emblématisés par la pratique poétique), cette opposition est empruntée à Virginia Woolf. Voir Virginia Woolf, Instants de vie, trad. de l’ang. Colette-Marie Huet, Paris, Stock, « La cosmopolite », 2006.
[23] Jacques Roubaud, La Destruction, op. cit., § 50, gril, p. 131.
[24] Ibid ., § 32, p. 93.
[25] Ibid ., § 16, p. 54.
[26] Ibid. , § 5, p. 28.
[27] Pensons à Perec, qui publie son chef d’œuvre oulipien, La Vie mode d’emploi, à la rentrée littéraire de 1978, au moment où Roubaud déchire les plans de son Projet.
[28] Jacques Roubaud, La Destruction, op. cit., § 136, gril,
[29] Patrice Loraux, « Les Disparus », dans Le Genre humain, n o 36, 2001/1 : « L’art et la mémoire des camps. Représenter, exterminer » (dir. Jean-Luc Nancy), p. 41-57, ici p. 57.
[30] Ibid.
[31] Jacques Roubaud, La Destruction, op. cit., § 127, gril, p. 277.
[32] Ceci a bien été remarqué par Ann Jefferson : si, d’un côté, « [l]’illusion réfutée n’est remplacée par aucun nouvel idéal, mais au contraire par un renoncement à toute forme d’idéalisation », d’un autre, l’auteur du ‘grand incendie de londres’ donne à lire « un travail essentiellement pro-spectif ». Voir Ann Jefferson, « Jacques Roubaud : régime de vie, écriture sans fin », dans ead., Le Défi biographique. La Littérature en question, tr. de l’ang. Cécile Dudouyt, Paris, PUF, « Les littéraires », 2012, p. 388-397, ici p. 390 et 395.
[33] Empruntée à Beethoven, cette expression illustre le style de l’exhortation, emblématisé par le volontarisme des années 1961-1978 mais toujours à l’œuvre par la suite, sur un mode mineur. Ce style, Roubaud le nomme « rakki taï » ou « style pour dompter les démons », par référence aux dix styles de Kamo no Chomei, poète et ermite du xiiie siècle japonais, styles que Roubaud mobilise pour décrire les différentes tonalités adoptées dans sa prose. Voir Jacques Roubaud, La Destruction, op. cit., § 84, gril, p. 190-192.
[34] Ibid. , § 105, p. 240-241.
[35] Ibid. , § 1, p. 19-20.
[36] Cette image se présente pour la millième fois à neuf avec la même violence elle ne peut pas ne pas se répéter indéfiniment […] ». « Méditation du 12/5/85 », dans id., Quelque chose noir, op. cit., p. 11. Le chiffre neuf structure par ailleurs l’ensemble du recueil, composé de neuf sections (plus une surnuméraire, intitulée « Rien ») de neuf poèmes de neuf paragraphes chacun (à quelques exceptions importantes près).
[37] « Méditation de la comparaison », ibid., p. 85.
[38] Patrice Loraux, « Les disparus », art. cit., p.
[39] Jacques Roubaud, La Destruction, op. cit., § 104, gril, p. 238.