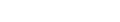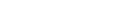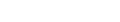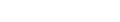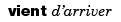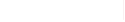Inédit
L'apathie de la loi et l'expression du trauma dans la poésie judiciaire de Vanessa Place
Préambule
Les 13, 14 et 15 décembre 2018, un colloque international organisé sous l’égide de Transitions et consacré à « Littérature et trauma » a rassemblé trente-six communiquants réunis en sessions, elles-mêmes réunies en journées. Francis Haselden est intervenu lors de la première journée, celle du 13 décembre au matin, consacrée à « Un champ émotionnel en débat », lors de la session « “- pathie” : apathie et empathie ».
Francis Haselden se penche sur une œuvre très particulière, celle de Vanessa Place, poétesse américaine, mais aussi avocate de profession qui défend en cour d’appel les accusés de viol ; et plus particulièrement sur son recueil intitulé Exposé des faits (2010), où, en « repren[ant] verbatim les exposés des faits qui constituent la première partie d’un procès en appel », l’écrivaine pratique donc « une mimêsis radicale ». Discutant longuement une proposition de Soshana Felman selon laquelle la littérature et la loi constituent deux manières opposées de lutter contre le trauma, la première, empathique, et la seconde, apathique, Francis Haselden conclut que Vanessa Place « complique […] l’opposition binaire établie par Felman : quand la loi devient littérature et quand la littérature imite la loi l’abysse s’ouvre et se ferme simultanément. »
H. M.-K. et T. P.
Francis Haselden est normalien (ENS Paris), diplômé en philosophie et histoire de l'art et membre de l'équipe de recherche Postdigital de l'ENS. Il traduit actuellement The Inorganic Body in the Early Marx de Judith Butler pour les Éditions Sociales (à paraître en mars 2019).
L'apathie de la loi et l'expression du trauma dans la poésie judiciaire de Vanessa Place
François Haselden
06/04/2019
Soshana Felman, dans The Juridical Unconscious, définit le trauma comme un abysse qui brise l’unité du sujet[1]. Au fur et à mesure que l’abysse s’agrandit, la belle totalité du sujet ne cesse de se fragmenter, rendant ainsi indistinctes les limites qui séparent l’intérieur de l’extérieur et le soi du monde. L’indifférence règne ; plus personne ne peut se hisser au rang de sujet. Pour faire face à cette crise, la littérature et la loi offrent, selon Felman, deux modalités d’actions spécifiques. La loi agit d’une manière apathique : elle examine de loin l’événement sans être affectée par la destruction du sujet à l’œuvre en rapportant le cas particulier à la règle. Elle jette un pont par-dessus l’abysse afin d’enfermer celui-ci dans des catégories sociales, politiques et juridiques et de lutter contre l’ambiguïté et l’équivoque. La loi cherche un sens en nommant l’événement sans nom et établit la réalité de celui-ci en suivant un ensemble de procédures codifiées[2]. Au contraire, la littérature est de nature foncièrement empathique en ce qu’elle tend vers l’Autre traumatisé sans chercher à résorber sa souffrance dans une catégorie prédéterminée. La littérature maintient la brèche ouverte sans témoigner d’une volonté de totalisation de l’événement[3]. Or, je voudrais réexaminer cette opposition entre la loi et la littérature à la lumière d’un texte littéraire qui revêt la forme exacte de l’ordre juridique, et qui adopte la même stratégie de résolution du trauma que celle employée par la loi.
Vanessa Place est une poétesse américaine contemporaine dont le travail s’inscrit dans l’héritage de l’objectivisme de Charles Reznikoff. Avocate de profession, elle défend en cour d’appel les accusés de viol. Et son activité professionnelle se confond avec son travail poétique : dans son recueil intitulé Exposé des faits paru en 2010, la poétesse reprend verbatim les exposés des faits qui constituent la première partie d’un procès en appel, et pratique ainsi une mimêsis radicale. La poésie devient un ready-made qui tord le cou à l’éloquence en présentant un objet langagier froid, un réel reproduit sans sublimation, un texte juridique dont la nature est de relater aussi objectivement que possible les « faits » de l’agression. La matérialité du monde est mise en avant dans toute sa simplicité. Néanmoins, un bref extrait du premier exposé des faits montre comment la froideur des mots parvient difficilement à faire barrage à l’horreur des événements :
Appellant never asked Ben if he wanted to have sex. Ben had sex with appellant “out of curiosity.” After Ben saw appellant ejaculate, Ben returned home. (RT 2:1838-1840, 2:1851-1852, 2:1869) Ben’s mother Madison was on the porch;she asked Ben where he had been, and he eventually told her. She became upset, he embarrassed[4].
Ce texte qui fut tout d’abord lu au tribunal dans le cadre d’un procès et qui constitua la réalité établie de l’événement ne manque pas de susciter une réaction d’horreur chez le lecteur. Réaction paradoxale dans la mesure où une pulsion anti-esthétique anime de toute évidence le discours : sorti hors de son contexte original, lu en public, le texte est gris, le discours est factuel. Les chiffres, dont la signification précise sera révélée plus tard, coupent court à toute implication émotionnelle du lecteur. Rappelons à cet égard le vers programmatique du poème « No More » écrit par Vanessa Place : « No more songs of raw emotion, forever overcooked[5]. » L’émotion des chants disparaît, un monde apathique émerge du texte de loi. Cette apathie se manifeste à travers le nivellement des informations : le fait de l’agression est juxtaposé au fait trivial que la mère était assise sur le perron. En outre, lorsque Place écrit : « She asked Ben where he had been, and he eventually told her » la simple temporalité de la succession exprimée par le « and » semble indiquer que rien ne se passe dans l’interstice qui sépare le moment de l’agression et le moment où Ben dit ce qui s’est passé. « Eventually » ne signale ici qu’une simple attente dans le temps et non l’inscription bouleversante du trauma dans la psyché. Le rapport empathique avec la victime est bloqué par le refus de la poétesse de plonger dans les émotions brouillées et troubles de l’enfant. Et quand il s’agit de traiter l’émotion en jeu, celle-ci est pensée à distance sous la forme du fait : « She became upset, he embarrassed ».
Le texte juridique et le poème qui en est la retranscription trahiraient-ils l’expérience de la victime ? Le texte objectif, froid et sans vie résulte non seulement d’une décision consciente de ne pas s’engager passionnellement en faveur de la victime (vivre sa douleur, partager son désir de vengeance, haïr le bourreau), mais aussi d’une impossibilité qui est celle de créer un lien empathique avec un « tu ». Qui est « Ben », le sujet du texte ? Nos tentatives de compréhension empathique sont vaines. Le sujet « Ben » a été détruit. Il ne reste aucune surface passible, aucun socle identitaire, qui opérerait la synthèse de l’expérience. Or pourquoi chercher une subjectivité là où il n’y en a plus ? Pourquoi chercher à lier le « je » (du lecteur) au « tu » (de « Ben ») précisément quand il n’y a plus aucune possibilité de dialoguer avec un être désormais absent ? « Ben », qui est supposément un garçon, n’est plus qu’un mot répété au début de chaque phrase, un mot qui ne renvoie plus à rien, si ce n’est à un vide. L’empathie achoppe sur une réalité dévastée : le lecteur rencontre ce non-sujet qui, tel un terrain vague ou un espace intersidéral, est désaffecté. Ainsi, l’écriture évidée de toute subjectivité partage un trait essentiel de la victime.
Cependant l’apathie profonde du texte, qui n’est pas sans lien avec la béance du sujet traumatisé, n’est pas le reflet mimétique de l’expérience subjective de l’agression. Malgré la ressemblance entre la froide distance du texte et l’évidement du sujet, Place ne cède pas à la tentation de retranscrire la violence infligée à la psyché de « Ben ». L’écriture (ou la retranscription) de Place, loin d’être un discours du choc et du trouble, est un discours de connaissance. L’apathie du discours juridique encourage à transformer le réel, brutal et rétif à la symbolisation, en fait. Dans la poésie de Place, dans le discours de la loi, le trauma est sommé d’apparaître par le constat : la forme simple, réductrice, du fait constitue le contour d’un événement infiniment expansif. « Appellant never asked Ben if he wanted to have sex » : le fait est là, sans consentement il y a agression. En constatant la violence, celle-ci est placée sous nos yeux : l’apathie nous place face à la réalité – et donc à une certaine distancede l’événement – tandis que l’empathie nous jette en elle. Comment circonscrire un événement qui ne nous accorde aucun dehors, aucun répit ? Grâce à l’apathie, une distance sépare l’événement de sa retranscription. Il est donc possible de s’y référer sans que la scène traumatique ne se répète. C’est alors toute l’épistémologie du trauma qui se trouve bouleversée : le trauma n’apparaît plus comme un après-coup, c’est-à-dire comme un événement qui renaît sous une forme à chaque fois nouvelle et qui se rejoue dans l’histoire sans pouvoir être précisément représenté. Le constat, émis à partir d’un dehors, éloigne le trauma, l’identifie et cherche à le résoudre.
Comment faire face à la réalité traumatique si le propre de celle-ci est de détruire la victime de l’événement, rendant par là impossible toute relation empathique ? Dans quelle condition faut-il se trouver pour pouvoir constater et faire face à la réalité ? L’apathie apporte de nouveau une réponse à cette question problématique : être apathique, c’est ne pas se faire d’illusion quant à la possibilité d’engager une relation qui lie le « je » au « tu ». Le « je » ne peut pas se mettre à la place du « tu » qui n’est plus présent. Etre apathique, c’est constater l’évidement du sujet à partir d’une position tierce, loin de la scène de violence. On comprend que le discours factuel qui permet de dire « Ben est embarrassé » dépend du « il » (ou du « elle), c’est-à-dire de la troisième personne : l’expérience est identifiée en tant que fait – « elle » est là sous nos yeux comme une chose que je peux répéter dans le discours conformément au principe d’identité – et cela se fait à partir du « il » de la loi qui cherche à surplomber l’événement, le nommer et lui donner une signification juridique.
C’est alors que l’apathie, qui est la condition du constat factuel, mène paradoxalement à l’action. Elle n’est plus la mollesse d’un Oblomov ou d’un Bartleby qui refusent de se lever, elle est la disposition première du juge qui s’applique à passer une sentence. En quoi l’apathie est-elle agissante ? Le fait, qui résulte de l’apathie, est décisif et décisoire. Un fait est le résultat d’un processus de sélection à l’issue duquel une certaine définition de la réalité s’impose au détriment d’autres versions possibles. Le propre de la loi est de forclore certaines versions de la réalité et de constituer une définition stable de la réalité pour servir de référence au jugement. Le refus de l’empathie à l’œuvre dans la retranscription à la lettre de l’exposé des faits témoigne d’une exigence courageuse de clôture de l’événement traumatique : il faut dire le trauma, et pour ce faire il faut le constater. Et une fois le trauma nommé lors du processus de sélection inhérent à toute reconstitution des faits, le juge peut agir.
Cependant, l’exposé des faits sous la forme poétique ne résout de toute évidence rien. Le texte de Place, pour semblable qu’il soit au véritable exposé des faits, reste une production non-juridique. Le langage factuel fait bien signe vers la résolution du trauma en constatant l’agression, mais le texte poétique ne fait pas loi. Il n’a pas la force ou l’autorité pour condamner. Il n’y a aucun juge hors du tribunal. Placé hors de son contexte original (le tribunal), le langage juridique, qui repose sur le constat et exprime une décision, perd son pouvoir. Il ne reste qu’un lecteur face à un texte cru ou une audience assise devant Vanessa Place qui lit recto tono les exposés lors de ses performances publiques. C’est notamment lors de ces performances que le désengagement de la poétesse suscite de vives réactions parmi les spectateurs. L’indignation et le choc de l’audience (surtout étasunienne) résultent du refus de la poétesse de se censurer et de se plier aux normes du trigger warning. Alors l’audience s’énerve, s’inquiète. Pourquoi ne défend-elle pas la victime ? Pourquoi reste-t-elle aussi distante envers la scène de violence ? Pourquoi défendre les accusés de viol ? Serait-elle en faveur du viol ? L’apathie de Place dérange : elle serait le signe d’une attitude foncièrement immorale consistant à se montrer indifférent envers la douleur des victimes. Or les membres de l’audience veulent une prise de position : il faut, s’exclament-ils, que Place se prononce contre le viol.
Mais en refusant de s’exprimer, en se contentant de retranscrire les exposés des faits, Place fait appel à la liberté du lecteur. En extirpant le texte juridique hors de son contexte et en résistant à la tentation de statuer sur le sens de celui-ci, elle opère un suspension du monde, un arrêt esthétique. La signification fonctionnelle est mise en crise. Soudain, c’est le texte juridique lui-même qui apparaît sous nos yeux, comme une étrange sculpture de langage dont il faudrait faire le tour pour l’examiner. Rien n’est plus étrange que ces chiffres entre parenthèses dans les exposés. Dans la phrase « Ben returned home (RT 2:1838-1840, 2:1851-1852, 2:1869) », « RT » signifie « Report Transcript » : il s’agit des rapports de police qui contiennent les interrogatoires des personnes impliquées dans l’affaire. Place expose les conditions de production des faits, leur lieu d’origine, la nature de l’institution qui les a recueillis. Il s’ensuit quela vérité des faits énoncés au tribunal peut être mise en doute. En refusant de suivre à la lettre l’ordre de la loi, le lecteur se retrouve, pour ainsi dire, au pied de la lettre. Il voit la loi en train de se faire ; il comprend que le « fait » est une affaire de langage, que le fait est fait dans certaines conditions. Les traces de la main de l’homme, celui qui sculpte dans le réel les phrases courtes et factuelles, sont désormais visibles.
Ainsi, l’apathie de l’écrivaine donne au lecteur la liberté de porter son regard vers l’ombre du droit. Quand bien même la loi servirait à résoudre la violence, elle doit être contrôlée afin d’éviter qu’elle-même ne devienne la cause d’un nouveau trauma. La mise en évidence par Place du texte juridique transforme le lecteur en juge du juge afin de contrôler les dérives juridiques. Revenons à la critique de la loi faite par Soshana Felman. Dans The Juridical Unconscious, c’est paradoxalement la loi qui est accusée d’avoir une force traumatisante. L’ordre juridique enjoint à métamorphoser le trauma en un discours clair, cohérent, répétable afin qu’il soit pris en compte dans le cadre d’un procès. Or une telle sommation risque, selon Felman, de rejouer la scène traumatique en raison de l’impossibilité de traduire l’expérience du trauma en logos. Lorsque l’ordre est émis de parler, le sujet s’effondre : son corps, son langage ne sont plus à même d’être en position d’énonciateur conscient et maître de sa mémoire[6]. Le travail de Place prend note de cette aporie du droit qui ne peut plus avancer sur le chemin de la communication habituelle et doit faire place au silence de la victime. Par conséquent, se trouver au pied de la lettre juridique, c’est prendre acte de la résistance de la matière informe traumatique qui réapparaît dans les fissures du langage. La loi perd de sa superbe et admet qu’elle ne peut pas tout dire.
L’exposé des faits de Place, porté par l’apathie profonde du texte, parvient à brouiller les limites trop nettes qui séparent, selon Felman, la loi et la littérature. D’une part, la loi serait une forme de clôture de l’événement traumatique : son discours est auto-suffisant, presque arrogant ; la loi pourrait tout dire. La violence de l’agression serait totalement comprise par les catégories juridiques. D’autre part, la littérature laisserait affleurer, dans le texte même, l’abysse de l’irreprésentable. Cependant, lorsqu’un texte prend la forme de la loi tout en maintenant son statut de texte littéraire, les deux domaines que sont la loi et la littérature se confondent. La retranscription objective et sans fioritures des textes du procès coupe court à toute tentative de constituer un rapport empathique avec la victime. L’apathie du texte, loin de faire plonger le lecteur dans la psyché de la victime, le distancie de la scène en le plaçant dans la position de cette personne tierce qu’est celui qui énonce la loi en statuant sur la vérité de l’événement. L’apathie fait donc signe vers la résolution. Toutefois, l’apathie n’est pas seulement le moteur qui initie le processus de symbolisation : elle est aussi la disposition subjective nécessaire à la déconstruction de l’ordre juridique lui-même. L’apathie fait porter le soupçon sur la volonté de résoudre le trauma alors même qu’elle peut être employée en vue de cette résolution. Place complique ainsi l’opposition binaire établie par Felman : quand la loi devient littérature et quand la littérature imite la loi l’abysse s’ouvre et se ferme simultanément.
[1] Soshana Felman, The Juridical Unconscious, Cambridge, Harvard University Press, 2002.
[2] Ibid., p. 95.
[3] Id.
[4] Vanessa Place, Statement of Facts, Los Angeles, Blanc Press, 2010, p. 9.
[5] Vanessa Place, « No More », Poetry, mars 2013 : https://www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/poems/56142/no-more.
[6] Felman affirme cette thèse en fondant son argument sur l’effondrement de K-Zetnik, le témoin des camps d’extermination, lors du procès d’Eichmann en 1961. Selon l’auteure, l’évanouissement constitue une expérience traumatique causée par la loi : celle-ci demande l’impossible à K-Zetnik, en lui enjoignant de formuler rationnellement son expérience, de mettre en narration l’événement qui par définition échappe à la structure narrative (Felman, op.cit., p. 131-166).