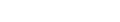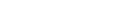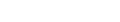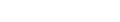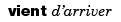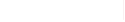Abécédaire
Brice Tabeling
06/07/2019
Souvent, les mots m’échappent. Je veux dire que je ne comprends plus (si j’ai jamais compris) ce que c’est qu’un mot, comment ça fonctionne et comment je peux (ou je dois) m’en servir. C’est une expérience un peu similaire à celle de la découverte d’un objet (lors d’un déménagement par exemple ou quand on fait le ménage) dont on a tant de mal à concevoir l’usage qu’on se met à regarder stupidement autour de nous pour voir s’il n’appartient pas à un autre objet, plus grand, plus compréhensible, plus habituel dont il se serait détaché car, à ce moment-là, il nous est impossible d’imaginer que ce machin ou ce truc ait le moindre usage (j’ai envie d’écrire le moindre sens) en lui-même.
Bien sûr, il faut avoir le temps de s’étonner car une telle perplexité, un caractère un peu plus organisé et un peu plus pragmatique se l’évite en rangeant immédiatement l’objet dans le carton des trucs qui y ressemblent ou le tiroir des machins qui ne servent à rien, sans tergiverser ni rêvasser, allez, dépêche-toi, cela fait une semaine que je te demande de ranger ta chambre.
« Zoulou », par exemple, on peut assez rapidement en donner une définition à partir du dictionnaire qui dirait qu’il s’agit d’un terme qui, comme nom, désigne un peuple du Sud de l’Afrique ou sa langue et, comme adjectif, ce qui se rapporte à ce peuple (je le mets donc dans le carton où se trouvent « Français », « Anglais », « Martien », « Chinois » etc.). On peut encore souligner qu’il est la traduction occidentale du terme « amaZulu » (ou « isiZulu » pour la langue) qui est lui-même la transcription latine du mot « zoulou », la langue zouloue n’ayant pas de forme écrite jusqu’à la colonisation occidentale (je le range donc dans le tiroir sans fond des termes étrangers avec « kéfieh », « nunchaku », « lama », « bonjour » etc.).
Mais « zoulou », cela veut aussi dire « sauvage » (par exemple dans « Arrête de faire le zoulou et fais tes devoirs !») ; c’est encore le terme qu’on utilisait pour nommer le chanteur sud-Africain d’origine européenne Johnny Clegg – le « Zoulou blanc » disait-on – dont les tubes, exploitations commerciales pop-rock du patrimoine musical zoulou, constituèrent pendant quelques années le principal accès du public occidental à cette culture et l’un des usages importants du terme. Dès que l’on songe à ces deux emplois, il devient difficile de se contenter du tiroir et du carton précédents. L’ordre qu’une telle classification produit, aussi efficace soit-il, efface un peu rapidement des aspects du mot – son histoire, sa fonction au sein d’une culture colonialiste, raciste et capitaliste – qui sont pourtant tout aussi véritables que ceux que le dictionnaire contient.
A cela, il faut ajouter une série d’évocations obscures provoquées par le signifiant. J’aimerais ainsi raconter ce que la simplicité explosive du terme provoque en moi de joie enfantine, à quel point ses sonorités ont un effet transgressif et libérateur : la vitesse incontrôlée du « z », la répétition du [u], bruit même du surgissement (hou ! c’est le loup !), une répétition qu’en plus, aucun hiatus ne vient interrompre puisque la consonne [l] vient la fluidifier, la rendre plus fulgurante, plus heureuse et plus insouciante. Mais comment ignorer alors qu’il s’agit moins d’une improbable musicalité en soi du signifiant que d’un symptôme des normes phonétiques de ma langue au sein desquelles, par nécessité, les sonorités d’un mot africain détonnent plus nettement ? Comment surtout ne pas voir que je ne quitte nullement l’imaginaire colonial infantilisant et déshumanisant que j’évoquais plus haut, me contentant ici de le rapporter au signifiant plutôt qu’au signifié, le privilège accordé au signifiant étant justement une des marques de cette infantilisation et de cette déshumanisation (le zoulou comme babil, comme extériorité au logos) ?
Voilà donc le problème : un mot, c’est (notamment) une signification, une fonction grammaticale, une provenance, l’histoire de ces usages, un signifiant et des émotions, des souvenirs, et de nouvelles significations et émotions attachées à tout ce qui précède et à leurs combinaisons, parfois contradictoires. Bien sûr, en général, on se contente de les mettre dans une phrase (« Un groupe de Zoulous partage une bouteille de Pessac-Léognan au café près de la mairie ») mais, dès lors que l’on prend le temps de les considérer, ils deviennent une chose qui ne cesse de déborder l’usage qu’on aimerait en faire. Toute classification (carton, étagère à bibelots, poubelle) en effacera certains aspects importants. Cet abécédaire est, pour moi, un des lieux où leur préserver leur statut de machin ou de truc incompréhensible et inutilisable.